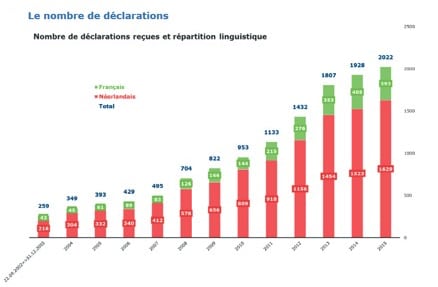FIN DE VIE : "JE VOUS EN SUPPLIE, LAISSEZ VIVRE CEUX QUI ONT TANT À NOUS APPORTER !"
Le coin des experts de genethique.org
Tribune 05 mars 2018
Le Monde a publié mercredi la tribune de 156 députés qui demandent au gouvernent de légiférer sur l’euthanasie et le suicide assisté avant la fin de l’année 2018. Béatrix Paillot est médecin gériatre, elle réagit pour Gènéthique.
En tant que médecin gériatre, je suis choquée et navrée d’entendre parler des pressions actuelles en France pour faire passer en force une législation rendant possible une mort provoquée avant le terme naturel de la vie.
Fin de vie : retour à l’essentiel
Mon expérience humaine et professionnelle me montre qu’il y a là un leurre terrible. On veut nous faire croire que les personnes âgées dépendantes seraient un poids pour la société et qu’on vivrait plus heureux si elles n’étaient pas là. Or c’est exactement le contraire car les personnes vulnérables nous ramènent sans cesse à l’essentiel de la vie. Elles nous montrent que la vie humaine trouve son sens plénier non dans le faire, mais dans l’être. Plus nous savons nous ouvrir gratuitement à la rencontre de l’autre en prenant soin de lui dans sa vulnérabilité, et plus nous sommes révélés à nous-mêmes, plus nous trouvons le sens de notre vie personnelle et sociétale. C’est pourquoi on dit que l’humanité d’une société se mesure à sa capacité de prendre soin des plus faibles. Si on dit que les personnes âgées ou handicapées sont un poids pour la société, on les tue symboliquement et on les pousse au suicide.
Un jour en consultation, j’ai reçu une femme d’un certain âge qui me dit : « Vous savez j’ai rédigé une lettre dont j’ai donné copie à tous mes enfants pour dire que si je devais être un jour gravement dépendante, je souhaitais bénéficier du suicide assister en Suisse ». Comme elle venait de me raconter qu’elle s’était occupée pendant de nombreuses années de sa mère atteinte de maladie d’Alzheimer, je lui dis : « Avez-vous trouvé pénible toute cette période où vous vous êtes occupé de votre mère dans son état de grande dépendance ? ». Elle me répondit : « Oh non, pas du tout ! Cela a été des moments particulièrement forts où nous avons pu nous dire des choses très importantes. Et j’ai été très triste de sa mort. Oh, non, je ne regrette pas toutes ces années passées avec elle à m’en occuper, même si parfois, il y avait des moments plus difficiles ». Alors je lui ai répondu : « Et donc vous souhaitez priver vos enfants de la possibilité de vous exprimer leur affection si un jour vous deviez être malade ? ». Et j’ai rajouté : « Vous savez, c’est souvent dans les derniers moments de la vie que l’on transmet à nos proches les messages les plus forts, les lumières qui ont guidées notre vie et qui peuvent aider les plus jeunes de la famille à trouver le sens de la leur. Parfois, c’est en voyant le courage et le sourire plein d’affection d’une grand-mère bien fragilisée par ses handicaps que l’on comprend que toute vie vaut le coup d’être vécue. L’amour est plus fort que toutes les pauvretés humaines et transfigure des situations extrêmes. Mon expérience est que l’on reçoit énormément des personnes handicapées, et souvent beaucoup plus qu’on ne donne ». La consultation s’est arrêtée là et j’ai revu cette femme quelques semaines plus tard pour les résultats de ses examens. Elle m’a dit à la fin de la consultation : « Vous savez, je voulais vous remercier de ce que vous m’avez dit la dernière fois. J’ai déchiré la lettre que j’avais écrite et cela m’a complètement libérée intérieurement. J’ai failli faire une grosse bêtise ».
Le grand âge : une chance
Personnellement, aucune personne dépendante ne m’apparait comme un poids pour la société, mais plutôt comme une chance de développer une plus grande inventivité dans l’amour. Les personnes âgées sont porteuses d’un sens de la gratuité, de la tendresse et d’une vraie sagesse de vie dotée de toutes sortes d’expériences humaines qui nous ramènent sans cesse à l’essentiel, à ce qui demeure par-delà les plus grandes difficultés de la vie. Vivre un moment de rencontre gratuite avec une personne âgée nous enrichis et nous rend meilleurs. Peut-être ne peuvent-elles plus « rien faire », mais dans l’ordre de l’être, elles nous donnent en surabondance. Tout l’art est de voir non pas ce qu’elles ne sont plus (ce qui serait de la fausse pitié), mais de voir ce qu’elles sont toujours : des personnes dignes de respect et d’estime.
J’ai été très touchée par de très belles rencontres. En voici une parmi d’autres. Un jour, je recevais en consultation une vieille femme atteinte de maladie de Parkinson. Elle ne pouvait plus marcher et m’avait été amenée dans un fauteuil coquille par les ambulanciers. Je devais tester sa mémoire, mais en voyant qu’elle était à moitié endormie dans son fauteuil, je me suis demandé comment j’allais pouvoir m’y prendre… Une fois installée en face du bureau, je lui ai dit : « Bonjour madame, comment allez-vous ? ». Elle ouvrit un œil et me dit : « Bof, dans cet état, je me demande bien à quoi je peux servir ». Désolée de ce qui lui arrive, je réponds : « Et le moral dans tout cela ? ». Elle me dit : « Bof, je passe mes journées à chasser les mauvaises pensées ». Je lui réponds : « Ah c’est beau cela ! Tout le monde ne passe pas son temps à chasser les mauvaises pensées ! ». Elle ouvre les deux yeux et me regarde. Je m’aperçois que son visage est rempli d’une immense paix. Il était très pacifiant pour moi qui la regardais. Je lui dis : « Je vois qu’il y a beaucoup de paix sur votre visage. Vous devez faire immensément de bien autour de vous dans votre maison de retraite. Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui n’ont pas la paix du cœur, même parmi les soignants. Vous devez faire beaucoup de bien à ceux qui vous approchent ». A ce moment précis, elle s’est mise à sourire. C’était comme si, en un instant, elle avait retrouvé le sens de sa vie. Cela m’a beaucoup touché car en retrouvant l’utilité de son existence, elle a instantanément retrouvé la joie. Elle est repartie toute heureuse de la consultation.
Comme vous voyez, parfois il ne faut pas grand-chose pour aider une personne âgée dépendante à retrouver le sens de sa vie. Ne les privons pas de cette période de leur existence où elles peuvent nous offrir le meilleur d’elle-même, la quintessence de leur de vie.
Et les plus grands malades ?
Même les malades d’Alzheimer nous donnent plus que nous ne pouvons imaginer. Certes ils ont besoin qu’on leur rappelle maintes et maintes fois la même chose, et parfois des troubles du comportement peuvent les rendre difficiles à vivre au quotidien. Mais à d’autres moments, ils nous font goûter le meilleur de leur cœur. Ils ont une intelligence du cœur qui leur permet toujours de comprendre jusqu’à un certain point le vrai d’une situation. Ils gardent la liberté d’accepter ou de refuser un soin selon que l’aide-soignante s’occupe d’eux avec douceur ou bien qu’elle les brusque. Ils ont un langage du cœur qui transparait dans leurs gestes de tendresse. Ainsi cette femme malade qui me frottait les mains pour les réchauffer parce qu’elle les trouvait froides. Une infirmière m’a raconté qu’un jour, elle n’allait pas bien car elle vivait une situation personnelle difficile. En arrivant ce jour-là au travail, elle ne se sentait pas la force de commencer son service. Elle s’est rendue dans une chambre au fond du service. C’était celle d’une malade d’Alzheimer. Elle s’est mise accroupie auprès d’elle et a penché sa tête sur la poitrine de la vieille femme en lui disant : « Vous savez, je ne vais pas bien, il faut que vous me consoliez ». Et la vieille dame l’a serrée sur son cœur. L’infirmière racontait qu’en quelques instants toute sa tristesse s’est évanouie et qu’elle a pu débuter sa journée comme si de rien était. Elle venait de vivre comme une véritable guérison intérieure grâce à ce geste d’affection d’une malade d’Alzheimer.
Aussi, je vous en supplie, laissez vivre ceux qui ont tant à nous apporter ! Ils nous apprennent ou réapprennent le vrai sens de la vie. Ils nous gardent dans l’humilité et nous enseignent le chemin du cœur.

 Curé de Saint-Cyr-l’École (Yvelines) et animateur du Padreblog, l’abbé Grosjean a lu l’entretien accordé par Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique et organisateur des états généraux de la bioéthique, à Valeurs actuelles la semaine dernière. Opposé à l’« idéologie relativiste assumée » du “monsieur éthique” du gouvernement, il réagit dans une « Tribune » du même organe de presse:
Curé de Saint-Cyr-l’École (Yvelines) et animateur du Padreblog, l’abbé Grosjean a lu l’entretien accordé par Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique et organisateur des états généraux de la bioéthique, à Valeurs actuelles la semaine dernière. Opposé à l’« idéologie relativiste assumée » du “monsieur éthique” du gouvernement, il réagit dans une « Tribune » du même organe de presse: 
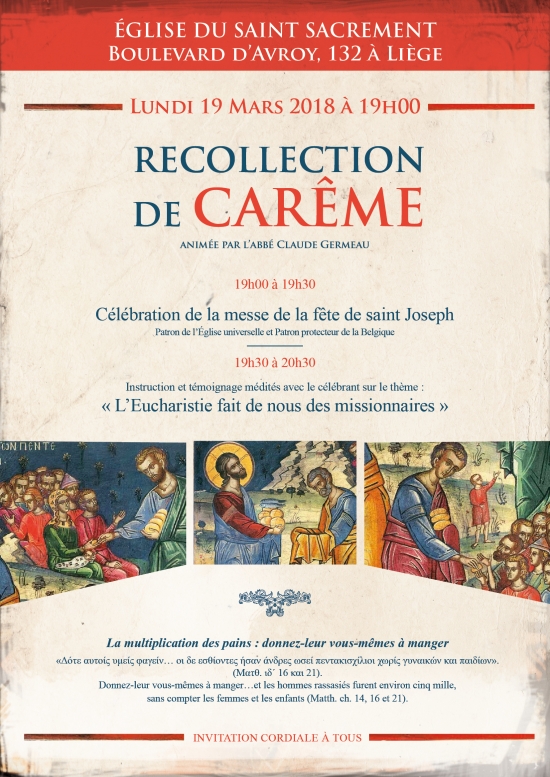
 Dans la Lettre aux évêques qui accompagne le Motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet 2007, Benoît XVI estime que « les deux formes d’usage du rite romain peuvent s’enrichir réciproquement ». Dans l’intention du pape, la réintroduction, dans le cadre paroissial, du missel promulgué par saint Jean XXIII, devrait susciter une émulation liturgique de telle sorte que chaque forme intègre certains aspects positifs de l’autre. Dans un message adressé aux organisateurs des dix-huitièmes rencontres liturgiques de Cologne (29 mars-1er avril 2017), le cardinal Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, a repris à son compte ce thème de l’enrichissement mutuel des formes rituelles. Trois questions.
Dans la Lettre aux évêques qui accompagne le Motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet 2007, Benoît XVI estime que « les deux formes d’usage du rite romain peuvent s’enrichir réciproquement ». Dans l’intention du pape, la réintroduction, dans le cadre paroissial, du missel promulgué par saint Jean XXIII, devrait susciter une émulation liturgique de telle sorte que chaque forme intègre certains aspects positifs de l’autre. Dans un message adressé aux organisateurs des dix-huitièmes rencontres liturgiques de Cologne (29 mars-1er avril 2017), le cardinal Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, a repris à son compte ce thème de l’enrichissement mutuel des formes rituelles. Trois questions.