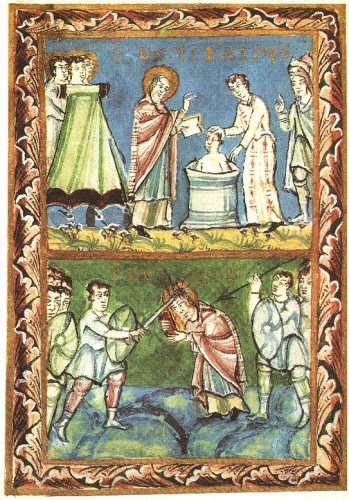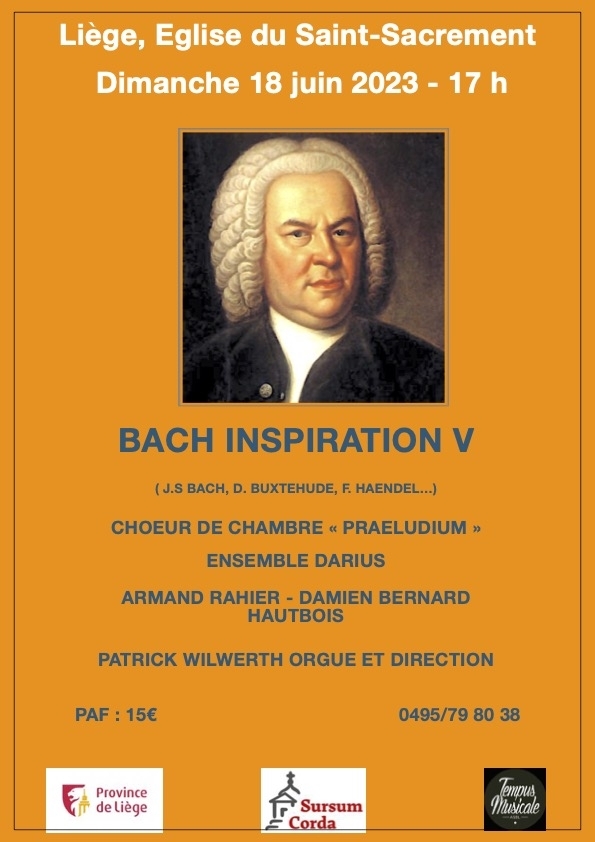De Tommaso Scandroglio sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana :
Cancer, coûts élevés, solitude : les données choquantes sur l'avortement
14-06-2023
L'Observatoire (italien) permanent de l'avortement présente son deuxième rapport sur les coûts et les effets sanitaires de l'IVG. Et les données sont choquantes : aujourd'hui, 30% des femmes avortent avec le RU486, mais le nombre total d'IVG ne diminue pas ; avec l'avortement chimique, les avortements sont de plus en plus pratiqués seuls, mais le taux de mortalité est 12 fois plus élevé et parmi les complications, il y a une corrélation étroite entre le cancer du sein et les avortements. Et les coûts ? Depuis 1978, il y a eu 5,8 millions d'avortements pour un coût de 5 milliards pour l'État. Si cette somme avait été investie aujourd'hui, nous aurions une capitalisation nette de 12 milliards.
Lors d'une conférence de presse tenue au Sénat de la République, l'Observatoire permanent de l'avortement (Opa) a présenté le 2e rapport sur les coûts et les effets sur la santé de la loi 194.
Quelques données ressortent des rapports des invités. Le Dr Stefano Martinolli, directeur médical de l'hôpital de Trieste et vice-président de l'Opa, a expliqué que l'avortement par RU486 représente aujourd'hui 30% de l'ensemble des avortements et que "l'on estime que dans les cinq prochaines années, environ 50% des avortements seront pharmacologiques". En effet, de nombreuses "justifications" émergent pour l'utilisation préférentielle de cette procédure : moindre coût en termes de séjour à l'hôpital, moindre invasivité, approche plus attrayante et moins traumatisante. Nos recherches montrent que ces justifications sont totalement infondées". Il ajoute que les différentes pilules abortives deviennent de plus en plus populaires - un demi-million rien qu'en 2020 - provoquant un effet migratoire de l'avortement : de l'avortement chirurgical à l'avortement chimique. Une myriade de crypto-avortements précoces qui échappent aux calculs officiels du ministère de la Santé.
Ainsi le rapport : "En 2020, le nombre total de boîtes vendues de Norlevo (pilule du lendemain) et d'ellaOne (pilule du surlendemain) a dépassé le demi-million, soit près du double du chiffre de 2014. En supposant un taux de 25 % de cas où la pilule provoque l'interruption d'une grossesse dès son début, ce qui est extrêmement conservateur par rapport aux preuves scientifiques, on obtient un nombre d'avortements potentiels allant d'environ 15 000 à 30 000 entre 2014 et 2019". Ces avortements doivent donc être ajoutés aux chiffres officiels. Une fois cet ajout effectué, le pourcentage d'avortements ne diminue pas, comme l'indiquent le ministère et les médias, mais reste stable : "Le pourcentage d'interruptions volontaires de grossesse corrigées en tenant compte de l'utilisation de la contraception d'urgence est stable tout au long de la période 2014-2020, s'établissant à partir de 2017 à plus de 17 %, un pourcentage qui, selon les données officielles, n'aurait été enregistré qu'avant 2006, année de l'introduction du Norlevo en Italie".