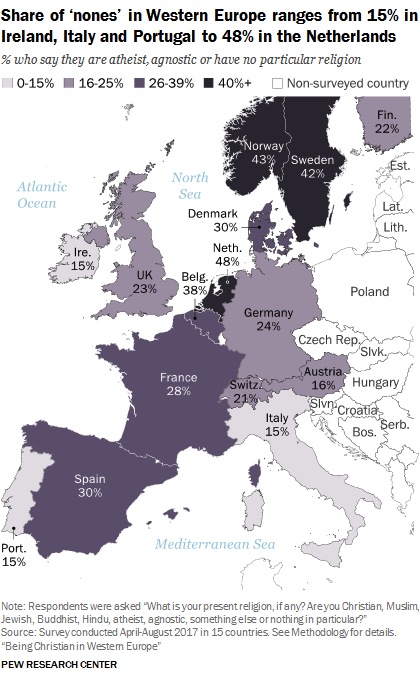Dans un post publié le 21 juin dernier et intitulé "Migrations : l'inéluctabilité des faits", nous exposions quelques données qui, à nos yeux, rendent inévitable le déferlement migratoire en provenance de l'Afrique; cet article de Bernard Lugan publié ici le confirme de façon plus argumentée :
La vérité sur l’Afrique. Ses conséquences sur l’Europe
Les actuelles arrivées de migrants africains en Europe constituent les prémices d’un phénomène massif qui va connaître une amplification considérable dans les prochaines décennies.
Laissons parler les chiffres :
- Avec un taux de croissance de 4% la population africaine double tous les 18-20 ans.
- Au Niger, pays désertique où le taux de fécondité est de 7 enfants par femme, la population était de 3 millions d’habitants en 1960 et elle sera de 40 millions en 2040, puis de 60 millions en 2050.
- En Somalie, le taux de reproduction est de 6,4 enfants par femme et en RDC, il est de 6,1.
- En Algérie le programme de planification familiale avait permis de faire baisser l’indice synthétique de fécondité de 4,5 enfants par femme en 1990, à 2,8 en 2008. Or, avec la réislamisation du pays, depuis 2014, il a rebondi à 3,03.
Résultat :
- D’ici à 2030, l’Afrique va voir sa population passer de 1,2 milliard à 1,7milliard, avec plus de 50 millions de naissances par an.
- En 2100, avec plus de 3 milliards d’habitants, le continent africain abritera 1/3 de la population mondiale, dont les trois quarts au sud du Sahara.
Pour des centaines de millions de jeunes africains, la seule issue pour tenter de survivre sera alors l’émigration vers l’Europe.
Bloqués par leurs pré-supposés idéologiques et moraux, les dirigeants européens qui s’obstinent à ne pas tenir compte de cette réalité, ont choisi de s’accrocher au mythe du « développement ». En France, des Insoumis au Front national, tous défendent ainsi -certes à des degrés divers-, le postulat du développement ralentisseur migratoire. Et tous sont dans l’erreur.
Comme je l’ai expliqué dans mon livre « Osons dire la vérité à l’Afrique », le développement de l’Afrique est en effet une illusion et parfois même une escroquerie intellectuelle et politique.
Pour deux grandes raisons :
1) A supposer qu’il ait une efficacité, le « développement » ne pourrait en effet avoir que des résultats à très long terme. Or, il y a urgence.
2) Tout a déjà été tenté en ce domaine depuis les indépendances, il y a plus de six décennies de cela. En vain car, en dépit des sommes abyssales déversées pour tenter de la faire « démarrer », l’Afrique régresse.
Loin de se développer, l’Afrique s’appauvrit globlement année après année
Selon les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000 par 189 Etats, aucun recul de la pauvreté africaine ne peut être envisagé sans un minimum de croissance annuelle de 7% soutenue durant plusieurs années.
Conclusion : comme il faut une croissance de 7% par an pour simplement commencer à réduire la pauvreté, le calcul est vite fait, année après année, il manque donc à l’Afrique entre 3 et 4% de croissance pour atteindre l’objectif des OMD.
Donc, loin de se combler, la pauvreté africaine augmente et cela d’autant plus inexorablement que la démographie galopante y efface les quelques gains de croissance.
Comment prétendre développer l’Afrique quand les investisseurs s’en détournent ?
Le discours politique répétitif est l’appel à l’investissement « moteur du développement », mais comme les investisseurs n’investissent pas en Afrique, nous restons donc dans le domaine incantatoire.
Dans son rapport de mai 2018, la BAD (Banque africaine de développement) souligne ainsi que pour les investissements dans le seul domaine des infrastructures, l’Afrique a besoin annuellement de 170 milliards de dollars d’IED (Investissements étrangers directs), alors que, au total de tous ses postes, elle n’en reçoit que 60 mds.
Début juin 2018, à la lecture du rapport sur les IED publié par la CNUCED (CNUCED, World Investment Report 2017), nous apprenons qu’en 2017, sur les 2000 milliards (mds) de dollars d’IED mondiaux, l’Afrique n’en recueillit en effet que 60 mds, un volume dérisoire en baisse de 3% par rapport à 2016 (Banque mondiale).
L’Afrique, dans l’ensemble de la globalité de ses 54 pays et de son 1,2 milliard d’habitants a donc reçu presque autant d’IED que Singapour (61,6 mds pour 6 millions d’habitants), et moins que l’Irlande (79,2 mds pour 5 millions d’habitants)…
Voilà qui en dit plus que les longs discours lénifiants sur le devenir de l’Afrique et sur son « développement »…
Une chose est donc certaine, le credo du « développement » ne freinera pas le déversement du surplus démographique africain sur l’Europe.
Comment en serait-il d’ailleurs autrement alors que rien ne peut être entrepris sans un strict contrôle des naissances que les Africains refusent d’envisager et que l’Europe n’est pas en mesure de leur imposer ?
Vue d’outre-Méditerranée, l’Europe continuera donc d’être considérée comme une terre à prendre. D’autant plus facilement qu’elle est peuplée de vieillards repus ou épuisés, d’hommes s’interrogeant sur leur virilité, de femmes n’enfantant plus et dont les dirigeants sont soumis au diktat permanent de l’émotionnel …
Bernard Lugan
Lire également : Si, la démographie c'est le destin de l'Afrique et de l'Europe