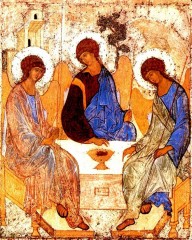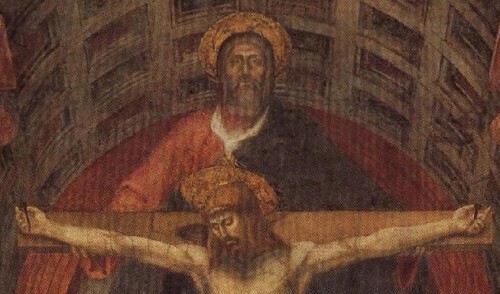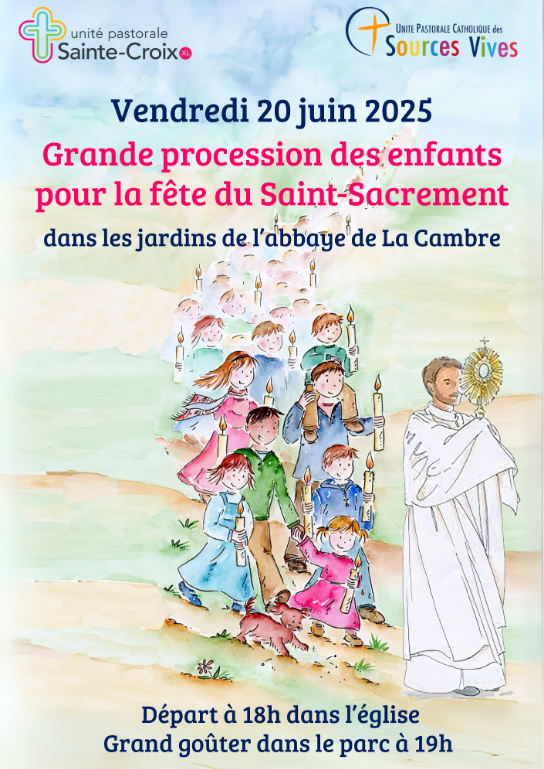1. « Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance » (Ps 71, 5). Ces paroles jaillissent d'un cœur accablé par de graves difficultés : « Tu m'as fait voir tant de maux et de détresses » (v. 20), dit le psalmiste. Malgré cela, son âme est ouverte et confiante, car elle est ferme dans la foi, qui reconnaît le soutien de Dieu et le professe : « Ma forteresse et mon roc, c'est toi » (v. 3). De là jaillit la confiance inébranlable que l'espérance en Lui ne déçoit pas : « En toi, Seigneur, j'ai mon refuge : garde-moi d'être humilié pour toujours » (v. 1).
Dans les épreuves de la vie, l'espérance est animée par la certitude ferme et encourageante de l'amour de Dieu répandu dans les cœurs par l'Esprit Saint. C'est pourquoi elle ne déçoit pas (cf. Rm 5, 5) et saint Paul peut écrire à Timothée : « Si nous nous donnons de la peine et si nous combattons, c’est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant » (1 Tm 4, 10). Le Dieu vivant est en effet le « Dieu de l'espérance » (Rm 15, 13) qui dans Christ, par sa mort et sa résurrection, est devenu « notre espérance » (1 Tm 1, 1). Nous ne pouvons pas oublier que nous avons été sauvés dans cette espérance dans laquelle nous devons rester enracinés.
2. Le pauvre peut devenir témoin d'une espérance forte et fiable, justement parce qu'il la professe dans des conditions de vie précaires, faites de privations, de fragilité et d'exclusion. Il ne compte pas sur les certitudes du pouvoir et des biens ; au contraire, il les subit et en est souvent victime. Son espérance ne peut reposer qu'ailleurs. En reconnaissant que Dieu est notre première et unique espérance, nous accomplissons nous aussi le passage entre les espérances éphémères et l'espérance durable. Face au désir d'avoir Dieu comme compagnon de route, les richesses sont relativisées car découvrant le véritable trésor dont nous avons réellement besoin. Les paroles avec lesquelles le Seigneur Jésus exhortait ses disciples résonnent clairement et avec force : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler » (Mt 6, 19-20).
3. La plus grande pauvreté consiste à ne pas connaître Dieu. C'est ce que nous rappelait le Pape François lorsqu'il écrivait dans Evangelii gaudium : « La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. L'immense majorité des pauvres ont une ouverture particulière à la foi ; ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas manquer de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi » (n° 200). Il y a là une conscience fondamentale et tout à fait originale de la manière de trouver en Dieu son trésor. L'apôtre Jean insiste en effet : « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas » (1 Jn 4, 20).
C'est une règle de la foi et un secret de l'espérance : tous les biens de cette terre, les réalités matérielles, les plaisirs du monde, le bien-être économique, bien qu'importants, ne suffisent pas à rendre le cœur heureux. Les richesses sont souvent trompeuses et conduisent à des situations dramatiques de pauvreté, à commencer par celle de penser que l'on n'a pas besoin de Dieu et de mener sa vie indépendamment de Lui. Les paroles de saint Augustin me reviennent à l'esprit : « Que toute ton espérance soit en Dieu : sens que tu as besoin de Lui pour être comblé par Lui. Sans Lui, tout ce que tu auras ne servira qu'à te rendre encore plus vide » (Enarr. in Ps. 85,3).
4. L'espérance chrétienne à laquelle renvoie la Parole de Dieu est une certitude sur le chemin de la vie, car elle ne dépend pas de la force humaine, mais de la promesse de Dieu qui est toujours fidèle. C'est pourquoi, depuis les origines, les chrétiens ont voulu identifier l'espérance au symbole de l'ancre, qui offre stabilité et sécurité. L'espérance chrétienne est comme une ancre qui fixe notre cœur sur la promesse du Seigneur Jésus qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection et qui reviendra parmi nous. Cette espérance continue à indiquer comme véritable horizon de la vie les « cieux nouveaux » et la « terre nouvelle » (2 P 3, 13), où l'existence de toutes les créatures trouvera son sens authentique, car notre véritable patrie est dans les cieux (cf. Ph 3, 20).
La cité de Dieu nous engage donc pour les cités des hommes. Celles-ci doivent dès maintenant commencer à lui ressembler. L'espérance, soutenue par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint (cf. Rm 5, 5) transforme le cœur humain en terre féconde, où peut germer la charité pour la vie du monde. La Tradition de l'Église réaffirme constamment cette circularité entre les trois vertus théologales : la foi, l'espérance et la charité. L'espérance naît de la foi qui la nourrit et la soutient sur le fondement de la charité, qui est la mère de toutes les vertus. Et c'est de charité que nous avons besoin aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas une promesse mais une réalité vers laquelle nous regardons avec joie et responsabilité : elle nous engage et oriente nos décisions vers le bien commun. Celui qui manque de charité, en revanche, non seulement manque de foi et d'espérance, mais enlève l'espérance à son prochain.
5. L'invitation biblique à l'espérance comporte donc le devoir d'assumer sans tarder des responsabilités cohérentes dans l'histoire. En effet, la charité « représente le plus grand commandement social » (Catéchisme de l'Église catholique, 1889). La pauvreté a des causes structurelles qui doivent être affrontées et éliminées. Pendant ce temps, nous sommes tous appelés à créer de nouveaux signes d'espérance qui témoignent de la charité chrétienne, comme l'ont fait tant de saints et saintes à travers les âges. Les hôpitaux et les écoles, par exemple, sont des institutions créées pour accueillir les plus faibles et les plus marginaux. Ils devraient désormais faire partie des politiques publiques de chaque pays, mais les guerres et les inégalités l'empêchent encore souvent. De plus en plus, les foyers d'accueil, les communautés pour mineurs, les centres d'écoute et d'accueil, les cantines pour les pauvres, les dortoirs, les écoles populaires deviennent aujourd'hui des signes d’espérance : autant de signes souvent cachés auxquels nous ne prêtons peut-être pas attention mais qui sont pourtant si importants pour secouer l'indifférence et susciter l'engagement dans différentes formes de volontariat !
Les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église, ils sont nos frères et sœurs les plus aimés, car chacun d'eux, par son existence et aussi par les paroles et la sagesse dont il est porteur, nous invite à toucher du doigt la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi la Journée mondiale des pauvres veut rappeler à nos communautés que les pauvres sont au centre de toute l'œuvre pastorale. Non seulement en son aspect charitable, mais également en ce que l'Église célèbre et annonce. Dieu a pris leur pauvreté pour nous rendre riches à travers leurs voix, leurs histoires, leurs visages. Toutes les formes de pauvreté, sans exception, sont un appel à vivre concrètement l'Évangile et à offrir des signes efficaces d'espérance.
6. Telle est l'invitation qui nous est faite par la célébration du Jubilé. Ce n'est pas un hasard si la Journée mondiale des pauvres est célébrée vers la fin de cette année de grâce. Lorsque la Porte Sainte sera fermée, nous devrons garder et transmettre les dons divins qui ont été déversés dans nos mains tout au long d'une année de prière, de conversion et de témoignage. Les pauvres ne sont pas des objets de notre pastorale, mais des sujets créatifs qui nous poussent à trouver toujours de nouvelles façons de vivre l'Évangile aujourd'hui. Face à la succession de nouvelles vagues d'appauvrissement, le risque est de s'habituer et de se résigner. Nous rencontrons chaque jour des personnes pauvres ou démunies et il arrive parfois que ce soit nous-mêmes qui ayons moins, qui perdions ce qui nous semblait autrefois sûr : un logement, une alimentation suffisante pour la journée, l'accès aux soins, un bon niveau d'éducation et d'information, la liberté religieuse et d'expression.
En promouvant le bien commun, notre responsabilité sociale trouve son fondement dans le geste créateur de Dieu, qui donne à tous les biens de la terre : comme ceux-ci, les fruits du travail de l'homme doivent également être accessibles à tous de manière équitable. Aider les pauvres est en effet une question de justice avant d'être une question de charité. Comme le fait remarquer saint Augustin : « Tu donnes du pain à celui qui a faim, mais il vaudrait mieux que personne n'ait faim, même si cela signifie qu'il n'y aurait personne à qui donner. Tu offres des vêtements à celui qui est nu, mais combien il serait préférable que tous aient des vêtements et qu'il n'y ait pas cette indigence » (Commentaire sur 1Jn, VIII, 5).
Je souhaite donc que cette Année jubilaire puisse encourager le développement de politiques de lutte contre les formes anciennes et nouvelles de pauvreté, ainsi que de nouvelles initiatives de soutien et d'aide aux plus pauvres parmi les pauvres. Le travail, l'éducation, le logement, la santé sont les conditions d'une sécurité qui ne s'affirmera jamais par les armes. Je me félicite des initiatives déjà existantes et de l'engagement quotidien au niveau international d'un grand nombre d'hommes et de femmes de bonne volonté.
Confions-nous à la Très Sainte Vierge Marie, Consolatrice des affligés, et avec elle, élevons un chant d'espérance en faisant nôtres les paroles du Te Deum : «In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum – En toi, Seigneur, j'ai espéré, je ne serai jamais confondu »
Du Vatican, le 13 juin 2025, mémoire de saint Antoine de Padoue, Patron des pauvres
LEO PP. XIV