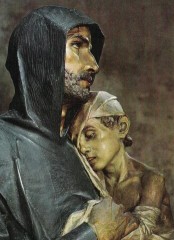De sur le CWR :
Ce qui est requis face à la tentation et aux épreuves
Réflexion biblique sur les lectures du dimanche 9 mars 2025, premier dimanche du Carême

• Dt 26, 4-10
• Ps 91, 1-2.10-11.12-13.14-15
• Rm 10, 8-13
• Lc 4, 1-13
« Toute l’histoire de la Tentation est mal comprise », a écrit Monseigneur Ronald Knox, « si nous ne reconnaissons pas qu’il s’agissait d’une tentative de Satan pour découvrir si notre Seigneur était le Fils de Dieu ou non. »
En écrivant ainsi, il fait écho à de nombreux Pères de l’Église, qui se sont demandé ce que Satan savait et ce qu’il souhaitait accomplir en tentant Jésus dans le désert. Saint Éphrem le Syrien a écrit : « Il tenta Jésus parce qu’un signe certain de la divinité du Christ n’avait pas encore été donné du ciel. » Oui, a noté Éphrem, Satan était au courant du baptême de Jésus, mais pensait que la véritable identité de Jésus ne pouvait être connue qu’après qu’il ait été mis à l’épreuve dans un combat spirituel, par la tentation.
C’est un point qui mérite d’être médité en ce premier dimanche de Carême pour trois raisons : la tentation révèle la nature de notre ennemi, elle révèle la réalité de notre situation et elle révèle l’identité des fils et des filles de Dieu.
L'ennemi a de nombreux noms, dont Belzébul, le malin, le chef des démons et de ce monde, le serpent et le tentateur. Il n'est ni une métaphore ni un mythe, mais une créature réelle, un ange déchu. Le pape Paul VI, lors d'une audience intitulée « Confronter le pouvoir du diable » (15 novembre 1972), a déclaré que refuser de reconnaître l'existence du diable ou de l'expliquer comme « une pseudo-réalité, une personnification conceptuelle et fantaisiste des causes inconnues de nos malheurs » constitue un rejet complet de l'Écriture et de l'enseignement de l'Église.
Ironiquement, le refus de tant de personnes – y compris de nombreux catholiques – d’admettre la véritable identité du diable est en soi un sombre triomphe pour le grand trompeur.
Le nom « diable » vient du mot grec diabolos (latin diabolus ), qui signifie « calomniateur » ou « accusateur ». Il cherche à accuser et à calomnier chacun de nous devant Dieu dans son désir incessant de détruire les âmes. Ce faisant, il a un certain avantage, à savoir que, par nos propres mérites, nous n’avons aucune défense réelle contre ses accusations. La réalité de notre situation est flagrante : nous sommes des pécheurs qui cédons souvent à la tentation et, ce faisant, nous devenons les sujets du souverain de ce monde.
Ce fait est inhérent aux quarante jours de Jésus dans le désert. Son séjour dans le désert était une reconstitution délibérée des quarante années d’errance des Israélites dans le désert. Mais alors que les Israélites échouaient à plusieurs reprises à obéir à Dieu, à lui faire confiance et à l’adorer, Jésus surmonta les tentatives du diable de le faire désobéir, se méfier et renier Dieu. « Au cœur des tentations », note le pape Benoît XVI dans Jésus de Nazareth , « comme nous le voyons ici, se trouve le fait de mettre Dieu de côté parce que nous le percevons comme secondaire, voire superflu et ennuyeux, par rapport à toutes les questions apparemment bien plus urgentes qui remplissent nos vies. »
Nous sommes rarement tentés de nier catégoriquement l’existence de Dieu ou de le maudire publiquement. Nous sommes plutôt tentés de remplacer progressivement Dieu, le bien suprême, par des biens moindres : la nourriture, le confort, la sécurité, les biens matériels et la position sociale. Les gens passent rarement du statut de chrétien à celui d’athée en quelques jours ou semaines. Comme le souligne Benoît XVI, le diable est tout aussi content lorsque nous demandons à Dieu de satisfaire nos désirs que lorsque nous le rejetons complètement. En fin de compte, les deux ne sont pas si différents, surtout lorsqu’il s’agit de détruire la vie de la grâce.
« Mais Jésus avait un avantage, protestent certains : il est Dieu ! » Or, tous ceux qui sont baptisés dans le Christ ont revêtu le Christ (cf. Rm 6). Nous sommes enfants de Dieu parce que, par l’œuvre de Jésus, nous sommes remplis de l’Esprit Saint. L’épître d’aujourd’hui énonce ce qui est exigé face à la tentation et à l’épreuve : confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l’a ressuscité des morts.
En affrontant l’ennemi et en rejetant la tentation, Jésus s’est révélé. Le Carême est pour nous l’occasion de faire de même, au nom et par la puissance du Seigneur.
(Cette chronique « Ouvrir la Parole » est parue initialement dans l’édition du 21 février 2010 du journal Our Sunday Visitor .)