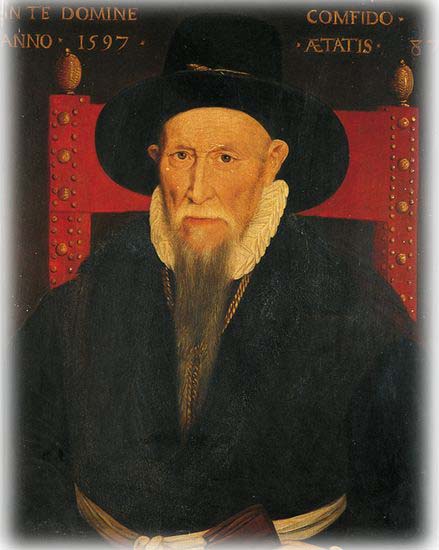Du site d'information religieuse "Présence" (Canada) :
Un évêque congolais dénonce l’indifférence envers les massacres au Nord-Kivu
Agence Catholic News Service
Un évêque congolais demande une action internationale pour endiguer les massacres dans son diocèse et accuse le gouvernement et les médias du pays d'être indifférents aux souffrances actuelles.
«L'année dernière encore, au moins un millier de personnes ont été tuées ici – cela dure depuis une décennie, et la situation s'est détériorée en une chaîne de massacres», a déclaré l'évêque Melchisedech Sikuli Paluku de Butembo-Beni dans la province du Nord-Kivu au Congo.
«J'appelle la communauté internationale à entendre le cri de souffrance de mon pays et à aider ses pauvres gens. Compte tenu du calvaire que nous avons été contraints de subir pendant si longtemps, nous nous sentons abandonnés.»
L'évêque a lancé cet appel dans une vidéo distribuée le 14 janvier par la branche allemande de l'organisme Aide à l'Église en détresse, alors qu'une délégation d'évêques congolais et étrangers entamait une visite de six jours.
Dans un commentaire, Aide à l'Église en détresse a déclaré que le Nord-Kivu, riche en ressources, avait été en proie aux Forces démocratiques alliées, un mouvement rebelle de l'Ouganda voisin dirigé par un chrétien converti à l'islam qui avait déclaré son affiliation à Daech.
Elle a ajouté que les forces congolaises et les troupes d'une mission de stabilisation de l'ONU forte de 18 000 hommes n'avaient pas réussi à pacifier l'«épicentre de la violence» autour de Beni, alimentant ainsi la plus longue crise humanitaire d'Afrique.
«Les médias de notre pays n'en parlent guère, voire pas du tout, alors que tout ce qui intéresse nos hommes politiques est de savoir comment partager le gâteau du pouvoir», a déclaré Mgr Sikuli Paluku dans son message vidéo, qui comprenait des scènes de violence récentes.
«Malgré tout, nous devons espérer que les choses s'améliorent et que l'État fasse à l'avenir de plus grands efforts pour mettre fin à ces massacres.»
La délégation de la conférence des évêques congolais et de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale a commencé sa tournée des diocèses de Butembo-Beni, Bunia et Goma le 15 janvier et organisera des prières et des messes pour la paix et la justice, selon les médias locaux.
Cependant, lors des dernières atrocités, 15 femmes et enfants auraient été tués à coups de machette par des combattants des Forces démocratiques alliées dans un camp le 13 janvier, tandis qu'au moins 40 autres ont trouvé la mort lors des attaques des militants près de Beni le 31 décembre.
Dans une homélie prononcée le 3 janvier à la cathédrale, Mgr Sikuli Paluku a annoncé une «campagne de solidarité» pour aider les personnes déplacées par la violence, qui comprendra des collectes pour Caritas.
«Certaines paroisses sont déjà presque vides d'habitants», a déclaré l'évêque à Radio Moto Butembo-Beni le 4 janvier.
«Cela signifie que nous avons maintenant plus de personnes déplacées qu'il y a un mois. Il est important qu'en plus des prières, nous fassions aussi bouger les choses. Ce sont nos frères et sœurs, et le partage est une exigence pour chaque chrétien.»
L'Église catholique est depuis longtemps impliquée dans les efforts de paix au Congo, où environ 5 millions de personnes ont été déplacées par les combats dans l'est du pays, plus de 900 000 ayant cherché refuge dans les pays voisins et un demi-million de plus à l'intérieur du pays, selon les données de 2020 du HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.


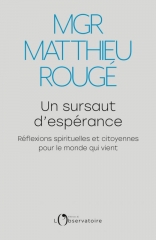 C’est le titre d’un ouvrage de réflexions spirituelles et citoyennes que cet évêque adresse au monde qui vient. Il est interrogé ici par les Eveilleurs . Dans cet entretien de 35 mn, diffusé par le site « Riposte catholique » , il revient notamment sur les conséquences de la crise sanitaire, notamment sur le confinement qui a isolé nos aînés et qui nous a fait oublier que nous n’étions pas seulement un corps, mais aussi un cœur et une âme. Il lance un vibrant message d’espérance et appelle les chrétiens à un renouveau de leur Foi. Que jamais ils ne se laissent envahir par la peur, la crainte et la culture de la mort, mais qu’ils s’ouvrent pleinement à la beauté de la Vie et qu’ils s’engagent à la défendre et à la protéger….
C’est le titre d’un ouvrage de réflexions spirituelles et citoyennes que cet évêque adresse au monde qui vient. Il est interrogé ici par les Eveilleurs . Dans cet entretien de 35 mn, diffusé par le site « Riposte catholique » , il revient notamment sur les conséquences de la crise sanitaire, notamment sur le confinement qui a isolé nos aînés et qui nous a fait oublier que nous n’étions pas seulement un corps, mais aussi un cœur et une âme. Il lance un vibrant message d’espérance et appelle les chrétiens à un renouveau de leur Foi. Que jamais ils ne se laissent envahir par la peur, la crainte et la culture de la mort, mais qu’ils s’ouvrent pleinement à la beauté de la Vie et qu’ils s’engagent à la défendre et à la protéger…. Matthieu Rougé est le fils d'un père haut fonctionnaire et d'une mère collaboratrice particulière de
Matthieu Rougé est le fils d'un père haut fonctionnaire et d'une mère collaboratrice particulière de  Communiqué publié ce jour par les représentants de l’Eglise catholique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19 et ses avatars:
Communiqué publié ce jour par les représentants de l’Eglise catholique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19 et ses avatars: