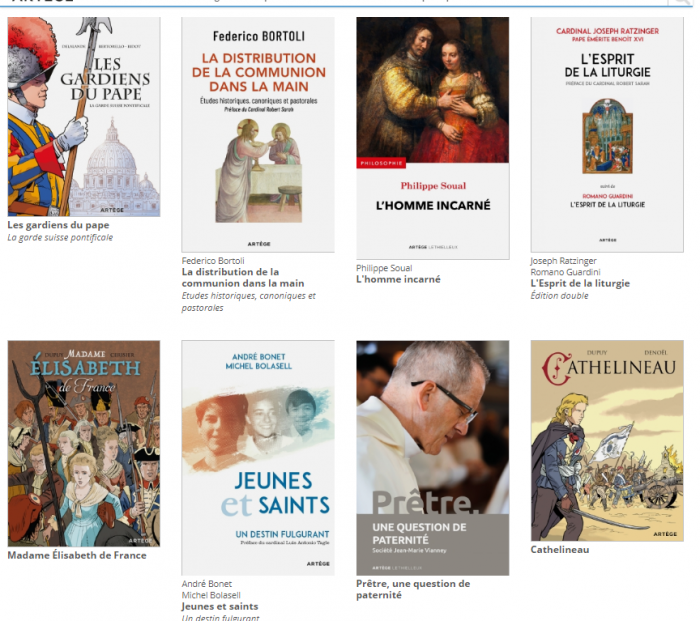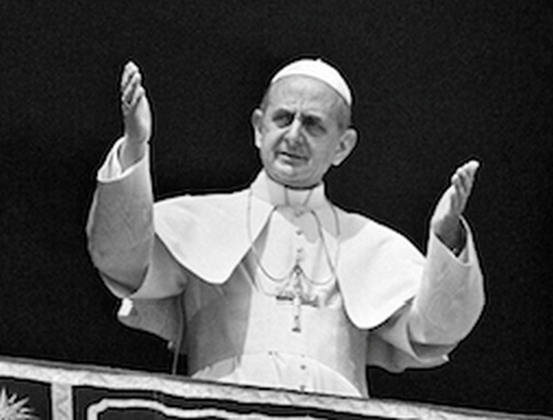De Youna Rivallain sur le site de l'hebdomadaire La Vie :
Une seconde vie pour les crucifix
20/11/2019

Amaury Rheinart acquiert des croix pour en faire des objets d'art. Une façon de "se positionner en tant que chrétien". © Johanna de Tessières/ Collectif Huma
À Bruxelles, un jeune étudiant en école de commerce court les brocantes pour racheter des crucifix, qu'il rénove avant de les revendre pour leur donner un nouveau foyer.
Un matin d'automne, sur le marché aux puces des Marolles, à Bruxelles. Au milieu des badauds, Amaury Rheinart enjambe les cartons de bric et de broc. Comme tous les dimanches, ce grand gaillard de 20 ans est à la recherche de crucifix sur les stands des exposants. Son but : en récupérer, en réparer et en rénover le plus grand nombre possible et les confier à des foyers, pour aider ces derniers à prier. Il y a quelques mois, Amaury Rheinart a même lancé son site web, Crucifix Constantin, pour mettre en valeur ses créations originales simples et colorées.
Un déclic né chez les scouts
« L'idée m'est venue en plusieurs fois », nous confie l'étudiant en école de commerce. Pendant une veillée scoute, il est d'abord touché par le témoignage d'une dame profondément attachée à la figure du Sacré-Coeur. « Dès qu'elle en voyait une représentation dans une brocante ou chez un antiquaire, elle l'achetait aussitôt. » Deuxième élément déclencheur : en 2017, un responsable des Scouts d'Europe invite ces derniers à être des « garants de notre patrimoine religieux ». « Il nous a exhortés à restaurer les calvaires de campagne, à enlever le lierre qui les recouvre. »
J'ai voulu me positionner en tant que chrétien.
Pour Amaury Rheinart, c'est le déclic. Grand amateur de brocantes, surtout depuis qu'il est en stage dans la ville de Bruxelles, il retrouve sans cesse de vieux crucifix, parfois abîmés, à même le sol. « Pour moi, c'est le symbole du monde d'aujourd'hui, qui délaisse l'image du Christ. J'ai voulu me positionner en tant que chrétien. » Un dimanche d'août 2019, sans aucune formation artistique, Amaury Rheinart se lance : avec 20 € en poche, il part à la pêche aux crucifix dans le bazar à ciel ouvert du marché des Marolles. Après d'âpres négociations, il en achète cinq. La semaine suivante, il profite d'une pause déjeuner pour courir acheter de la peinture (le turquoise, le rouge et le jaune, ses trois couleurs de signature), et emprunte quelques outils. C'est le début du projet Constantin - du nom du premier empereur à avoir autorisé le culte chrétien.
« Volonté missionnaire »
Après avoir poncé, réparé, repeint et verni chaque croix, il propose à ses acheteurs de dédier le crucifix à une intention particulière. « Au début, je leur demandais de prier pour les intentions du brocanteur qui m'a vendu l'objet. Mais c'était difficile, pour certains, de prier pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. » Désormais, Amaury Rheinart demande à chacun de ses « clients » de choisir lui-même l'intention, et lui propose aussi de prier pour ceux qui délaissent le Christ dans leur grenier ou leur cave.
Je trouve beau que des crucifix qui ont été sauvés de la poubelle puissent encore porter une intention.
Au-delà de la simple acquisition d'un joli objet, « c'est une manière d'engager l'acheteur dans une volonté missionnaire et dans une dynamique plus large de prière ». Luciano Legros, étudiant, a découvert le projet Constantin via les réseaux sociaux. « Je ne voulais pas acheter une croix neuve dans une boutique, j'avais envie de mettre du sens dans ma démarche. » Il a choisi une croix peinte en rouge, et l'a dédiée aux martyrs du XXIe siècle. « Je trouve beau que des crucifix qui ont été sauvés de la poubelle puissent encore porter une intention. » Chaque création Constantin est vendue entre 12 et 33 €. « Mon but n'est pas de gagner de l'argent, explique Amaury Rheinart, mais de rénover le plus d'objets religieux possible. » Tous les bénéfices servent donc à acquérir de nouvelles trouvailles sur les marchés aux puces... pour illuminer le plus grand nombre de maisons.