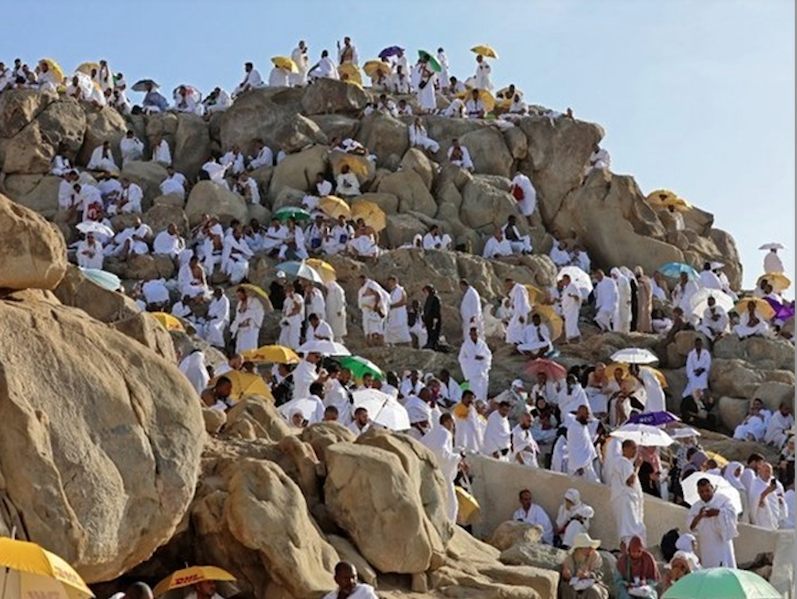De Riccardo Cascioli sur la Nuova Bussola Quotidiana :
La Chine n'est pas fiable, mais pour le Vatican l'accord doit être renouvelé
Pour le cardinal Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican, l'accord secret avec la Chine doit être renouvelé. Et cette fois, il doit être définitif. Ni les violations de l'accord par Pékin, ni la persécution croissante des catholiques qui ne se plient pas au Parti, y compris à Hong Kong, ne comptent.
25_04_2024
Le Saint-Siège a l'intention de renouveler l'accord secret conclu avec la Chine en 2018 et renouvelé ensuite tous les deux ans. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, en répondant par écrit à une question du correspondant de LifeSiteNews à Rome, Michael Haynes.
L'accord expire en octobre et, a déclaré le cardinal Parolin, "nous espérons le renouveler". Et à cet égard, a-t-il ajouté, "nous dialoguons avec nos interlocuteurs sur ce point".
Sur la volonté du Saint-Siège d'aller de l'avant malgré le manque de fiabilité du régime communiste chinois, il n'y a pas de doute, compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées au cours des six dernières années ; mais la déclaration du secrétaire d'État du Vatican n'en est pas moins importante. Certes, il reste encore plusieurs mois avant qu'une décision officielle ne soit prise, mais après deux renouvellements de deux ans, le dernier mot sur l'accord est attendu cette année : soit il devient définitif, soit il est abandonné.
Et tout laisse supposer qu'à moins d'un coup de théâtre, on va vers le définitif : le Saint-Siège a déjà tout accepté - y compris l'inacceptable - pour en arriver là ; le gouvernement chinois n'a qu'à gagner dans ces conditions, car il peut procéder à l'anéantissement de l'Église catholique avec l'aval du Vatican.
La question ne concerne pas seulement la nomination des évêques, qui - le Saint-Siège l'a toujours dit - est le thème central de l'accord secret, mais le processus de sinisation de l'Église catholique que le régime poursuit depuis au moins 2015 et qui devient de plus en plus étouffant et s'étend maintenant à l'Église de Hong Kong.
Même si trois évêques ont été nommés plus tôt cette année - Thaddeus Wang Yuesheng pour Zhengzhou, Anthony Sun Weniun pour le nouveau diocèse de Weifang, Peter Wu Yishun pour la préfecture apostolique de Shaowu - avec l'approbation du pape et donc formellement selon les accords Chine-Vatican, en substance, il semble clair que le mécanisme fonctionne comme suit : le régime communiste décide et le pape donne son assentiment.
En outre, même si nous voulons considérer la nomination des trois évêques avec l'accord du Vatican comme un fait positif, l'application de cette partie de l'accord ne met pas du tout fin à la persécution des prêtres et des évêques qui n'acceptent pas la subordination au parti communiste : Par exemple, début janvier, presque en même temps que les trois nominations épiscopales mentionnées ci-dessus, Monseigneur Peter Shao Zhumin, évêque de Wenzhou, non reconnu par le gouvernement, a été arrêté pour la énième fois, coupable de ne pas vouloir adhérer à l'Association patriotique des catholiques chinois (APCC), l'instrument utilisé par le régime pour "guider" l'Eglise catholique. Mais ces épisodes ne sont pas à prendre en compte, de même que les divers obstacles mis à la participation aux célébrations eucharistiques.
Mais l'aspect le plus pertinent est le fait que le régime chinois, pour tout acte concernant l'Église catholique, ne mentionne jamais le Saint-Siège et le Pape, et encore moins les accords. Un aspect bien mis en évidence par un article récent et éclairant du père Gianni Criveller, missionnaire du PIME et directeur éditorial d'Asia News. C'est ce qui se passe lors de l'annonce des nominations d'évêques, mais "le silence sur le rôle de Rome" est encore plus évident dans le "Plan quinquennal pour la sinisation du catholicisme en Chine (2023-2027)", approuvé le 14 décembre dernier par la Conférence des évêques catholiques et l'Association patriotique (organismes tous deux sous le contrôle du Parti communiste).
Comprenant l'équivalent de 3 000 mots, divisé en quatre parties et 33 paragraphes, le Plan, précise le Père Criveller, "ne mentionne jamais le Pape et le Saint-Siège, ni l'accord conclu entre le Vatican et la Chine. Au contraire, le dirigeant Xi Jinping est mentionné quatre fois. Cinq fois, il est répété que le catholicisme doit prendre des 'caractéristiques chinoises'. Le mot "sinisation" est le plus important : il revient pas moins de 53 fois. La sinisation signifie évidemment la subordination totale de l'Église aux directives du Parti communiste.
Ce n'est pas seulement une question de fréquence des mots, ce qui est significatif, c'est "la fermeté et le langage péremptoire". "Comme s'il n'y avait pas eu, écrit le Père Criveller, de dialogue et de rapprochement avec le Saint-Siège ; comme si la reconnaissance accordée par le Pape à tous les évêques chinois n'avait servi à rien ; comme s'il n'y avait pas eu d'accord entre le Saint-Siège et la Chine qui donne au monde l'impression que le catholicisme romain a trouvé en Chine hospitalité et citoyenneté".
Face à cette attitude du régime chinois, qui n'en fait évidemment qu'à sa tête, qui envisage la soumission totale de l'Eglise aux directives et aux exigences du Parti communiste, la position de la Secrétairerie d'Etat du Vatican apparaît incompréhensible.
L'art de la diplomatie, qui doit procéder même à petits pas, est une chose ; c'en est une autre que de sacrifier la vérité et les fidèles catholiques à des logiques essentiellement politiques. Il est évident que pour maintenir vivante la possibilité d'un accord avec le régime chinois, le Saint-Siège et le Pape se taisent depuis des années sur l'escalade de la persécution anticatholique en Chine, sans un mot pour les catholiques de Hong Kong, qui sont de plus en plus dans le collimateur, notamment grâce à la nouvelle et infâme loi sur la sécurité nationale (voir ici et ici). Rappelons qu'à Hong Kong, l'évêque émérite, le cardinal Joseph Zen, a été arrêté et est toujours en procès, tandis que depuis trois ans, l'homme d'affaires catholique (converti) Jimmy Lai, éditeur d'un quotidien critique à l'égard de Pékin (aujourd'hui fermé), purge une lourde peine de prison et risque même la prison à vie dans un autre procès en cours.
La raison d'État ne peut justifier ce silence scandaleux qui condamne à la persécution les évêques, les prêtres et les laïcs fidèles à l'Église. Des évêques, des prêtres et des laïcs qui ont déjà payé cher leur fidélité à l'Église et qui se voient aujourd'hui abandonnés même par Rome. La détermination avec laquelle le cardinal Parolin - qui a le soutien total du pape sur ce point - conduit le Saint-Siège à embrasser le régime communiste est inquiétante. Et les conséquences ne concernent pas seulement l'Église chinoise.