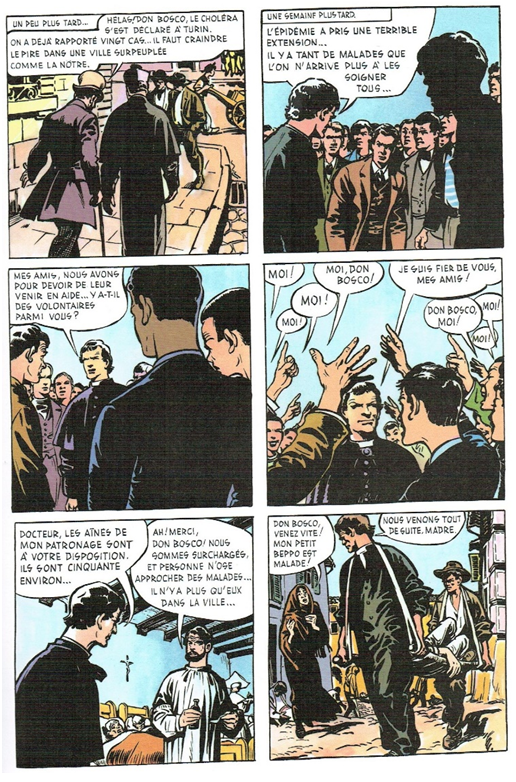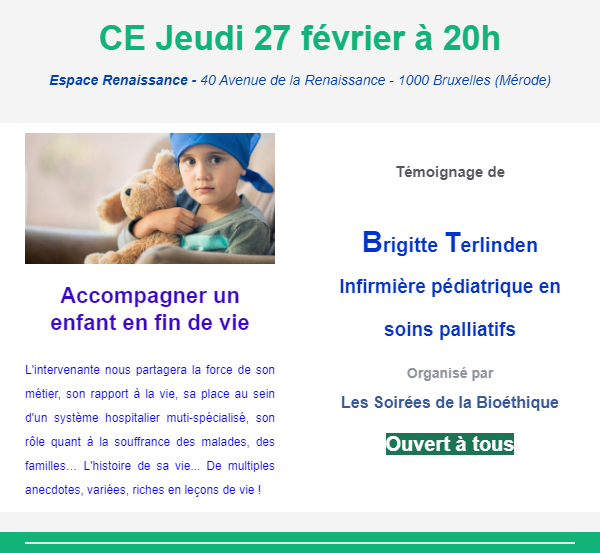D'Antoine Pasquier sur le site de Famille Chrétienne
7 vidéos cathos à ne pas louper en période de confinement
23/03/2020
Depuis le début du confinement, le frère Paul-Adrien d’Hardemare s’est lancé dans une série de vidéos intitulée : « Du Carême à la quarantaine, guide de survie pour les parents ». ©DR
Sérieuses, philosophiques ou complètement décalées, voici sept vidéos pour regarder – enfin – des trucs intelligents sur internet en période de confinement.
1. « Jour de Guerre » un peu zinzin au couvent des Dominicains
Les Dominicains de Nancy sont-ils tombés sur la tête ? Depuis le début du confinement, le frère Paul-Adrien d’Hardemare s’est lancé dans une série de vidéos intitulée : « Du Carême à la quarantaine, guide de survie pour les parents ». Avec des décors surréalistes et des effets spéciaux à gogo, le religieux décline ses conseils pour chaque « jour de guerre » passé : communion spirituelle pour les ados, repli tactique en cas de coup dur, programme TV… Des vidéos complétement décalées mais très sérieuses sur le fond… à voir sans les enfants ! Le dominicain s’est même livré à une petite parodie de la très officielle allocution télévisée d’Emmanuel Macron.
2. Quelles nouvelles chères sœurs ?
Dans le même genre, les Soeurs Coopératrices Paroissiales du Christ Roi, basées dans la Drôme, ont réalisé une courte vidéo humoristique intitulée : « C’est gentil de prendre des nouvelles ». Mais les religieuses ne font pas que rire. Elles savent aussi rendre service et utiliser leur talent de couturières pour confectionner des masques pour l’hôpital de Valence.
3. La peste ou le corona ? Du Fabrice Hadjadj tout craché !
Faute de pouvoir faire ses cours habituels, l’inénarrable Fabrice Hadjadj ouvre une série d’interventions en ligne sur sa chaîne Youtube. Son nom ? « Penser entre la peste et le corona ». Le premier épisode s’intitule « #Epidémio-logiques ». Mais le philosophe ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Se souvenant de la manière dont des jeunes gens se réunissaient dans un château pour se raconter des histoires lors de la grande peste de 1348 à Florence, Fabrice Hadjadj a pris sa guitare pour composer une chanson prophylactique au temps du corona…
4. L’Eglise est-elle sainte ? A la suite du père de Menthière
Sans public, le père Guillaume de Menthière poursuit ses conférences de Carême sur le thème « L’Eglise vraiment sainte ? ». Après Abraham, Pierre et Marie, le prêtre parisien s’intéresse cette 4e semaine de Carême à l’Eglise de Paul. Notre Eglise est-elle la même que celle du foudroyé du chemin de Damas ?
5. Coronavirus, qui est coupable ? Mgr Aupetit sans langue de bois
L’homélie très incisive de Mgr Michel Aupetit, dimanche 22 mars à Saint-Germain L’Auxerrois. « Dans le contexte actuel d’une pandémie mondiale nous avons besoin d’en comprendre le sens. « Allons bon : qui est coupable ? ». Nous voyons bien que tous les fléaux qui affectent les humains sont la plupart du temps la conséquence de leurs actes. C’est évident bien sûr pour les guerres dans lesquelles nous nous entre-tuons. Mais c’est aussi vrai maintenant pour les cyclones et les tempêtes, ces catastrophes dites « naturelles », dont on sait qu’elles viennent de plus en plus du réchauffement climatique qui n’est que la conséquence de la mauvaise gestion de la planète et de l’égoïsme des pays les plus riches. De même, ce coronavirus, apparu en Chine, dans un marché où l’on n’hésite pas à vendre des animaux sauvages dans des conditions scandaleuses pour satisfaire la virilité déficiente des vieux lubriques montre l’incurie des hommes – et la responsabilité, entre parenthèse, d’un régime qui a fait du mensonge un mode de gouvernement : ce qui a retardé une saine réaction sanitaire. Bref, il n’est pas besoin de chercher très loin pour trouver un coupable de toutes ces folies. Mais ce n’est pas la question du jour ».
6. Ce n’est pas la première fois que les chrétiens sont confinés…
A la demande de la paroisse de Poissy, l’historien Christophe Dickès, spécialiste du catholicisme, explique en trois petites vidéos de cinq minutes l’origine et l’histoire des églises domestiques. « Si nous sommes confinés à cause du coronavirus, ce n’est pas la première fois que des chrétiens sont obligés de rester chez et de pratiquer leur foi sous leur toit ».
7. Révisez votre philo avec François-Xavier Bellamy
Ses interventions publiques n’étant plus possibles, le philosophe François-Xavier Bellamy met en libre-service une partie de ses conférences données dans le cadre de son association Philia. Chaque jour, une nouvelle conférence sera publiée en podcast audio et vidéo. Trois sont d’ores et déjà accessibles : le réel existe-t-il ? Pourquoi est-il si compliqué d’être simple ? et la science peut-elle tout connaître ? Idéal pour faire réviser les lycéens !
Une dernière pour la route…
Vous pouvez retrouver toutes les vidéos « Trois minutes en vérité » de Famille Chrétienne sur notre chaîne Youtube. Des témoignages forts comme ceux d’Asia Bibi, Blanche Treb ou encore le père Amar. Sans oublier de nombreux anonymes : musulmans convertis, franc-maçon passé à la foi chrétienne
Antoine Pasquier