Du site des Missions Etrangères de Paris :
Selon Mgr Aphong Nguyen Huu Long, évêque de Vinh, le Vietnam, riche en vocations, peut s’adapter face aux épreuves
07/05/2020
Dimanche dernier, le 3 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations, Mgr Aphong (Alphonse) Nguyen Huu Long, évêque de Vinh, dans le nord du Vietnam, a pu échanger avec des jeunes catholiques vietnamiens en appelant à répondre à l’appel de Dieu avec « toute notre liberté, notre foi et notre générosité ». L’évêque de Vinh, responsable de la Commission pour l’évangélisation de la Conférence des évêques du Vietnam pour la période 2019-2022, a assuré que l’Église au Vietnam, riche en vocations, pouvait adapter l’évangélisation pour dépasser les épreuves et se tourner vers l’avenir, à l’image des Martyrs du Vietnam et des missionnaires vietnamiens.

À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations, le dimanche 3 mai, Mgr Anphong (Alphonse) Nguyen Huu Long, évêque de Vinh, a pu échanger avec des jeunes vietnamiens, en leur confiant que « tout le monde reçoit une mission du Seigneur ». « Nous pouvons choisir la vie religieuse ou le mariage ; on répond à la volonté de Dieu avec toute notre liberté, notre foi et notre engagement sincère », a-t-il ajouté. Mgr Huu, ordonné évêque par le pape François le 22 décembre 2018, a été assigné au diocèse de Vinh le 1er février 2019. Il est responsable de la Commission pour l’évangélisation de la Conférence épiscopale vietnamienne pour la période 2019-2022. « Toutes les vocations sont nobles, à condition de discerner ce à quoi Dieu vous appelle », a poursuivi l’évêque. En s’adressant à de jeunes prêtres et religieux, il a souligné « la beauté de la vocation au sacerdoce et à la vie religieuse, c’est qu’ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais avec Dieu pour les autres [Rm 14, 7-9] ». « Et en même temps, par toute leur vie, ils honorent Dieu et recherchent le Salut des autres », a-t-il ajouté. Selon plusieurs études menées par l’Église catholique, les vocations religieuses et sacerdotales restent nombreuses au Vietnam. Cette abondance n’est certes pas spontanée, mais résulte d’un certain nombre de facteurs, comme une atmosphère familiale, amicale et sociale favorable.
5 000 prêtres, 5 000 séminaristes et 33 000 religieux et religieuses
Le développement des vocations fait partie des domaines les plus préoccupants pour l’Église ; mais avec un plus grand nombre de vocations s’accompagne aussi le besoin de se concentrer d’autant plus sur la qualité de la formation. À l’exemple des Martyrs du Vietnam, beaucoup de catholiques ont rencontré des difficultés et sont morts pour leur foi. Les vocations se sont multipliées, et la trace des missionnaires vietnamiens est discernable partout. Le Programme catholique vietnamien d’intégration culturelle (Giao Trinh Hoi Nhap Van Hoa Cong Giao Viet Nam) montre qu’en 2019, l’Église catholique au Vietnam comptait environ 7 millions de fidèles, soit près de 7 % de la population, pour 5 000 prêtres et plus de 5 000 séminaristes. Selon les chiffres de la Commission religieuse de la Conférence des évêques du Vietnam, début 2019, l’Église locale comptait 307 congrégations et associations religieuses pour 33 087 membres, dont 28 099 religieuses et 4 988 religieux, et 1 670 religieux ordonnés prêtres. De nombreux religieux et religieuses vietnamiens sont également partis à l’étranger. Beaucoup de prêtres vietnamiens remarquent que « l’Église catholique vietnamienne envoie des vocations dans les autres pays », en particulier aux États-Unis où l’on compte 950 prêtres vietnamiens.
Certains de ces prêtres appartiennent à des congrégations comme Dong Cong, qui compte une centaine de membres. D’autres sont rédemptoristes, Missionnaires du Verbe Divin, jésuites ou dominicains… Certains évêques vietnamiens sont eux aussi partis à l’étranger, comme Mgr Vincent Nguyen Van Long en Australie, Mgr Vincent Nguyen Man Hieu au Canada, Mgr Toma Nguyen Thai Thanh aux États-Unis, et Mgr Pierre Nguyen Van Tot, ancien nonce apostolique au Sri Lanka. « Au début, beaucoup de prêtres et religieux vietnamiens partis en mission à l’étranger ont rencontré de nombreuses difficultés, pour des résultats qui n’étaient pas à la hauteur de leurs espérances », explique Mgr Huu. « L’une des plus grandes barrières rencontrées était notamment celle de la langue. Mais tous sont parvenus à dépasser cette première épreuve. » Pour Mgr Huu, « pour renouveler l’évangélisation au Vietnam, le pape François a recommandé, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium [La joie de l’Évangile], de regarder vers l’avenir ». « Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire, aux domaines que nous pouvons développer, et à des façons d’adapter l’évangélisation à la période que nous traversons au Vietnam », a-t-il souligné.
(Avec Asianews, Hanoï)


 « L'Église en Tanzanie aura bientôt un nouveau séminaire. Le grand séminaire de Nazareth doit ouvrir ses portes en octobre prochain dans le diocèse de Kahama. Le projet est à l'étude depuis un certain temps par la Conférence épiscopale pour faire face à l'explosion des vocations sacerdotales dans le pays.
« L'Église en Tanzanie aura bientôt un nouveau séminaire. Le grand séminaire de Nazareth doit ouvrir ses portes en octobre prochain dans le diocèse de Kahama. Le projet est à l'étude depuis un certain temps par la Conférence épiscopale pour faire face à l'explosion des vocations sacerdotales dans le pays.

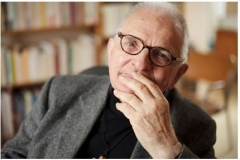 Dans la nuit de Pâques, dimanche dernier 12 avril 2020, le Père jésuite André Manaranche nous a quittés à l’âge de 93 ans, emporté par l’épidémie de coronavirus.
Dans la nuit de Pâques, dimanche dernier 12 avril 2020, le Père jésuite André Manaranche nous a quittés à l’âge de 93 ans, emporté par l’épidémie de coronavirus. 
