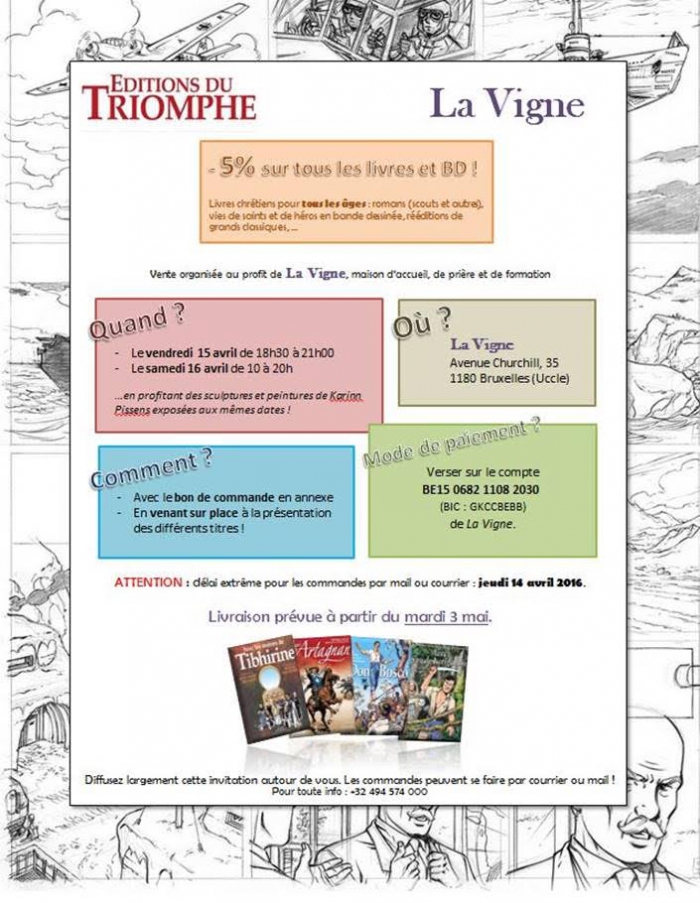Livres - Publications - Page 130
-
Bruxelles, 15-16 avril, pour les fêtes et communions : vente de livres et BD au profit de La Vigne
-
Sarkozy, le pape et la laïcité « positive » : seulement la pêche aux voix ?
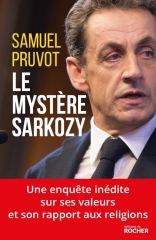 Samuel Pruvot est journaliste à Famille chrétienne. Il publie aux éditions du Rocher, Le mystère Sarkozy, un livre documenté sur le rapport ambigu de l'ancien président de la république à la spiritualité. Nicolas Sarkozy s'est entretenu lundi avec le pape François. Cette rencontre doit-elle nous surprendre? Réponse de Samuel Pruvot sur le site « Figarovox »:
Samuel Pruvot est journaliste à Famille chrétienne. Il publie aux éditions du Rocher, Le mystère Sarkozy, un livre documenté sur le rapport ambigu de l'ancien président de la république à la spiritualité. Nicolas Sarkozy s'est entretenu lundi avec le pape François. Cette rencontre doit-elle nous surprendre? Réponse de Samuel Pruvot sur le site « Figarovox »: "SAMUEL PRUVOT: Il y a quelque chose de notable au niveau du protocole. Si le pape reçoit en audience privée des chefs d'État, il s'agit en général de personnalités en exercice. Le même jour que Nicolas Sarkozy, le grand-duc Henri de Luxembourg figure par exemple à l'agenda officiel. A ce titre, cette visite fait exception. Nicolas Sarkozy est accueilli comme chef de l'opposition dans un contexte tendu avec le gouvernement socialiste français. Depuis 2015 en effet, le poste d'ambassadeur français auprès du Saint-Siège est vacant. Le candidat soutenu par François Hollande aurait été écarté pour son homosexualité supposé. Et la situation risque d'être figée jusqu'en 2017.
Du côté de Nicolas Sarkozy, l'idée d'une rencontre avec le pape François n'est pas neuve. La demande était dans les tuyaux depuis 2013. Le fait qu'elle se déroule aujourd'hui, alors que les candidats de la primaire à droite se rangent en ordre de bataille, constitue évidement un bon point pour lui. Aucun concurrent - pas même François Fillon qui en a fait la demande - ne pourra faire valoir «une photo avec le pape.»
FIGAROVOX : Savez-vous ce que pense l'ex-président de la République de l'actuel évêque de Rome?
Par delà le bénéfice politique supposé de l'opération, il y a sans doute une vraie curiosité de Nicolas Sarkozy vis-à-vis du pape François. Le président de LR apprécie les personnalités qui bousculent l'ordre établi. Les réformateurs et plus encore les prophètes qui agissent au nom de leur foi. Il admire la parole franche du pape François dont la popularité internationale résiste à l'épreuve du temps. Mais, à dire vrai, celui qu'il respecte par-dessus tout, c'est paradoxalement le pape émérite. Leurs profils psychologiques sont évidemment aux antipodes. Mais quand j'ai interrogé Nicolas Sarkozy pour mon livre, il m'a clairement fait comprendre qu'il cherchait à revoir Joseph Ratzinger. «L'ermite» de Rome. Il a été fasciné par sa finesse spirituelle et son envergure intellectuelle. Plus encore par la manière dont il a renoncé à sa charge et à tous les honneurs.
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Livres - Publications, Politique, Religions, Société 0 commentaire -
Entretien avec le cardinal Burke : une profonde réforme de l’Église est nécessaire
Propos recueillis par Philippe Maxence et publié sur le site du bi-mensuel « L’Homme Nouveau » le 17 mars 2016 dans Religion
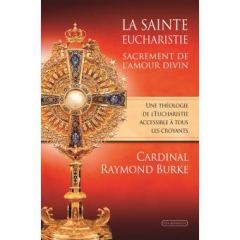 "À l’occasion de la publication en langue française de La Sainte Eucharistie, sacrement de l’amour divin, du cardinal Raymond L. Burke, L'Homme Nouveau a rencontré celui-ci à Rome pour évoquer avec lui l’urgence de retrouver la pleine conscience de la doctrine sur l’eucharistie, fondement d’une véritable réforme de l’Église plus que jamais indispensable.
"À l’occasion de la publication en langue française de La Sainte Eucharistie, sacrement de l’amour divin, du cardinal Raymond L. Burke, L'Homme Nouveau a rencontré celui-ci à Rome pour évoquer avec lui l’urgence de retrouver la pleine conscience de la doctrine sur l’eucharistie, fondement d’une véritable réforme de l’Église plus que jamais indispensable.Éminence, vous avez considéré comme très important de publier un commentaire approfondi des deux documents sur l’eucharistie des pontificats précédents,Ecclesia de Eucharistia de Jean-Paul II, etSacramentum Caritatis de Benoît XVI. Pensez-vous donc que le plus grand des sacrements soit méconnu par les chrétiens d’aujourd’hui ?
Nous constatons actuellement un réel affaiblissement dans le rapport des chrétiens à la sainte eucharistie. Pour beaucoup, cette situation tient à la faiblesse de la catéchèse qui a été dispensée à ce sujet depuis cinquante ans. Il y a donc maintenant plusieurs générations qui ne comprennent pas bien la grande réalité du Saint Sacrement. Des études montrent que plus 50 % des catholiques ne croient plus dans la Présence réelle de Jésus dans l’eucharistie. Or cet article de notre foi est comme la perle de la foi catholique. Face à cette situation proprement dramatique, le pape Jean-Paul II avait déjà voulu réagir. À la fin de son pontificat, il a tout fait pour restaurer la foi dans l’eucharistie et supprimer les abus liturgiques qui ont créé la confusion et entraîné souvent une perte de la foi.
Faiblesse de la catéchèse depuis cinquante ans, dites-vous. Que faudrait-il entreprendre aujourd’hui comme action pour remédier à cette situation ?
Je verrais une action dans trois directions.
La première catéchèse à entreprendre est la célébration de la sainte liturgie elle-même. Elle doit être restaurée dans sa propre dignité, non seulement en ce qui concerne la célébration du prêtre, mais également pour la participation des fidèles qui doit être digne, en fonction justement du profond mystère qui est célébré. Mais allons plus loin : la disposition du sanctuaire, les vêtements liturgiques utilisés, le linge d’autel, la musique sacrée doivent chacun à sa place, selon son rôle et son symbole, attirer l’attention de tous vers le Créateur, dans cette rencontre entre le Ciel et la terre. Car de quoi s’agit-il à la messe ? Du fait que réellement le Christ Jésus, assis à la droite du Père, descend sur l’autel de l’Église pour réitérer sous un mode sacramentaire son sacrifice du calvaire. Vous comprenez pourquoi l’Histoire nous montre que même les peuples les plus pauvres ont souvent tout fait pour bâtir l’église la plus belle possible ou les plus lumineux des vitraux. Ils souhaitaient que chaque élément de l’église témoigne de la suprême réalité de l’Eucharistie.
-
Regards chrétiens sur la culture : lancement d'un nouveau blog
Lancement de http://critiquesdepresse.com/
Regards chrétiens sur la culture
http://critiquesdepresse.com/ offre des regards chrétiens sur la culture. Ces regards chrétiens sur la culture proviennent des critiques et des recensions publiées dans les médias chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants), de médias non confessionnels qui critiquent ou recensent la culture chrétienne, de blogs chrétiens, de blogs non chrétiens parlant de culture ou encore de contributeurs sélectionnés par nos soins.
Nous employons le terme de « culture » pour désigner la réflexion sur la culture ou les parties de la culture : cinéma, livre, BD, télé, exposition, peinture, sculpture, théâtre…
Quatre avantages à http://critiquesdepresse.com/ :
- L’internaute est aidé dans son jugement et dans son achat en trouvant ici les meilleures critiques chrétiennes sur la culture
- L’acteur de la culture (éditeur, exposant, cinéaste, peintre…) voit ainsi rassemblées les meilleures critiques chrétiennes le concernant
- Le média d’origine dévoile la pertinence de ses critiques et invitent à naviguer sur son site. Mieux, les articles publiés sur notre blog renvoient très souvent sur le site d’origine. Sa critique n’est donc pas « volée » mais mise en valeur
- Les VIP Contributeurs peuvent proposer leurs articles et critiques
Il s’agit donc d’un blog très qualitatif qui sélectionne les critiques selon un critère simple : l’acuité de la recension. En effet, il n’est pas très intéressant de reproduire une critique qui ne fait que reprendre la « page 4 » - ce qui parfois, malheureusement, arrive.
Nous sommes déjà partenaires avec Virginie Larousse (Le Monde des Religions), Françoise Caron (Associations Familiales Protestantes), François Vercelletto (Ouest France), Laurent Dandrieu (Valeurs Actuelles), Artège, EDB, France Catholique, Ed. Nouvelle Cité, Radio Notre Dame, Yves Viollier (La Vie), AED, diocèse de Vendée, diocèse d’Alsace,journalchretien.net, CineRegards, Dominique Greiner (La Croix), chretiensdegauche, La Nef, Pierre Téqui éditeur, Enseignement Catholique Actualités, Cinecure.be, Eglise d’Asie MEP, éditions du Centurion…
-
Quel type de politique peut et doit être menée au nom de Jésus ?
Lu sur le blog de Denis Sureau "Chrétiens dans la Cité" :
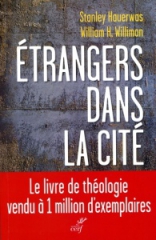 Etrangers dans la cité : l'Eglise comme alternative politique
Etrangers dans la cité : l'Eglise comme alternative politiqueDans leur livre à succès Étrangers dans la cité, que les Éditions du Cerf ont eu l’excellente idée de traduire en français aux (288 pages, 19 €), et dont l’édition américaine aurait été vendue à un million d’exemplaires, deux théologiens américains protestants mais plutôt « crypto-catholiques » – Stanley Hauerwas et William H. Willimon – réveillent vigoureusement les chrétiens, défiant les catégories habituelles.
Quel type de politique « peut et doit être menée au nom de Jésus » ? (p. 43). Saint Paul déclare : « notre citoyenneté est dans les cieux » (Ph 3,20). Pour Hauerwas et Willimon, l’Église est une communauté visible, une nouvelle polis, une structure sociale contre-culturelle, pérégrine, et les chrétiens des exilés résidant en terre étrangère. Elle « incarne une alternative sociale qui n’est pas réductible à la logique du monde ». (56)
L’effondrement d’une certaine culture chrétienne (chrétienté constantinienne) entre 1960 et 1980 oblige de se poser de vraies questions. « Le travail du théologien n’est pas d’ajuster l’Évangile au monde moderne, mais d’ajuster le monde moderne à l’Évangile. » (64)
La théologie protestante libérale a conduit les chrétiens à des compromis moraux avec un pouvoir immoral (solution finale, Hiroshima, Dresde, avortement…). La gauche comme la droite « avancent des solutions comme si le monde n’avait pas fini et commencé en Jésus. » (69) Dans les années 60, les pasteurs poussaient les chrétiens à s’engager en politique, à soutenir la démocratie tout en lui « rajoutant une vague coloration religieuse », oubliant qu’elle a pour objet premier l’individu soucieux de la satisfaction de ses désirs et revendiquant ses droits, ceux-ci étant garantis par l’État omnipotent.
Lien permanent Catégories : Doctrine Sociale, Eglise, Foi, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -
"Veilleur, où en est la nuit ?"
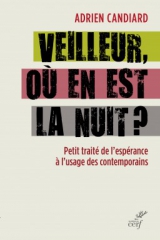 Veilleur, où en est la nuit ? by Koz
Veilleur, où en est la nuit ? by KozRien n’est moins chrétien que de serrer sans fin dans ses bras le cadavre de la vieille chrétienté : il faut laisser les morts enterrer leurs morts, et regarder le monde en face. Jérusalem est tombée, et ses murailles ne seront pas reconstruites.
C'est dire s'il ne faut pas lire ce livre en quête d'un édredon ouaté, d'un propos rassurant à bon compte sur l'avenir du pays et des chrétiens. Nous ne manquons pas de trouver les moyens d'écarter la froide réalité statistique qui, pourtant, nous éclate au visage. Nous invoquons, et cela recèle, je le crois, tout de même, une part de vérité, la qualité des vocations, l'authenticité de la pratique dans un monde où elle ne saurait apporter un quelconque surcroît de rayonnement social. Mais la réalité, nous la connaissons tous, nous la vivons, est bien celle d'un pays déchristianisé. Étonnamment, ou non, Veilleur, où en est la nuit ?, du Frère Adrien Candiard (op) fait écho à un autre ouvrage paru ces derniers jours aux éditions du Cerf, Etrangers dans la Cité, première édition en langue française d'un livre paru il y a vingt-cinq ans aux Etats-Unis. Pour leur part, les auteurs ont localisé et daté précisément la fin de la chrétienté : c'était en 1963 un dimanche soir, à Greenville en Caroline du Sud. "Ce jour-là, à Greenville en Caroline du Sud, au mépris des vénérables Blue Laws, le cinéma de la Fox ouvrit un dimanche (...) La Fox défia frontalement l'Eglise pour décider de qui offrirait une vision du monde aux jeunes. Cette nuit de 1963, la Fox remporta la bataille." Ne laissez pas filer votre imagination et n'allez pas faire de Stanley Hauerwas, de William Willimon, du Frère Adrien Candiard, de sombres millénaristes, comme nous en comptons bien trop. Ils n'annoncent pas la fin du monde. Ils constatent la fin d'un monde, bien décidés à regarder suffisamment dans les yeux celui qui vient pour nous proposer une voie, un chemin.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Livres - Publications, Spiritualité 3 commentaires -
"Mémoire et identité", le testament politique et spirituel de Jean-Paul II
De Laurent de Woillemont sur ndf.fr :
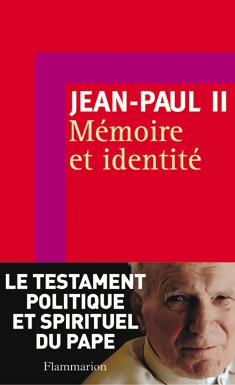 On a lu pour vous : « Mémoire et identité » (Jean-Paul II)
On a lu pour vous : « Mémoire et identité » (Jean-Paul II)Il s’agit donc de thématiques à la fois morales et politiques sur lesquelles le pape donne son avis personnel ; bien que ces conversations restent privées, le livre est bien signé Jean Paul II, et non pas Karol Wojtilya. A ce titre, et au vu des références dont le pape se réclame, on peut difficilement contester le caractère autorisé de ce document, bien qu’il ne soit pas à proprement parler « magistériel ».
Or, le pape s’exprime sur des sujets on ne peut plus sensible et d’actualité ; le titre à lui seul est révélateur ; l’identité et la mémoire sont des sujet brulants aujourd’hui, qu’il s’agisse de l’identité sexuelle ou de l’identité nationale, les débats font rage et les mémoires non plus ne sont pas traitées de manière égale ; certaines sont censées être plus nécessaires à la mémoire collective que d’autres…
Le pape assume parfaitement son patriotisme polonais ; il rappelle qu’à l’origine de ce terme, il y a le mot « père », et que le sentiment patriotique s’inscrit tout à fait dans la foi catholique puisqu’elle se rattache directement dans le quatrième commandement « Honore ton père et ta mère ». Nous devons vénérer nos parents car ils représentent pour nous le Dieu créateur. La famille, la nation et la patrie demeurent des réalités considérées par la doctrine sociale de l’Eglise comme des sociétés « naturelles ». « Elles ne sont pas le fruit d’une simple convention » et ne peuvent être remplacées par rien d’autre ! Les nations, de manière analogue aux individus, sont dotées d’une mémoire historique. Paroles prophétiques s’il en est. Paroles qui nous provoquent aujourd’hui et restent un guide sur pour nous diriger en ces périodes de troubles. Pour autant, si l’homme a une vocation eschatologique il n’en est pas de même des nations. Le pape observe aussi que la Pologne comme nation sort de la préhistoire au moment de son baptême et commence alors à exister dans l’histoire.
-
Famille Chrétienne consacre un dossier à ce qui germe dans l'Eglise de Belgique
 Belgique : l’Église n’a pas dit son dernier mot
Belgique : l’Église n’a pas dit son dernier mot29/02/2016 | Numéro 1990 | Par Bertille Perrin et Antoine Pasquier
Petites lucioles d’espérance, des familles maintiennent vive la flamme de la foi en Belgique. Des paroisses, des mouvements et des communautés les aident à bâtir leur vie spirituelle sur le roc, dans une société belge rongée par le sécularisme et le relativisme.
On ne présente plus la face nord de la Belgique, la plus connue, la plus courue. Elle est celle dont les journaux parlent le plus, et que l’on pourrait résumer par ce triptyque : laïcisme, relativisme, régionalisme. Pas une semaine, ou presque, sans que l’on ne parle de la lente scission entre Flamands et Wallons, des dernières trouvailles du législateur belge pour enfreindre les interdits fondamentaux – comme l’euthanasie des mineurs ou la gestation pour autrui – ou des déclarations offusquées d’officines franc-maçonnes ou gouvernementales contre la supposée ingérence de l’Église catholique.Le nouvel archevêque de Bruxelles, Mgr Josef De Kessel, en a récemment fait les frais lorsque, affirmant que les établissements hospitaliers catholiques étaient en droit de s’opposer à l’euthanasie, parlementaires et médecins lui sont littéralement tombés dessus. Au Plat Pays, on n’aime pas que les têtes dépassent. « La société belge est très consensuelle, confirme un prêtre officiant dans la grande région de Bruxelles. Surtout, il ne faut pas faire de vagues. » Les structures de l’Église n’échappent pas à cet état d’esprit. Son enseignement, notamment sur les questions morales et familiales, y est souvent contesté. La désignation de Mgr Bonny, évêque d’Anvers, pour représenter la Belgique au Synode sur la famille n’a pas toujours été comprise ni admise en raison de ses positions à rebours du Magistère.
La suite est réservée aux abonnés de Famille Chrétienne :
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, Livres - Publications, Témoignages 0 commentaire -
Les missionnaires de la miséricorde ne sont pas ceux qu’on pense
Il ne s’agit pas ici des « missi dominici » du pape François mandatés pour absoudre les "graviora delicta" et autres durant l’année sainte de la miséricorde mais des "Missionnaires de la Miséricorde divine", accueillis par Mgr Rey dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Ils ont fêté le dixième anniversaire de leur fondation en septembre dernier. Leur croissance les a obligés à acheter une maison en centre-ville. Leur fondateur et supérieur, l’abbé Loiseau, parle ici de sa communauté et de ses besoins. Christophe Geffroy l’a interviewé pour le mensuel « La Nef » :

« La Nef – Vous avez fêté en septembre dernier les dix ans de votre fondation : pourriez-vous nous rappeler dans quel contexte sont nés les Missionnaires de la Miséricorde et pour quelle vocation, quel charisme ?
Abbé Fabrice Loiseau – La société des Missionnaires de la Miséricorde est née d'une rencontre avec Mgr Rey, alors que je lui faisais part d’intuitions missionnaires. L’évêque de Toulon me rappelle un soir : « Il faut que tu fondes ! » Trois charismes me paraissaient nécessaires pour une vie sacerdotale et missionnaire à notre époque : annoncer la miséricorde au monde, vivre de l'eucharistie grâce à l'adoration une heure chaque jour et célébrer la forme extraordinaire du rit romain, et enfin participer à la nouvelle évangélisation par une annonce directe de la foi, particulièrement aux musulmans. La dimension missionnaire de ce projet était une priorité pour Mgr Rey et pour moi.
Où en sont aujourd’hui les Missionnaires de la Miséricorde, où êtes-vous implantés ?
Les Missionnaires de la Miséricorde ont aujourd’hui trois lieux de culte : la paroisse personnelle Saint-Francois-de-Paule à Toulon, l'église Saint-Charles à Marseille et Notre-Dame-du-Peuple à Draguignan en lien avec la paroisse territoriale. Nous exerçons également un travail d'aumônerie à Toulon pour la Faculté de droit, pour un collège diocésain et pour une école primaire hors contrat. Un des prêtres de la société est responsable des JMJ au niveau diocésain. À Marseille, le prêtre assure aussi une aumônerie d’hôpital et l’aumônerie de l'école paramédicale des Armées qui dépend du diocèse aux Armées. Dans nos trois lieux, nous avons aussi créé des groupes de prière et de formation pour étudiants. Le camp Spes d'évangélisation des plages regroupe une centaine de jeunes et nous créons pour les JMJ le groupe Miséricordia. L'ouverture du pub Le Graal, à Toulon, a permis d'augmenter notre groupe de jeunes mais aussi d’avoir des contacts avec des personnes loin de l'Église. L'abbé Dubrule, mon adjoint, est en outre professeur au séminaire de la Castille.
Notre communauté est encore modeste : cinq prêtres, onze séminaristes et un frère. Nous souhaitons, dans un premier temps, conforter nos lieux d’apostolat et développer une assistance variée dans nos paroisses. Les après-midi missionnaires avec les paroissiens sont un objectif important : il s'agit de missions de rue et de porte-à-porte avec des laïcs. Vous savez que notre souci est de développer la mission particulièrement auprès des musulmans. Cela demande une formation régulière sur l'islam et la création de liens d'amitié, c’est un investissement important pour nous. La création de groupes alpha (dîners missionnaires) est aussi une priorité. Vous voyez les projets sont nombreux…Lien permanent Catégories : Actualité, Enseignement - Education, Ethique, Europe, Foi, Islam, Jeunes, liturgie, Livres - Publications, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Fatwas et caricatures; la stratégie de l'islamisme
Du Père Edouard-Marie Gallez sur le site eecho.fr :
Beaucoup d’études paraissent sur l’islam. Même sans aucune prétention à être exhaustifs, nous sommes bien en retard sur l’actualité de leur parution – mais l’actualité de leur contenu, elle hélas, ne faiblit pas. La première :
- Fatwas et caricatures. La stratégie de l’islamisme, Lina Murr Nehmé (septembre 2015)
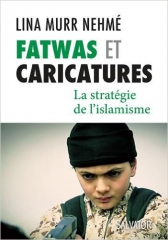 Lina Murr Nehmé n’est pas une inconnue pour les lecteurs d’EEChO. En 2003, elle a publié « 1453. Chute de Constantinople. Mahomet II impose le Schisme Orthodoxe« , qui traite des causes réelles du schisme entre latins et orthodoxes grecs (Francois-Xavier de Guibert, 2e éd., 2009).
Lina Murr Nehmé n’est pas une inconnue pour les lecteurs d’EEChO. En 2003, elle a publié « 1453. Chute de Constantinople. Mahomet II impose le Schisme Orthodoxe« , qui traite des causes réelles du schisme entre latins et orthodoxes grecs (Francois-Xavier de Guibert, 2e éd., 2009).Son dernier livre, Fatwas et caricatures. La stratégie de l’islamisme (Paris, éd. Salvator, septembre 2015), était prémonitoire par rapport aux attentats de Paris, le 13 novembre 2015. À cette date, le Français moyen découvrait le visage véritable de l’islamisme que les Orientaux connaissent bien mais que les médias officiels ne montraient qu’en partie.
Ce livre de 222 pages, abondamment illustré, est fait d’analyses et d’histoire. Il s’ouvre sur la révolution islamiste iranienne (1979 – chap. 1 et 2), après laquelle la situation des chrétiens d’Orient n’a fait se détériorer d’année en année, mais ce n’en est pas simplement une suite : ont joué un rôle plus déterminant encore la fabrication des armées islamistes par les USA contre l’URSS (p.32-34), l’expansion du mouvement des Frères musulmans, d’origine égyptienne (grâce aux soutiens saoudiens et occidentaux) jusqu’en Europe (chap. 4 à 6) et le « choc pétrolier » de 1973 (chap. 7).
Ensuite, en passant par un chapitre rappelant que le jihâd s’enracine dans le projet d’Etat islamique originel (chap. 3), nous entrons dans la réalité de l’islamisme vue du côté arabe et musulman, ce qui nous change des discours des pseudo-spécialistes médiatiques. L’Arabie Saoudite a joué et joue toujours un rôle majeur dans l’islamisme le plus radical et inhumain – même s’il faut reconnaître que l’islam offre en lui-même de telles potentialités (mais une potentialité ne s’active pas toujours…). 90% des institutions islamiques dans le monde sont financées par le régime totalitaire saoudien (p. 74 – chap. 8 et 9). Il faut découvrir le sectarisme qui est ainsi diffusé par l’argent du pétrole (et c’est vraiment le moins que l’on puisse dire ! – chap. 10).
Un chapitre (11) consacré au voile islamique rectifie des idées confuses en Occident : « Beaucoup de musulmanes sont voilées parce que la famille le veut. Mais les femmes islamistes se voilent volontairement et avec orgueil, car elles savent que le voile islamique distingue la musulmane libre de la non-musulmane esclave, qui est traditionnellement nue » (p.97). Parallèlement, on comprend les discours islamiques qui traitent les européennes de prostituées…
Après un détour par le 11 septembre (chap. 12), l’assassinat de Théo van Gogh aux Pays-Bas (chap. 13) et la non-interdiction de représenter Mahomet (sauf en Europe… – chap. 14), l’auteure analyse longuement le cas de l’islamiste Tariq Ramadan, agent et zélateur des Frères musulmans en Europe, qui est emblématique des manipulations orchestrées par les associations islamiques en lien avec des organisations étatiques ou non agissant dans les pays arabo-musulmans (chap. 15-18) ; de cette manière, les pressions haineuses exercées sur les responsables occidentaux est maximale (à la fois intérieures et extérieures).
Il ne faut pas se faire d’illusion sur les ressorts employés par l’islamisme pour atteindre le pouvoir, le principal étant la haine. Celle-ci s’est manifestée massivement – donc aussi de la part de « bons musulmans » (comme disent les gentils animateurs de nos Eglises) – à Beyrouth en 2006, sous le prétexte des caricatures danoises de Mahomet : l’auteur y était (chap. 19) et cette haine fit de nombreuses victimes chrétiennes jusqu’au Pakistan (chap. 20) – des paroles déformées (par la BBC) de Benoît XVI ont servi aussi de prétexte à d’autres pogroms anti-chrétiens (chap. 21).
Cependant, il serait simpliste de croire que l’islamisme soit indépendant d’intérêts occidentaux. Ici, l’auteure ne fait que soulever le voile – on connaît par ailleurs les liens originels entre les Frères musulmans et le MI6 britannique puis avec la CIA, sans parler des autres groupes armés terroristes (les Frères musulmans sont reconnus comme tels en Egypte et dans d’autres pays, mais pas en Occident). Elle donne des pistes significatives (chap. 22 et 23). Après deux pages sur « Charlie Hebdo, sauvé de la faillite » (chap. 23) et sur Rail Badawi, condamné à mille coup de fouet par le régime saoudien (chap. 24), le livre se termine sur la complicité du pouvoir médiatique occidental avec les islamistes de l’Etat islamique et autres terroristes : l’auteure donne ici seulement des documents, très significatifs (chap. 25).
Un livre à garder sous la main ! Mais aussi à prêter largement autour de soi : il permet d’entrevoir, à travers des récits illustrés et des exemples simples, la réalité globale de l’islamisme que, hélas, la plupart des responsables ne voient pas – ou ne veulent pas voir.
Edouard-M G.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Islam, islamisme, Livres - Publications, Politique, Société 3 commentaires -
Refuser ce qui nous façonne et nous limite, c'est haïr le monde et se haïr soi-même
Anne-Laure Debaecker interviewe Chantal Delsol sur le site de Valeurs Actuelles :
Chantal Delsol : “Récuser les limites de l’homme nous inscrit dans le sillon des totalitarismes”
Dans son dernier livre ('La haine du monde'), la philosophe Chantal Delsol dénonce le “tout est possible” des idéologues de l’émancipation et des populistes.
En écho à son titre, vous déclarez dans votre nouvel ouvrage que « le refus du monde va s’écrire en haine de soi » pour nombre de nos contemporains. Comment expliquer ce phénomène ?
Il s’agit de l’homme moderne qui veut re-naturer l’humanité. Le communisme voulait supprimer la nécessité d’un gouvernement et donc la politique, les questions métaphysiques et donc la religion… et façonner ainsi un humain tel que nous ne l’avons jamais connu. Je pense que nous avons aujourd’hui un programme démiurgique analogue avec la volonté d’égalisation, l’ardeur à supprimer les différences, la récusation des questions existentielles, le défi lancé à la mort avec le posthumanisme, enfin le refus de la finitude et de l’imperfection avec cette idée que tout dans le passé était mauvais. Nous entrons dans une ère où rien ne serait plus jamais comme avant — ce que pensait le communisme avec cette idée qu’avant, ce n’était que la pré-histoire, et que la société communiste, enfin, entrait dans l’histoire.
Ce refus de tout ce qui nous façonne est une haine du monde, de la condition humaine, parce qu’elle est médiocre et tragique. Et finalement, c’est une haine de soi : l’homme moderne ne s’accepte pas tel qu’il est, il ne s’aime que renaturé…
Vous évoquez une “idéologie émancipatrice” qui sévit dans notre monde postmoderne. De quoi s’agit-il ?
C’est la suite de l’amélioration historique judéo-chrétienne, mais pervertie parce que radicalisée. Notre culture est la seule à promouvoir dans l’histoire une amélioration menée par l’homme lui-même : le temps est fléché, l’homme s’émancipe… Le Moyen Âge invente la démocratie et commence à émanciper les femmes. L’esclavage existe partout dans le monde, chez nous aussi, mais nous en inventons l’abolition. Avec les Lumières au XVIIIe siècle, la religion transcendante est rejetée et le processus historique d’émancipation, privé de ses limites, devient l’idéologie du Progrès et va se transformer en démiurgie. Il s’agit non plus seulement d’améliorer notre monde avec détermination et circonspection, mais de re-naturer l’homme. C’est 1793. C’est le totalitarisme communiste. C’est encore aujourd’hui, mais avec des moyens différents, puisque nous avons remplacé la terreur par la dérision. On ne cherche plus à détruire le questionnement religieux en emprisonnant les croyants, mais en ridiculisant les dieux. C’est moins coûteux et plus efficace.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Enseignement - Education, Ethique, Idées, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -
30 ans après, la publication d'une interview censurée du grand Urs von Balthasar
L’interview censurée de Hans Urs von Balthasar
L’interview interdite et perdue de Hans Urs von Balthasar par Vittorio Messori. En exclusivité, 30 ans plus tard.
En exclusivité en français dans une traduction de Rédaction Diakonos.be
En exclusivité et presque dans son intégralité, le livre-interview disparu et mis à l’index il y a plus de trente ans. Dans cet entretien controversé de Hans Urs von Balthasar avec Vittorio Messori, le grand théologien suisse se lance dans une critique en règle de l’Eglise post-conciliaire, du progressisme (sans pour autant épargner les lefébvristes) et prend ses distances avec « l’oracle » de Vatican II, Karl Rahner. Il propose une réforme « tridentine » des séminaires et critique vertement le théologien Hans Küng (le maître à penser du cardinal Walter Kasper). La réaction de ce dernier fut si violente qu’elle a provoqué la mise à l’index de ce livre qui fut à l’époque presque immédiatement retiré de la vente et envoyé au pilon avant de tomber dans l’oubli d’une véritable damnatio memoriae couverte par la loi du silence. Le plus frappant cependant c’est que cette interview nous semble pourtant terriblement actuelle : rien n’a vraiment changé depuis lors. Nous vous proposons donc de redécouvrir ce document non seulement rare mais véritablement introuvable transmis par son auteur, l’auteur et journaliste Vittorio Messori, qui nous a autorisé à le publier.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Livres - Publications, Témoignages 0 commentaire