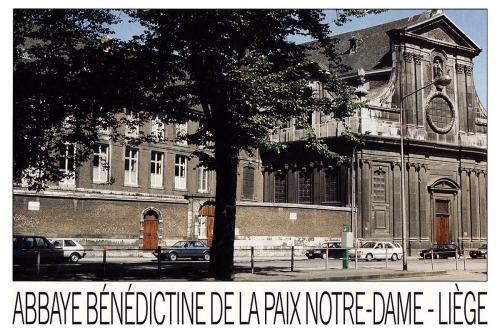De Jean-Robert Pitte, président de Canal Académie (source) :
Le mois dernier, les éditions Gallimard ont publié le journal que Jean Clair, de l’Académie française, a tenu de 2012 à 2015 sous le joli titre de La Part de l’ange. Ces pages ne constituent toutefois pas un simple commentaire au jour le jour de l’actualité. En puisant dans son immense érudition comme dans les souvenirs de toute une vie, l’auteur tient plutôt la chronique acérée et mélancolique de l’affaissement qui caractérise, à ses yeux, notre époque.
Fils de paysan, Jean Clair s’inquiète du déracinement de nos contemporains, incapables de s’inscrire dans une terre, une lignée ou une histoire. Ancien conservateur du patrimoine, il déplore la financiarisation de l’art et la massification de la culture. Académicien, il se préoccupe de l’affadissement de la langue. Épris de métaphysique, il se demande si une société peut perdurer en récusant toute transcendance…
« Je suis toujours en retard d’une indignation » reconnaît Jean Clair. Il ne faut toutefois pas se méprendre sur le sens profond de son implacable réquisitoire. Car, dans son journal, comme dans l’entretien qu’il nous a accordé, ses indignations révèlent surtout un énergique désir de transmettre le fragile trésor que représente notre civilisation. C’est pourquoi, en complément de cette émission inédite, nous vous en proposons d’autres, plus anciennes, dans lesquelles il développe ses réflexions sur l’évolution de l’art et ce qu’elle révèle.
Bonne écoute !
Jean-Robert Pitte
Président de Canal Académie
(1) La Part de l’ange, par Jean Clair, Éditions Gallimard, janvier 2016, 416 p., 26 euros.
Accéder à l'émission : http://www.canalacademie.com/ida11049-La-Part-de-l-Ange-le-requisitoire-de-Jean-Clair.html
Le navrant essor d’un art sans signification
« Il suffisait de voir le genre d'œuvres qui, pendues au-dessus de leur fauteuil, ornaient les bureaux des ministres d'État, des présidents d'administration, des hauts dirigeants des instances internationales, à New York, à Berlin ou Bruxelles : toujours pareilles, de même dimension, quatre mètres sur trois environ, toujours abstraites, sans rien de discernable qui pût livrer quelque lueur sur les idées, les engagements, les convictions ou les trahisons, les lâchetés ou les hypocrisies de l'homme important qui les avait placées au-dessus de sa tête. Non, rien que des taches, des points, des griffes, des halos colorés. Une nébuleuse informe, mais aussi souvent d'une indicible laideur, une image saisissante - ne le comprenaient-ils pas ? - du flou, de l'inanité, des décisions que ces Puissants prétendaient assumer, et qu'ils se faisaient gloire, pensaient-ils probablement, d'afficher sur leurs murs. Comment ces exemples choisis par des directeurs de m usée - car les œuvres étaient le plus souvent prêtées par les plus grandes collections publiques - pouvaient-ils bien s'inscrire dans la continuité au souvenir des œuvres qui ornaient jadis les demeures des Princes, des Églises et des États, des Tyrans même, et qui avaient le devoir de témoigner de la grandeur de leur idéal, de la continuité de leur histoire et de la justesse de leur croyance ou de leur gouvernement, de leur ténacité aussi, des portraits, des architectures, les emblèmes des arts et des sciences, des paysages de la nation, et même des batailles, à l’occasion.
Mais l'art ici ne servait à rien, ne représentait rien, ne défendait rien, n'illustrait rien. Abusant du crédit, depuis longtemps épuisé, de l'admiration et du respect, acquis dans les siècles passés, il n'était plus là que pour montrer, non pas les hauteurs inaccessibles au profane d'une modernité mise en images, mais à qui voulait bien tout simplement la voir, comme l'enfant les habits neufs de l'Empereur d'Andersen, la nudité des politiques dont il était devenu la dernière, pauvre et invisible parure… »
Extrait de La Part de l’ange, par Jean Clair, Éditions Gallimard, janvier 2016, 416 p., 26 euros.

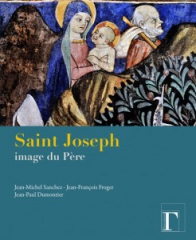 Saint Joseph, image du Père
Saint Joseph, image du Père
 Retour sur Mgr Bugnini auquel
Retour sur Mgr Bugnini auquel 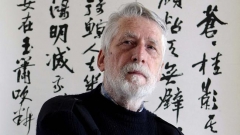 "Bernard Pivot qui avait reçu Simon Leys à "Apostrophes" pour une émission mémorable, écrivait en 2011 :
"Bernard Pivot qui avait reçu Simon Leys à "Apostrophes" pour une émission mémorable, écrivait en 2011 :