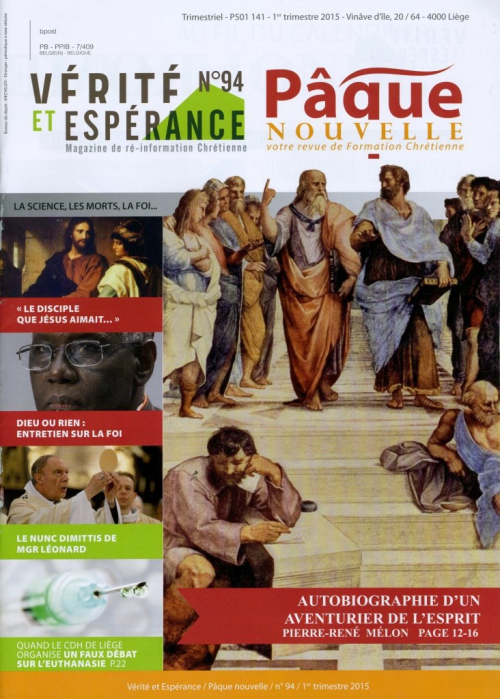Lu sur le « Salon beige » :
 « Le frère Thomas Michelet est dominicain, licencié en théologie. Il était à la Sainte-Baume, le sanctuaire de sainte Marie-Madeleine, et il est à Fribourg depuis septembre pour une thèse de doctorat en théologie. Dans la revue Nova et vetera, il publie un long et très intéressant article sur la question fort débattue des fidèles divorcés, remariés civilement. L'intégralité de cet article est à lire, car il répond aux objections, questions, propositions que certains posent. En voici un court extrait :
« Le frère Thomas Michelet est dominicain, licencié en théologie. Il était à la Sainte-Baume, le sanctuaire de sainte Marie-Madeleine, et il est à Fribourg depuis septembre pour une thèse de doctorat en théologie. Dans la revue Nova et vetera, il publie un long et très intéressant article sur la question fort débattue des fidèles divorcés, remariés civilement. L'intégralité de cet article est à lire, car il répond aux objections, questions, propositions que certains posent. En voici un court extrait :
"[...] La vraie difficulté n’est pas la communion eucharistique mais l’absolution, qui suppose le renoncement à son péché. C’est ce qui explique l’impossibilité d’admettre à l’eucharistie pas seulement les divorcés remariés mais « ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste » (CIC, can. 915), appelés autrefois « pécheurs publics ». On gagnerait à le rappeler, sans doute en des termes moins abrupts, afin que les divorcés remariés ne se croient plus les seuls concernés par ce qui n’est d’ailleurs pas une mesure disciplinaire de l’Église, mais une impossibilité qui s’impose d’abord à elle. Et donc, notre réponse pastorale ne devrait pas non plus se focaliser sur leur seul cas — avec le risque de les enfermer dans une catégorie de péché, sans voir qu’ils sont avant tout des baptisés en quête de Dieu —, mais elle devrait être pensée plus largement pour tous ceux qui se trouvent dans la même situation, et que l’on pourrait appeler faute de mieux des « impénitents » ou des « non-sacramentalisables ».
Si l’on ne peut pas leur donner le sacrement de la pénitence, cela tient autant à l’obstacle qui se trouve en eux qu’aux conditions actuelles du sacrement, lequel suppose pour y entrer que la personne soit prête à recevoir l’absolution et à poser les trois actes du pénitent : le repentir (contrition), l’aveu de son péché (confession) et sa réparation (satisfaction), avec le ferme propos de s’en détacher si ce n’est déjà fait, de ne plus recommencer et de faire pénitence. Ces éléments sont intangibles en eux-mêmes, faisant l’objet de définitions conciliaires, mais l’ordre dans lequel ils interviennent ne l’est pas, puisque ce n’est qu’autour de l’an 1000 que la pénitence a suivi habituellement l’absolution comme un effet du sacrement en vue de la réparation, alors qu’elle en était la condition préalable dans la pénitence antique, certes au titre de peine réparatrice mais aussi en tant que disposition à la contrition. De même la forme ordinaire du sacrement est devenue si l’on peut dire « instantanée », rassemblant tous ces éléments dans un acte rituel unique et bref, tandis que la pénitence antique s’étalait sur de nombreuses années et en plusieurs étapes liturgiques, depuis l’entrée dans l’ordre des pénitents jusqu’à la réconciliation finale. Or c’est exactement le cas de figure des divorcés remariés, et plus généralement de tous ceux qui peinent à se détacher complètement de leur péché, qui ont besoin pour cela d’un cheminement sur le temps long. Dans sa forme actuelle, le sacrement de la pénitence ne peut plus intégrer cette dimension temporelle et progressive, alors que c’était le propre de la pénitence antique, qui se pratiquait d’ailleurs encore au Moyen Âge et qui n’a jamais été supprimée. Sur ces deux points, le régime de la pénitence serait donc susceptible de s’enrichir de nouveau, et il serait bon qu’il le fasse car c’est là un vrai manque, en intégrant à côté des trois formes sacramentelles déjà prévues dans le rituel en vigueur, une autre forme « extraordinaire », à la fois nouvelle et profondément traditionnelle. L’histoire encore récente montre que pour engager une telle réforme, un simple motu proprio paraît suffire ; mais il serait sans doute opportun d’y consacrer d’abord une assemblée du synode des évêques, de même que le synode de 1980 sur la famille avait été suivi par celui de 1983 sur la pénitence. [...]"
L'intégralité de l’article est accessible en ligne, ce qui est une faveur exceptionnelle de l’éditeur. »
JPSC
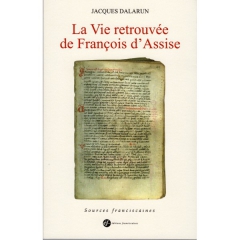 De Radio Vatican :
De Radio Vatican : 
 De
De  « Quaesivi vultum tuum, vultum tuum Domine requiram, ne avertas faciem tuam a me , j'ai cherché ton visage, je rechercherai ton visage, Seigneur : ne détourne pas de moi ta face »: du saint au pécheur, ce verset du psalmiste (que nous chantons à la messe grégorienne du dimanche après l’Ascension), beaucoup de femmes et d’hommes religieux l’ont répété dans leur cœur, des artistes nombreux aussi l’ont exprimé par leur art. Le livre de Véronique Lévy, récemment convertie au catholicisme, lui emprunte son titre : « Montre-moi ton Visage » . Lu ce « post » date du 22 avril 2015 sur le blog « Jésus-Christ en France » :
« Quaesivi vultum tuum, vultum tuum Domine requiram, ne avertas faciem tuam a me , j'ai cherché ton visage, je rechercherai ton visage, Seigneur : ne détourne pas de moi ta face »: du saint au pécheur, ce verset du psalmiste (que nous chantons à la messe grégorienne du dimanche après l’Ascension), beaucoup de femmes et d’hommes religieux l’ont répété dans leur cœur, des artistes nombreux aussi l’ont exprimé par leur art. Le livre de Véronique Lévy, récemment convertie au catholicisme, lui emprunte son titre : « Montre-moi ton Visage » . Lu ce « post » date du 22 avril 2015 sur le blog « Jésus-Christ en France » : Les immigrés clandestins en provenance de Libye sont de plus en plus nombreux. Une réalité qui ne manque pas de faire écho au roman de Jean Raspail, "Le camp des saints" (1973), dans lequel l'auteur décrit les conséquences d'une immigration massive (et soudaine) sur la civilisation occidentale. Sur le site « Atlantico », Frédéric Encel (professeur de relations internationales à l’ESG Management School et maître de conférences à Sciences-Po Paris) interroge Maxime Tandonnet (historien, et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, auteur de "
Les immigrés clandestins en provenance de Libye sont de plus en plus nombreux. Une réalité qui ne manque pas de faire écho au roman de Jean Raspail, "Le camp des saints" (1973), dans lequel l'auteur décrit les conséquences d'une immigration massive (et soudaine) sur la civilisation occidentale. Sur le site « Atlantico », Frédéric Encel (professeur de relations internationales à l’ESG Management School et maître de conférences à Sciences-Po Paris) interroge Maxime Tandonnet (historien, et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, auteur de " « Le frère Thomas Michelet est dominicain, licencié en théologie. Il était à la Sainte-Baume, le sanctuaire de sainte Marie-Madeleine, et il est à Fribourg depuis septembre pour une thèse de doctorat en théologie. Dans la revue
« Le frère Thomas Michelet est dominicain, licencié en théologie. Il était à la Sainte-Baume, le sanctuaire de sainte Marie-Madeleine, et il est à Fribourg depuis septembre pour une thèse de doctorat en théologie. Dans la revue