D’Elisabeth de Baudouin sur le site « aleteia » :
 On attendait François en France en 2015. Alors que son voyage a été reporté en 2016, c’est l’un de ses plus proches collaborateurs, le cardinal guinéen Robert Sarah, qui vient en visite dans l’Hexagone, à l’occasion de la sortie de son livre Dieu ou rien, entretiens sur la foi, écrit en collaboration avec l’écrivain Nicolas Diat (Ed. Fayard, 424 pages).
On attendait François en France en 2015. Alors que son voyage a été reporté en 2016, c’est l’un de ses plus proches collaborateurs, le cardinal guinéen Robert Sarah, qui vient en visite dans l’Hexagone, à l’occasion de la sortie de son livre Dieu ou rien, entretiens sur la foi, écrit en collaboration avec l’écrivain Nicolas Diat (Ed. Fayard, 424 pages).
L’un des hommes clés de la curie
Qui est Robert Sarah ? Derrière l’homme discret, natif d’Ourouss en Guinée (1945) et ordonné prêtre en 1969 se cache en fait un « premier de classe » : nommé archevêque de Conakry à seulement 34 ans par Paul VI (1974), il est créé cardinal – le premier du continent africain - par Benoît XVI en 2010. Entretemps (2001), le « Bébé évêque », comme l’aurait surnommé le Pape Jean Paul II, a été appelé à Rome, d’abord comme « numéro deux » de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, dicastère en charge des Eglises des pays en développement, avant de devenir président de « Cor unum », le Conseil pontifical qui coordonne l’action humanitaire de l’Eglise.
De là à lui confier la direction d’une congrégation pontificale, il n’y avait qu’un pas : François l’a franchi en novembre dernier, en le nommant à la tête de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, dicastère clé en charge de la question, sensible dans certains pays dont la France, de la liturgie. Comme cardinal de curie, il participé au synode sur la famille d’octobre dernier, où les évêques africains se sont signalés par leur défense des valeurs traditionnelles de l’Eglise concernant le mariage et la famille.
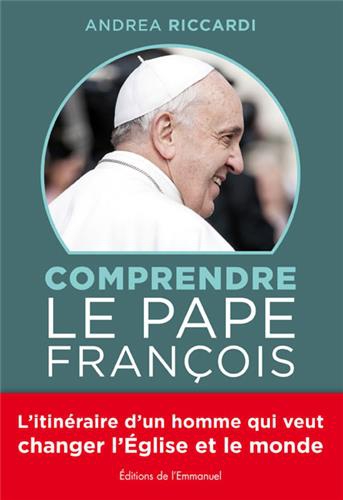 Comprendre le Pape François
Comprendre le Pape François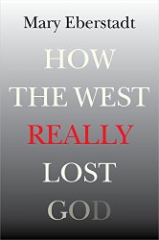 « Dans un des chapitres du livre How the West Really Lost God: A New Theory of Secularization (Comment le monde occidental a vraiment perdu Dieu : une nouvelle théorie de la sécularisation), Mary Eberstadt explique que le déclin des églises protestantes les plus anciennes d’Europe et des Etats-Unis est lié aux changements doctrinaux qu’elles ont opérés dans les domaines concernant la contraception, le divorce, l’avortement et l’homosexualité. Ce qui a contribué à son tour à la fragilisation de la famille en Occident. Nous avons sélectionné quelques paragraphes de cet ouvrage :
« Dans un des chapitres du livre How the West Really Lost God: A New Theory of Secularization (Comment le monde occidental a vraiment perdu Dieu : une nouvelle théorie de la sécularisation), Mary Eberstadt explique que le déclin des églises protestantes les plus anciennes d’Europe et des Etats-Unis est lié aux changements doctrinaux qu’elles ont opérés dans les domaines concernant la contraception, le divorce, l’avortement et l’homosexualité. Ce qui a contribué à son tour à la fragilisation de la famille en Occident. Nous avons sélectionné quelques paragraphes de cet ouvrage :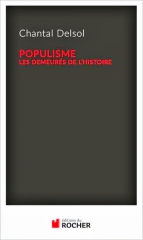 Le site "
Le site "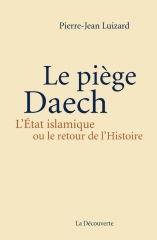 « C'est l'histoire d'un monstre. Une créature hideuse qui sème la mort au Moyen-Orient, gommant les frontières, frappant de stupeur les nations arabes, l'Occident et la communauté musulmane mondiale: l'État islamique. De cette nouvelle baleine de Jonas qui a englouti la Plaine de Ninive, on sait peu de choses. Personne ne peut ainsi affirmer avec certitude que le calife Abu bakr al-Bagdadi est bien le détenteur du pouvoir à Mossoul. En revanche, on peut expliquer la genèse de l'État islamique, et donner les raisons de son foudroyant succès. Pour Pierre-Jean Luizard, pas de doute: «les ingrédients du succès de l'État islamique ne sont pas d'ordre militaire».
« C'est l'histoire d'un monstre. Une créature hideuse qui sème la mort au Moyen-Orient, gommant les frontières, frappant de stupeur les nations arabes, l'Occident et la communauté musulmane mondiale: l'État islamique. De cette nouvelle baleine de Jonas qui a englouti la Plaine de Ninive, on sait peu de choses. Personne ne peut ainsi affirmer avec certitude que le calife Abu bakr al-Bagdadi est bien le détenteur du pouvoir à Mossoul. En revanche, on peut expliquer la genèse de l'État islamique, et donner les raisons de son foudroyant succès. Pour Pierre-Jean Luizard, pas de doute: «les ingrédients du succès de l'État islamique ne sont pas d'ordre militaire».
.jpg)
.jpg)



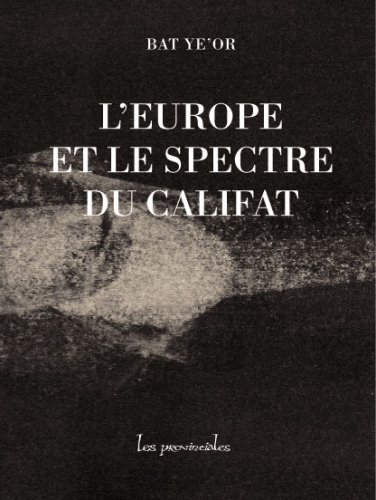
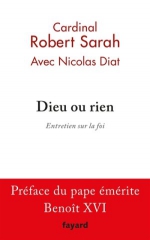

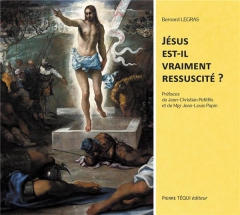 Jésus est-il vraiment ressuscité ?
Jésus est-il vraiment ressuscité ?