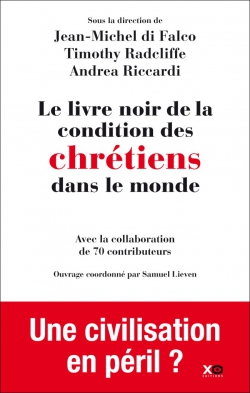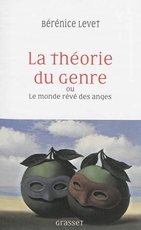 Auteur : Bérénice Levet
Auteur : Bérénice Levet
Editeur : Grasset
Nombre de pages : 202
Dans La Théorie du genre ou le monde rêvé des anges, la philosophe Bérénice Levet déconstruit avec brio l’imposture d’une nouvelle idéologie.
Officiellement, la « théorie du genre » n’existe pas, puisque personne ne s’en réclame ouvertement. En réalité, cette nouvelle conception du monde, car c’en est une, sévit un peu partout, notamment dans ces programmes de l’Éducation nationale où il est expliqué que les individus doivent assumer leur « orientation sexuelle » en fonction de leurs dispositions et non du « sexe social » qui leur serait imposé par des normes « aliénantes ». Ceux qui ont participé aux grandes manifestations contre le « mariage pour tous » connaissent la chanson pour l’avoir combattue.
Sous prétexte d’égalité des sexes, une nouvelle doxa venue des États-Unis dans les années 2000 a prétendu revitaliser le féminisme en le radicalisant. Son gourou s’appelle Judith Butler, homosexuelle militante et auteur d’un livre au succès mondial : Trouble dans le genre. Un essai où l’auteur prétend démontrer que ce que nous appelons habituellement notre identité sexuelle est toujours l’effet d’une construction socio-culturelle qui ne correspond pas forcément à nos penchants réels.




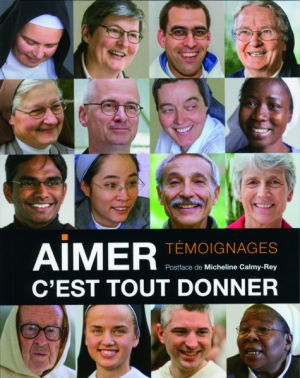
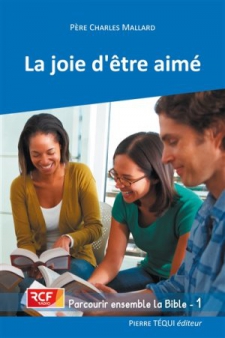
 Le père Charles Mallard, curé au Mourillon (Toulon), est aussi professeur au séminaire de La Castille. Passionné par la transmission de la foi, il propose un chemin de découverte de la Bible sur un rythme de 4 trimestres :
Le père Charles Mallard, curé au Mourillon (Toulon), est aussi professeur au séminaire de La Castille. Passionné par la transmission de la foi, il propose un chemin de découverte de la Bible sur un rythme de 4 trimestres :