De Boulevard Voltaire (Gabrielle Cluzel) via artofuss.blog :
Annie Laurent : « Il est urgent d’en finir avec les concessions que nous multiplions à l’islamisme en nous cachant derrière nos valeurs »
19 mai 2022
Annie Laurent, vous êtes journaliste, écrivain, politologue. Vous avez écrit plusieurs livres sur l’islam. Le dernier, paru en 2017 aux Éditions Artège, s’intitule L’islam pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore). Vous avez également fondé, en 2009, l’association Clarifier visant à « éclairer sur les réalités de l’islam, selon une approche pédagogique et respectueuse des personnes qui s’y réfèrent », et à « promouvoir les conditions et les moyens d’une vie commune pacifique ».
L’arrivée du burkini dans le débat public vous a-t-elle surprise ?
Non ! Plus rien ne me surprend dans le traitement appliqué dans notre pays aux questions relatives à l’islam, à ses principes et à ses revendications. Malgré la répétition par l’État d’assurances de fermeté envers l’islamisme et son refus affiché de tout séparatisme, c’est l’inverse qui se produit, à savoir la progression de la culture musulmane sous différentes formes. L’autorisation du burkini est la dernière manifestation de cette avancée qui ne semble plus trouver de limites et d’obstacles. Je veux parler de la lâcheté des pouvoirs publics qui cèdent ainsi à des calculs clientélistes ou électoralistes ; mais aussi de la complaisance d’une partie de nos élites dont le militantisme est imprégné d’idéologie progressiste.
Dès son déclenchement, cette affaire m’en a rappelé une autre, elle aussi survenue à Grenoble (!), précisément à l’Institut d’études politiques de cette ville, en 2021, après l’annonce d’une « Semaine de l’égalité » ayant pour thème « Racisme, islamophobie, antisémitisme ». L’un des professeurs, Klaus Kinzler, avait alors fait valoir que la présence de l’islamophobie au programme de cette manifestation n’était pas acceptable car on ne pouvait pas admettre une équivalence entre les trois notions. Il justifiait sa position en expliquant que le concept d’islamophobie ne correspond pas à un racisme antimusulman, qu’il ne vise pas des personnes mais le contenu d’une religion et/ou d’une idéologie et, comme tel, devait pouvoir faire l’objet d’une recherche indépendante. Pendant des mois, cet enseignant a été harcelé et menacé, y compris au sein de son institut. L’affaire, médiatisée à outrance, avait d’ailleurs pris une ampleur nationale. Il vient de raconter cette mésaventure dans un essai, L’islamo-gauchisme ne m’a pas tué (Éd. du Rocher, 2022), dont je recommande la lecture.
Et que dire du port du niqab (voile intégral) dans certaines de nos villes et quartiers qui se développe malgré son illégalité puisqu’il est interdit de dissimuler le visage dans l’espace public ?

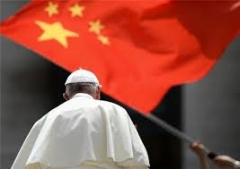 Un analyse sévère d’Andrea Gagliarducci parue ici
Un analyse sévère d’Andrea Gagliarducci parue ici