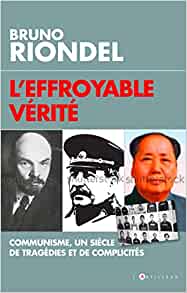PRÉSERVER LA DIVERSITÉ HUMAINE POUR FAIRE FACE AUX ÉPIDÉMIES ?
synthèse de presse bioéthique de genethique.org
20 mars 2020
« On parle sans cesse de l’importance de préserver la biodiversité pour les oiseaux ou les ours, mais jamais de l’urgence à sauvegarder la diversité humaine. Or cette dernière est en danger, et sans elle, les futures épidémies n'épargneront personne », explique le biologiste Jacques Testart.
Alors que la pandémie conduit à des situations inédites, des questions se font jour quant aux conséquences des lois de bioéthique « sur la résistance des humains face aux futures épidémies ».
En effet, le projet de loi a relancé la question du diagnostic préimplantatoire, un tri qui permet d’éliminer les embryons issus d’une FIV « pour détecter et éliminer ceux porteurs d’une anomalie identifiée chez ses géniteurs », précise Jacques Testart. Alors que le diagnostic prénatal (DPN) « effectué alors que le foetus est dans le ventre de la mère » ne prend en charge qu’un embryon, le diagnostic préimplantatoire (DPI), réalisé en laboratoire, soit avant implantation dans l’utérus, en contrôle de (très) nombreux. Son champ d’action n’a cessé de s’élargir depuis des premières lois de bioéthique en France, en 1994. « Aujourd’hui, on envisage sérieusement de trier les embryons non plus seulement pour des maladies ou des facteurs de risque, mais pour l'ensemble des maladies que l'on connaît », ce qui fait craindre l’émergence d’un « eugénisme à grande échelle ».
« Concernant la trisomie 21 par exemple, constate Didier Lacombe, Directeur du service de génétique médicale du CHU de Bordeaux, il y a un vrai paradigme éthique : c’est une des déficiences intellectuelles les moins sévères, et une des mieux intégrées dans la société puisque les enfants atteints peuvent suivre une éducation dédiée, bénéficier d’emplois protégés et profiter d’une offre de logements adaptée. Et pourtant, on observe une chasse anténatale à la trisomie 21 ». Demain, avec le DPI, « qui choisira délibérément un embryon présentant des risques de trisomie 21 par rapport à un embryon standard ? »
Cette sélection n’est pourtant pas sans risques. D’abord parce que notre maîtrise du génome « est très limitée ». Toute modification du génome risque de générer des conséquences en cascade qui ne sont pas maîtrisées. « On connaît depuis longtemps le gène de la résistance au SIDA puisqu’il existe chez un peu moins de 1% de la population. Mais on sait aussi que ce gène favorise la grippe », explique Jacques Testart. Didier Lacombe ajoute : « En Afrique centrale, 30 à 50% de la population est atteinte de la drépanocytose, une maladie des globules rouges. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela correspond aux personnes protégées contre le paludisme ».
Ensuite, parce que ces techniques vont à l’encontre de la « préservation de la diversité de notre patrimoine génétique » qui est pourtant essentielle.
Pour Jacques Testart, « avec des techniques comme celle du DPI, on va droit vers la catastrophe génétique ». Il ajoute : « Dans un contexte comme celui-ci, une épidémie comme celle du coronavirus épargnera encore moins de monde. Si demain tout le monde est sensible aux mêmes pathologies, de nouvelles maladies pourraient détruire l’ensemble de l’humanité. Or des nouvelles maladies, nous allons en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique ». Même évidence pour Didier Lacombe : « Quand on étudie le génome de deux individus, on trouve entre 6 et 10% de variations. C’est cette variabilité qui fait richesse de l’espèce humaine et qui fait que certains d’entre nous survivent à des épidémies, et que l’humanité perdure ».
Il est impératif de « remettre de l’éthique dans la médecine, et prévoir des garde-fous pour éviter les dérives ». Une tendance qui ne semble pas d’actualité dans un monde politique qui, fasciné par la technologie, n’a pas pris la mesure des enjeux.
« Je suis pour la science et la technologie lentes, explique encore Jacques Testart. Maîtriser une technique, ce n’est pas simplement être capable de faire quelque chose de nouveau et spectaculaire, c’est être capable d’en supporter les conséquences, de les mesurer et d’installer les garde-fous adéquats ».
Sources: Usbek&Rica (19/03/2020) - « Pour lutter contre les épidémies, il faut préserver la diversité humaine