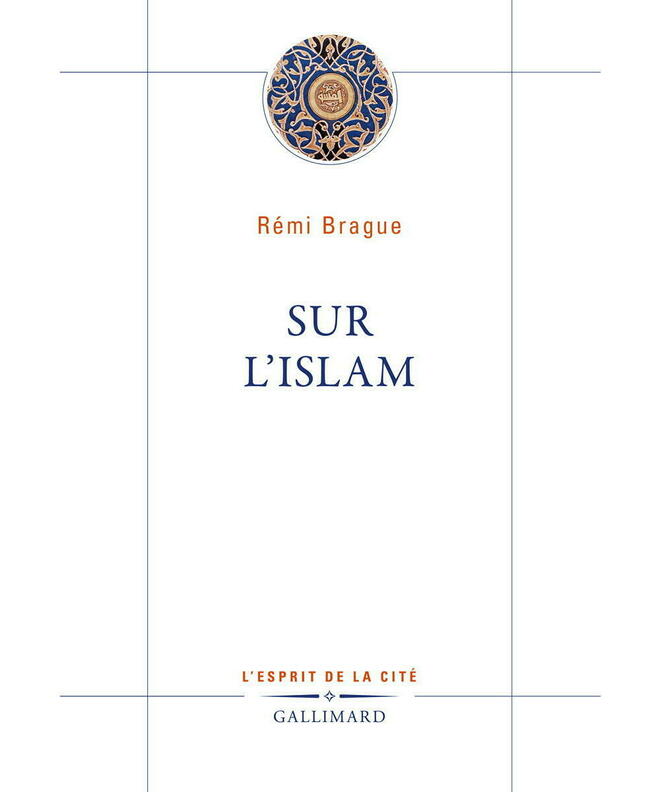Lu sur le site web du Pillar (LE PILIER) 3 mai 2023 :
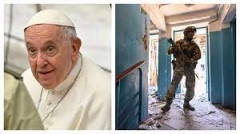 « Le pape François a déclaré dimanche qu'il avait travaillé sur un plan secret de paix entre l'Ukraine et la Russie, plus de 14 mois après la nouvelle invasion à grande échelle de la Russie.
« Le pape François a déclaré dimanche qu'il avait travaillé sur un plan secret de paix entre l'Ukraine et la Russie, plus de 14 mois après la nouvelle invasion à grande échelle de la Russie.
Mais alors que la perspective d'un accord de paix papal a retenu l'attention ces derniers jours, les responsables des gouvernements et de l'Église ukrainiens et russes disent qu'ils ne sont pas au courant d'un plan pontifical.
Le Vatican et le pape ont toujours soutenu que François pousse fort pour la paix en Ukraine. Mais après les commentaires du pape dimanche, il n'est pas clair si un plan papal est encore plutôt germinal, ou si des joueurs de haut niveau n'ont pas eux-mêmes été mis au courant.
Et quelques jours après les commentaires du pape selon lesquels une "mission" secrète de paix était en cours, il a rencontré un haut responsable orthodoxe russe au Vatican, et un proche conseiller papal a suggéré qu'une percée pourrait se produire.
De retour dimanche de son voyage apostolique de trois jours en Hongrie, le pape François a donné l'une de ses désormais coutumières conférences de presse en vol, au cours de laquelle il a été interrogé sur sa volonté de travailler pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été déportés vers Russie par les forces d'occupation.
"Je suis disponible pour faire n'importe quoi", a répondu François. « Il y a une mission qui n'est pas publique qui est en cours ; quand ce sera public, j'en parlerai. »
Ces commentaires ont suscité une vague d'intérêt médiatique et de spéculations sur la manière exacte dont le pape pourrait travailler pour le rapatriement des enfants ukrainiens kidnappés, et si ses commentaires signalaient une percée prochaine dans les négociations de paix.
Mais dans les 48 heures qui ont suivi les remarques, les responsables gouvernementaux ukrainiens et russes ont semblé verser de l'eau froide sur l'idée.
Les médias d'État russes ont rapporté mardi qu'un porte-parole du Kremlin avait nié avoir eu connaissance d'une mission dirigée par François, déclarant aux journalistes que "rien n'est connu" de Moscou au sujet d'une initiative de paix papale.
CNN a ensuite rapporté un démenti similaire depuis Kiev, citant une source proche du président ukrainien qui a déclaré : « Si des pourparlers ont lieu, ils se déroulent à notre insu ou sans notre bénédiction ».
"Le président Zelenskyy n'a pas consenti à de telles discussions au nom de l'Ukraine", a déclaré la source à CNN.
Mais le 3 mai, François a reçu publiquement l'envoyé étranger de l'Église orthodoxe russe à Rome, suscitant à nouveau des questions sur l'éventuel plan de paix de François. Le métropolite Anthony a assisté à l'audience générale du mercredi sur la place Saint-Pierre.
La semaine dernière, François avait rencontré le prédécesseur d'Anthony, le métropolite Hilarion, lors de son voyage en Hongrie.
Alors que Hilarion a depuis déclaré que "rien concernant les relations bilatérales entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe russe" n'avait été discuté lors de la réunion et "aucune question politique" n'était sur la table, François a déclaré dimanche aux journalistes dans l'avion papal que "Vous pouvez-vous imaginer [...] que nous n'avons pas seulement parlé du Petit Chaperon Rouge, n'est-ce pas ? »
Et, malgré les dénégations ukrainiennes et russes de tout pourparler de paix naissant, un proche conseiller papal a déclaré mercredi à un journal italien que François "travaillait continuellement pour la paix depuis plus de huit mois". Le conseiller a prédit qu'une initiative papale privée pourrait bientôt porter ses fruits.
Stefano Zamagni, ancien président de l'académie pontificale des sciences sociales et l'un des principaux contributeurs à l'encyclique du pape Laudato Si de 2015, a déclaré à Il Fatto Quotidiano qu'il avait aidé à rédiger un plan de paix en sept points l'année dernière, qui verrait le Saint-Siège convoquer des réunions privées , non officielles, négociations de paix.
Zamagni a rejeté les récents démentis officiels de Kiev et de Moscou, déclarant mercredi au journal qu'il n'était "pas surprenant" que les gouvernements aient nié toute implication dans des pourparlers de paix qui se voulaient informels et non officiels.
L'économiste a affirmé que l'effort de paix du Vatican est maintenant dans la "dernière ligne droite" et pourrait se concrétiser publiquement "si ce n'est dans les prochaines semaines, du moins dans les trois prochains mois", dans le cadre d'une série de négociations parallèles à celles qui sont poursuivies. par les gouvernements américain et chinois avec les présidents Zalinsky et Poutine.
Mais, a concédé Zamagni, toute conclusion à l'effort ne serait pas «parfaite» et a insisté sur le fait qu'une «paix injuste» était préférable à une «guerre juste».
Tout au long du conflit actuel, François a suscité des critiques de la part des représentants ukrainiens et russes pour ses commentaires sur le conflit et les tentatives du Vatican d'éviter de se ranger ouvertement du côté de l'un ou l'autre pays après l'invasion.
Au cours de la semaine sainte de l'année dernière, le Vatican a invité des femmes russes et ukrainiennes vivant en Italie à participer au chemin de croix du Vendredi saint célébré par le pape François - les deux femmes tenant la croix en l'air au 13e chemin de croix .
Cette invitation a suscité de nombreuses critiques parmi les Ukrainiens et les catholiques ukrainiens, qui l'ont qualifiée d'"étrange sorte d'œcumanisme" et ont déclaré qu'elle semblait donner une équivalence morale aux envahisseurs et aux envahis dans le conflit actuel.
Dans le même temps, il a également suscité la colère de Moscou, après avoir révélé publiquement qu'il avait critiqué le patriarche orthodoxe russe Kirill lors d'une vidéoconférence privée, lui disant de ne pas être "l'enfant de chœur de Poutine".
Alors que François a été invité à plusieurs reprises à se rendre en Ukraine, à la fois juste avant le début de l'invasion russe et dans l'année qui a suivi, le pape a clairement indiqué qu'il n'entreprendrait un tel voyage que s'il pouvait visiter à la fois Kiev et Moscou en tant qu'émissaire de la paix.
En octobre de l'année dernière, François a réitéré sa volonté d'être un intermédiaire pour un cessez-le-feu, utilisant son discours hebdomadaire de l'Angélus pour lancer un "appel confiant au président ukrainien pour qu'il soit ouvert à des propositions sérieuses de paix", tout en déclarant que son "appel s'adresse en premier lieu au président de la Fédération de Russie, l'implorant d'arrêter cette spirale de violence et de mort, également pour le bien de son propre peuple.
Tout en adoptant un ton de plus en plus haussier sur le bien et le mal du conflit, qualifiant l'invasion russe de "insensée, répugnante et sacrilège" et parlant des "actions sauvages, des monstruosités" commises par les troupes russes, François a également déclaré que c'est une erreur de penser qu'il s'agit d'un film de cow-boy où il y a des gentils et des méchants. »
Ref. François a-t-il un plan secret pour la paix en Ukraine ?
Peut-être pas un western mais sûrement encore un nouvel imbroglio à la Bergoglio…
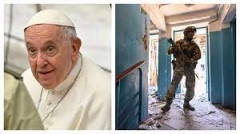 « Le pape François a déclaré dimanche qu'il avait travaillé sur un plan secret de paix entre l'Ukraine et la Russie, plus de 14 mois après la nouvelle invasion à grande échelle de la Russie.
« Le pape François a déclaré dimanche qu'il avait travaillé sur un plan secret de paix entre l'Ukraine et la Russie, plus de 14 mois après la nouvelle invasion à grande échelle de la Russie.  "L'écrivain à l'origine du concept de «pari bénédictin» s'est établi à Budapest à l'automne 2022, séduit par le pays de Viktor Orbán. Avec son «pari bénédictin», Rod Dreher apporte une stratégie à une partie des chrétiens déroutés par les mutations sociétales en Occident. | Elekes Andor
"L'écrivain à l'origine du concept de «pari bénédictin» s'est établi à Budapest à l'automne 2022, séduit par le pays de Viktor Orbán. Avec son «pari bénédictin», Rod Dreher apporte une stratégie à une partie des chrétiens déroutés par les mutations sociétales en Occident. | Elekes Andor