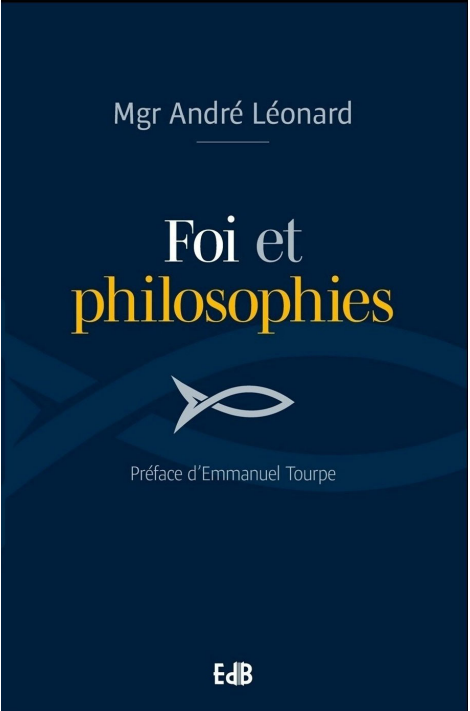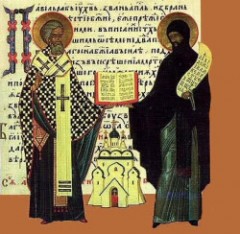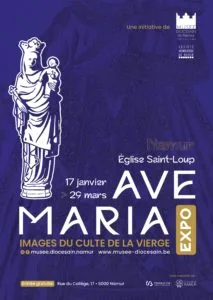Du Père Roch Valentin sur le site du diocèse de Belley-Ars :
Mardi gras et mercredi des cendres
Après le carnaval et ses festivités, nous entrons dans le temps du carême. Pour tout savoir sur le sens du mardi gras et du mercredi des cendres, début du temps liturgique du carême.
Le Carnaval et mardi gras
La semaine précédant le mercredi des Cendres, c'est le carnaval, temps de fantaisie avant l'austérité. Et le dernier jour du carnaval, c'est le mardi gras. Ce sont les dernières réjouissances avant de se lancer résolument dans le temps de la pénitence. C'est le dernier moment pour consommer les provisions d'aliments « gras » dont on se passera en carême. Il est de tradition de faire des crêpes ou des bugnes (appelées merveilles ou oreilles suivant les régions). Cela nous rappelle le temps où, pour écouler les oeufs avant de n'en plus manger pendant le carême, on les consommait dans la pâte à crêpe, à beignet... Mais les oeufs sans réfrigérateurs ne se conservent pas six semaine, et les poules ne cessent pas de pondre parce qu'on ne mange pas leurs oeufs, alors, à la mi-Carême (4e dimanche dit de Laetare), on recommencera, avant de se replonger avec sérieux dans nos efforts. Et enfin, à Pâques, on les décorera avant de les cacher dans le jardin.
Le mercredi des Cendres
La Bible
Dans la Bible, les cendres sont la manière de confesser publiquement sa faute et d'exprimer sa volonté de changer de vie. Pensons à la grande ville de Ninive dont le roi, en entendant la prédication de Jonas annonçant la destruction dans quarante jours, ordonne à tous les habitants, hommes et animaux, de jeûner et de faire pénitence avec un sac comme habit et dans la cendre. Se couvrir la tête de cendre, c'est aussi dans l'Ancien Testament, la manière de se préparer à prier le Seigneur de façon à être entendu. Nous voyons cela par exemple avec la reine Esther qui quitte tous ses atours et se couvre de cendre pour prier avant de se parer à nouveau pour se présenter devant le roi et intercéder en faveur du peuple juif. Les livres de Sagesse, eux, montre par cette réalité poussiéreuse la fugacité de la vie, la pauvreté de l'existence, invitant à ce confier davantage au Seigneur.
L'origine
Dans l'Antiquité chrétienne, le carême était la période de préparation à la réintégration des pénitents. Les pénitents étaient des chrétiens ayant commis des fautes graves et désirant retrouver la communion avec Dieu dans l'Eglise. Pour cela, ils confessaient en secret à l'évêque leurs péchés et étaient admis ensuite publiquement dans l'ordre des pénitents en recevant les cendres sur la tête. A la fin de la période de pénitence faite de renoncements, de charité et de prière intense, ils recevaient l'absolution de l'évêque le Jeudi Saint et retrouvaient leur place parmi les fidèles pour célébrer Pâques. Jusqu'au VIe siècle, cette cérémonie avait lieu le 6e dimanche avant Pâques, mais avec Grégoire le Grand, elle a été avancée au mercredi précédant pour totaliser 40 jours de pénitence, car les dimanches n'en sont pas. Mais dès cette époque, le Pape lui-même se faisait imposer les cendres en signe de pénitence et de préparation à Pâques. Cela se faisait à la basilique Sainte-Anastasie au Palatin, avant de monter pieds nus à Sainte-Sabine sur l'Aventin pour la première prédication de carême. Elle lui rappelait que, tout pape qu'il était, il était poussière et y retournerai. Ce signe de la pénitence est désormais reçu par tous les fidèles catholiques. Mais se souvenir de son origine doit nous inciter à bien nous confesser avant la grande fête, même si nous ne faisons plus publiquement notre pénitence, à entrer véritablement dans une logique de conversion et d'intensification de la vie chrétienne.
Aujourd'hui
La liturgie du mercredi des cendres, de nos jours, peut être célébrée soit au cours d'une célébration de la Parole, soit au cours de la messe. On entend toujours l'évangile selon saint Matthieu (chapitre 6) dans lequel le Christ nous apprend à faire l'aumône, à prier et à jeûner dans le secret, sous le seul regard de notre Père. Ça sera notre feuille de route pour le carême. Après l'homélie, le prêtre bénit les cendres, produites en principe par l'incinération des rameaux de l'année précédente. Puis il s'impose à lui-même la cendre, s'il n'y a pas d'autre prêtre pouvant le lui faire, et ensuite il l'impose à chaque fidèle, soit en en répandant un peu sur la tête, soit en marquant le front en signe de croix. Il joint à ce geste ces mots : « Convertissez-vous et croyez à l'Evangile. » C'est l'exhortation à entrer en vérité dans le carême. Ou encore : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » C'est l'invitation à accepter notre condition mortelle du fait du péché, dans la confiance que Dieu peut nous pardonner et nous ressusciter.
Jour de jeûne et d'abstinence
Ce jour est l'un des deux seuls jours de jeûne et d'abstinence de l'année (avec le Vendredi Saint), ne passons pas à coté. Pour mémoire, tous les vendredis de l'année, c'est abstinence. C'est-à-dire qu'on s'abstient de viande, d'alcool, de tabac... et on prend plus de temps pour la prière et le partage. Les vendredis de carême, en France, c'est spécifiquement de viande que l'on s'abstient. Les jours de jeûne, on s'abstient de viande et se prive substantiellement de nourriture selon son âge et ses forces.