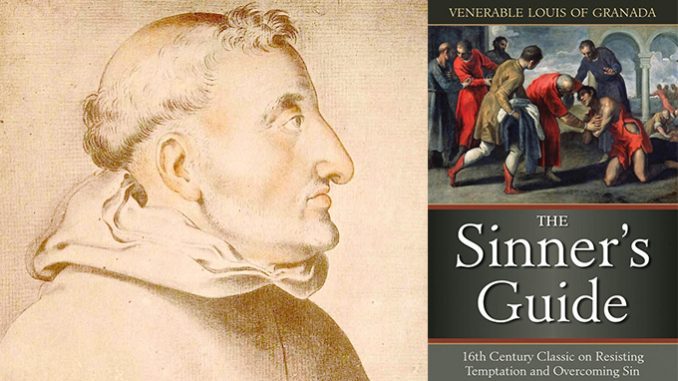De sur le CWR :
Le visage souriant de l'effacement
Dès l'instant où une Église admet que le bien suprême est « l'inclusion » plutôt que la « sainteté », ou « l'autonomie » plutôt que « l'obéissance », elle cesse d'être une Église et devient une ONG spirituelle au service de l'État libéral.
J'ai récemment été interviewé sur CTV, la chaîne de télévision nationale canadienne, au sujet des débuts du pontificat de Léon XIV. L'intervieweur m'a posé une question qui m'a été posée dans d'innombrables interviews concernant le pontificat de Léon XIV ou de François : « Parviendra-t-il enfin à moderniser l'Église ? »
Lorsque les recruteurs posent cette question, ils ne cherchent pas à savoir si l'Église utilisera les derniers smartphones, l'intelligence artificielle ou TikTok pour l'évangélisation. Ils n'entendent pas par là une modernisation technologique, ni une modernisation organisationnelle, ni l'adoption des dernières idées en matière de leadership ou d'efficacité managériale.
Non, ce qu'ils veulent dire, et ce qu'ils ont toujours voulu dire lorsqu'ils ont évoqué la modernisation depuis plus de 150 ans, c'est simplement ceci : « L'Église va-t-elle commencer à nous ressembler davantage, à adopter nos valeurs et nos principes ? »
Le mot « nous » est ici essentiel. Car ceux qui posent cette question – qu’il s’agisse de représentants de la presse, d’universitaires ou de journalistes – sont attachés à des valeurs et des principes fondamentaux qu’ils partagent. Ce sont, selon eux, les valeurs fondamentales de l’Occident moderne. L’inclusion est une bonne chose ; l’exclusion, une mauvaise. Le passé est suspect car il a exclu des groupes, et ces groupes, qu’il s’agisse de femmes ou de personnes homosexuelles, doivent désormais être inclus. La tradition, dès lors, est suspecte car elle n’est qu’un vestige poussiéreux de cette époque répressive. La démocratie, comme le savent tous les gens sensés, est une bonne chose ; et le fait que tous les catholiques de nom ne votent pas pour leurs dirigeants est antidémocratique, et donc mauvais.
Je pourrais m'étendre sur le sujet, mais nous connaissons tous ces valeurs. Elles sont omniprésentes dans les cours universitaires, les films de série Z, les séries télévisées, la publicité et les articles de presse. Ce sont les valeurs du libéralisme, pour être précis, ou tout simplement de « bonnes valeurs » si l'on est tellement imprégné de culture occidentale qu'on ignore leur caractère simpliste et discutable. Elles ne sont pas présentées comme une option parmi d'autres, mais comme le aboutissement neutre et inévitable de l'histoire.
Ainsi, la question de la « modernisation » de l’Église, au XIXe siècle comme aujourd’hui, est une question d’absorption de l’Église par la « modernité » ou le libéralisme. Lorsque le pape Pie IX fut pressé de se réconcilier avec le « progrès, le libéralisme et la civilisation moderne » dans les années 1860, on lui demandait précisément de faire ce que les experts exigent du pape aujourd’hui. Cette exigence est constante car le projet de modernité est totalisant.
L'histoire de l'Occident moderne est celle d'institutions et de groupes qui, les uns après les autres, fusionnent avec cette idéologie. Des monarchies aux gouvernements, des nations aux instances sportives, des universités aux médias, des entreprises à l'ensemble de la population, la modernité est un processus d'effacement des différences et des spécificités au nom du « progrès ». C'est un processus inexorable où tous sont convertis à ces principes. Les médias et les universités font office d'évangélistes et de prêtres ; ils sont les missionnaires de première ligne.
Surtout, ils ne se considèrent pas comme des colonisateurs ; ils croient simplement œuvrer pour le progrès, la justice ou le bien commun. Ce sont des religieux fervents, dénués de tout doute. Ils cherchent à effacer l'identité d'autrui au nom de la justice, du progrès, et même pour le bien de ceux qu'ils tentent de convertir. Il ne s'agit pas de l'impérialisme violent des canonnières, mais de l'impérialisme insidieux des services des ressources humaines, des comités d'attribution des subventions et des normes de radiodiffusion. Il conquiert non pas en détruisant le corps, mais en réécrivant l'âme.
Quand on m’interroge sur la modernisation de l’Église, on me demande en réalité si elle est prête à être colonisée. Est-elle prête à accepter la réalité et à se soumettre à l’idéologie dominante, ou à persévérer dans le combat, telle une soldate japonaise fanatique sur une île du Pacifique, ignorant que la guerre est terminée depuis longtemps ?
Bien que ce discours de colonisation et de combat puisse paraître rhétorique, il est important de comprendre que les groupes qui se « modernisent » ne sont pas de simples groupes qui se relookent. Ils ne se contentent pas d'adopter l'apparence d'appartenir à la même « marque » que le libéralisme moderne tout en conservant leur nature et leur identité. Certes, les instances sportives continuent de se consacrer au sport tout en se faisant les porte-parole de l'idéologie dominante, arborant des drapeaux arc-en-ciel et portant des lacets multicolores. Apple peut toujours vendre des iPhones et Disney peut toujours produire des films tout en diffusant des idées à travers ses fonds d'écran ou ses contenus.
Lorsqu'elles se modernisent, elles peuvent conserver en grande partie leur mission principale. De même que les pays colonisés pouvaient garder la quasi-totalité de leurs revenus, ne versant qu'une faible part d'impôts à l'Empire, ils pouvaient mener leurs propres conflits la plupart du temps et n'avaient besoin d'envoyer leurs soldats en renfort au pays colonisateur que ponctuellement. La colonisation n'entraîne pas toujours la disparition complète d'une fonction ; souvent, elle se traduit simplement par un réalignement des allégeances.
Mais l'Église se concentre sur la pensée et l'action, la foi et les œuvres. Elle s'attache à définir comment vivre, ce qu'il faut croire et les biens et vérités auxquels nous devons nous rattacher pour nous conformer à ce bien et à cette vérité. Que ce soit dans les médias, les entreprises ou le monde universitaire, l'idéologie moderne qui les unit porte également sur ce qu'il faut croire (concernant l'inclusion et l'exclusion), sur les biens et vérités auxquels adhérer (concernant la liberté et l'émancipation) et sur la manière de vivre (jusqu'aux conceptions de la sexualité).
Par conséquent, pour l'Église, la colonisation par l'idéologie de l'Occident moderne ne serait pas partielle, mais totale. L'Église ne vend pas un produit que l'on pourrait emballer dans un drapeau arc-en-ciel ; l'Église est un mode de vie qui exige une allégeance absolue. Si un comptable musulman peut se convertir au christianisme et continuer d'exercer sa profession, un imam musulman ne peut se convertir tout en restant imam. Microsoft peut continuer à vendre des logiciels, tant que les utilisateurs peuvent choisir des thèmes de couleurs « pride » dans Outlook, tout en adhérant à la vérité de l'Occident moderne. Mais les Églises, elles, ne le peuvent pas.
Dès l'instant où une Église admet que le bien suprême est « l'inclusion » plutôt que la « sainteté », ou « l'autonomie » plutôt que « l'obéissance », elle cesse d'être une Église et devient une ONG spirituelle au service de l'État libéral.
Les Églises qui s'y essaient deviennent rapidement l'avant-garde évangélique des valeurs libérales modernes. Elles cessent d'annoncer l'Évangile et se transforment en prédicateurs de ces mêmes valeurs. On le constate chez les principales dénominations protestantes qui ont embrassé tous les préceptes de la révolution sexuelle ; leurs bancs sont vides, mais leurs communiqués de presse sont d'une orthodoxie irréprochable, selon les critères du New York Times . Elles prêchent avec ferveur religieuse les valeurs qui nous définissent, nous autres Occidentaux laïcs modernes.
Il y a ici une psychologie particulière à l'œuvre. Si Paul n'avait été qu'un fabricant de tentes, il aurait pu se convertir du judaïsme au christianisme et continuer à fabriquer des tentes. Mais Paul, le prédicateur zélé, était un prédicateur zélé du christianisme. Les Églises qui se « modernisent » deviennent des évangélistes zélés du libéralisme. Souvent, le converti est plus fanatique que celui qui est né dans la foi. Le chrétien « modernisé » est souvent plus désireux de prouver sa loyauté au nouveau régime que le laïc qui la considère comme allant de soi. Ils deviennent les inquisiteurs du nouvel ordre, traquant les éléments « rétrogrades » de leur propre tradition pour les offrir en sacrifice aux nouveaux dieux du progrès.
Nous avons déjà vu ce processus. Le paganisme qui a jadis prospéré dans le monde antique s'est modernisé sous l'effet du christianisme. Des chercheurs attentifs peuvent encore en déceler des vestiges dans certaines pratiques chrétiennes actuelles, mais il n'en reste plus grand-chose. Il en va de même avec l'essor de l'islam. Les chrétiens d'Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale se sont modernisés sur plusieurs siècles, adoptant souvent une synthèse entre leur foi chrétienne et la nouvelle foi qui commençait à être appelée islam. En quelques siècles, ils ont complètement disparu. Certains esprits extrémistes, comme Jean Damascène, théologien et moine de la fin du VIIe et du début du VIIIe siècle, les qualifiaient encore d'hérétiques chrétiens, mais les vestiges de leur christianisme étaient de plus en plus difficiles à déceler sous la nouvelle idéologie qu'ils avaient adoptée. Ils pensaient s'adapter pour survivre ; en réalité, ils s'adaptaient pour disparaître.
L'intervieweur qui m'a posé cette question, comme ceux qui m'avaient posé des questions similaires auparavant, était un homme sympathique. Il est peut-être même chrétien, ou plus probablement, ses parents ou grands-parents l'étaient. Et je comprends pourquoi il a posé cette question. Il représente une idéologie mondiale dominante et souhaite que l'Église catholique s'y rallie et devienne partie intégrante de son mouvement ; qu'elle cesse d'être cette institution à part depuis 2 000 ans et qu'elle se fonde, au contraire, dans le monde glorieux où il vit.
Il ne pose pas cette question par malice. Il la pose par perplexité face à notre choix de rester à l'écart du consensus. Mais ce n'est qu'en comprenant, nous autres catholiques, que cette question relève de la colonisation, de l'anéantissement par une idéologie dominante, que nous pourrons saisir pleinement les enjeux. C'est le sourire de l'effacement, porteur de l'espoir de notre disparition.
David Deane est professeur agrégé de théologie à l'Atlantic School of Theology. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont *Nietzsche and Theology* et *The Tyranny of the Banal: On the Renewal of Catholic Moral Theology* . On peut le retrouver en ligne sur le site Good Theology .