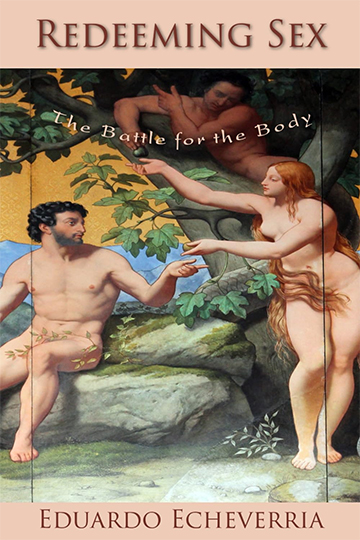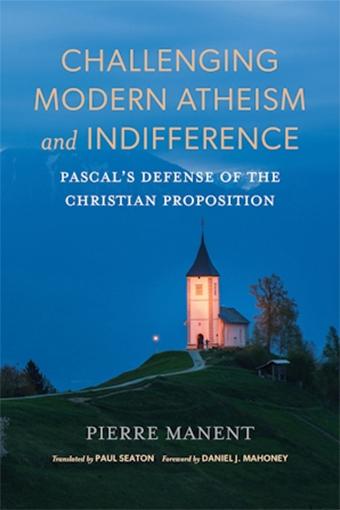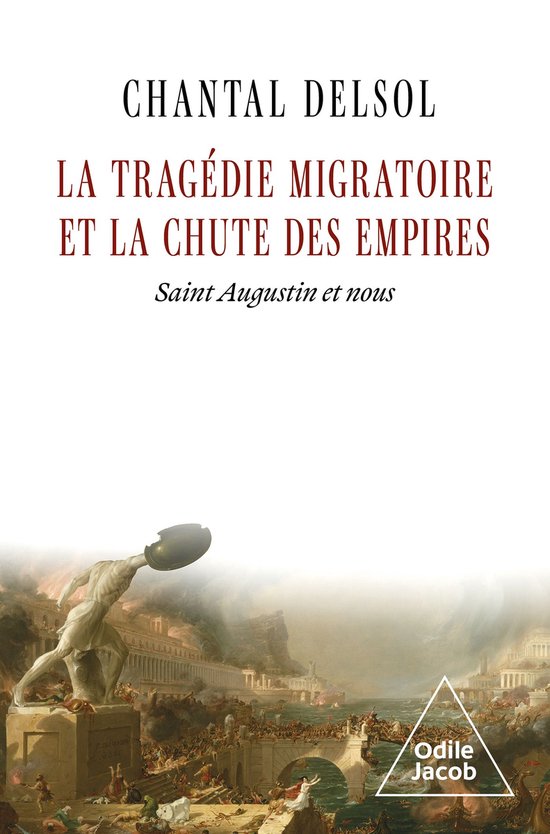De sur le CWR :
L'homme comme "phénomène frontière" : sur la redécouverte de l'image de la nature humaine
En quoi l’image de l’homme comme unité de matière et d’esprit, de corps et d’âme, est-elle utile pour contrer le matérialisme, l’individualisme expressif et le transhumanisme ?

Carl Trueman affirme que c'est la question la plus urgente à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Paul Kingsnorth semble partager cet avis ; dans son ouvrage récemment paru, Contre la machine, il déclare : « Nous avons oublié qui nous sommes, ou nous n'aimons pas qui nous sommes, ou les deux. »
Oui, en quelque sorte les deux. Et certains d'entre nous n'aiment pas qui ils sont parce qu'ils ont oublié qui ils sont.
Trueman affirme – à juste titre – que la nature humaine a été « démantelée, désenchantée, désincarnée et profanée ». Il suggère des pistes potentiellement fructueuses pour tenter de répondre aux trois premières atteintes modernes à la nature humaine, mais il minimise trop rapidement notre capacité à contrer la profanation de l'homme. Son argument est le suivant :
L’absence de consensus social sur l’existence de Dieu, sans parler des dogmes et pratiques religieuses, empêche tout consensus sur une conception de la nature humaine fondée sur l’image divine. Ce manque de consensus est problématique, car la réponse à la profanation de la nature humaine doit être sa consécration, et la consécration doit s’inscrire dans un contexte religieux. Face à la sécularisation de notre société contemporaine, les chrétiens doivent faire preuve de modestie quant à l’étendue de leur action.
Certes, dans la société laïque actuelle, nombreux sont ceux qui rechignent à envisager la possible véracité d'une des affirmations fondamentales de l'anthropologie chrétienne (et juive) : l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu (Genèse 1, 26-27). Mais d'autres représentations de l'homme pourraient alimenter les débats sur le « nouvel humanisme » prôné par Trueman ; des représentations auxquelles les laïcs seraient peut-être plus réceptifs, mais qui pourraient néanmoins contribuer à orienter ces discussions, même si c'est de manière progressive et imperceptible au départ, vers la reconsécration de l'homme.
L'une de ces images serait celle de l'homme comme méthorion ou « phénomène frontière ». L'homme se situe de manière unique à la frontière entre le corps et l'esprit, la matière et l'âme, l'objet et le sujet, le fini et l'infini. Comme l'a noté Hans Urs von Balthasar, l'image de l'homme comme phénomène frontière se retrouve, sous une forme ou une autre, dans pratiquement toutes les philosophies et religions. Dans la formulation de l'Église catholique, l'homme est « l'unité de l'âme et du corps ».
L'image de l'homme comme phénomène frontière semble particulièrement pertinente dans les débats contemporains sur la nature humaine. Cela tient en partie au fait que cette image est impliquée non seulement dans la profanation de l'homme, mais aussi dans le démantèlement, le désenchantement et la désincarnation de la nature humaine tels que décrits par Truman, et pourrait ainsi contribuer à répondre aux quatre atteintes contemporaines à notre identité humaine.
L'image de l'homme comme phénomène frontière est également très pertinente pour les trois courants intellectuels/culturels qui ont le plus nui à notre compréhension contemporaine de la nature humaine : le matérialisme, l'individualisme de l'affirmation de soi et le transhumanisme.
Les matérialistes affirment que nous ne sommes rien d'autre que notre corps, l'esprit/la conscience n'étant qu'un épiphénomène des processus biochimiques.
Les individualistes de l'affirmation de soi veulent affirmer, simultanément (et donc de manière incohérente), que nos corps ont et n'ont aucune importance pour établir ce qu'est un homme (par exemple, en soutenant que le « genre » d'une personne est ce que la personne croit être, indépendamment de son corps, tout en défendant l'importance cruciale de la possibilité pour cette personne de modifier son corps par le biais d'hormones, de chirurgie, etc., dans le but de faire correspondre son corps à son « genre » perçu intérieurement).
Les transhumanistes cherchent un moyen de nous séparer complètement des « limites » de notre corps, ce qui pourrait être réalisé grâce à des techniques telles que le téléchargement de l'esprit humain dans le nuage numérique (ce qui, soit dit en passant, nécessiterait toujours un support physique pour accueillir ces « esprits »).
L'image de l'homme comme une unité de matière et d'esprit, de corps et d'âme, est utile pour contrer ces trois courants de pensée déshumanisants dans la société contemporaine, ainsi que la confusion générale sur la nature humaine qui semble si répandue aujourd'hui.
Mais comment aborder efficacement une telle image de la nature humaine, en tenant compte de la résistance que tant de penseurs laïques manifestent instinctivement dès qu'un sujet, même vaguement lié à Dieu, au christianisme ou à un royaume transcendant, est évoqué ? Voici quelques pistes de réflexion :
- Inspirez-vous des arguments de Thomas Nagel (qui est lui-même athée) selon lesquels le matérialisme ne parvient pas à rendre compte d'aspects aussi centraux de la vie humaine que la conscience, le sens et la valeur.
- Analysez comment l'homme est un être fini ouvert à l'infini, comme l'ont notamment souligné Thomas d'Aquin.
- Incorporer l’image de l’homme comme « microcosme » (l’« incarnation du monde », l’être qui « récapitule ontogénétiquement en lui-même, couronne et transcende toutes les formes de la nature » ), une image étroitement liée à l’image de l’homme comme être liminal et qui a été défendue par divers penseurs, dont Plotin, Origène, Augustin, Grégoire le Grand, Maxime le Confesseur et Bonaventure.
- Il convient de s'intéresser au statut de l'être humain à la fois sujet et objet, comme le soulignent Kant, Hegel et, plus récemment, Roger Scruton. Ce dernier explique comment cette conception de la nature humaine peut révéler ce qu'il nomme notre « difficulté métaphysique », une situation à laquelle, reconnaît-il, « Dieu est la seule solution ».
- Enfin, parce que certaines personnes ne sont pas sensibles à ce qu'elles percevraient probablement comme des arguments « académiques » sur la nature humaine, nous devons trouver des moyens d'explorer et de réfléchir sur la nature humaine en tant que « phénomène frontière » dans la culture populaire (films, musique, littérature, art, etc.).
Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont une redécouverte de l'image de la nature humaine comme « phénomène frontière » pourrait contribuer, même modestement, à la reconsécration de l'homme dans la société contemporaine.