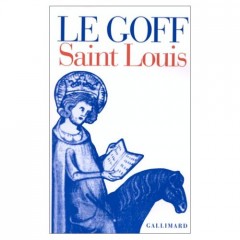Lettre du supérieur du district d’Autriche, M. l’abbé Stefan Frey
Chers amis et bienfaiteurs !
Le ciel nous a offert à Vienne un cadeau qui a dépassé nos attentes les plus folles. Depuis des années, nous sommes à la recherche d’une église appropriée, car l’arrangement provisoire – qui a finalement été de longue durée – de notre ancienne chapelle Saint-Joseph dans la Bernardgasse, avec son loyer très coûteux, n’a jamais pu être une solution permanente.
Depuis 2008, nos fidèles viennois prient intensément à cette intention. Saint Joseph nous a fait attendre et a testé notre patience et notre persévérance jusqu’à l’année qui lui est consacrée.
Mais aujourd’hui, il a répondu de manière surabondante aux nombreuses prières et nous a donné non pas n’importe quelle église, mais l’église des Minimes de Maria Schnee – Marie des Neiges – consacrée à sa très sainte épouse.
C’est l’une des églises les plus renommées, les plus belles et les plus anciennes de la ville de Vienne, sise dans un emplacement de choix, et dont l’importance historique et culturelle ne peut être suffisamment appréciée ! Notre gratitude envers le bon saint Joseph est sans limite ! Comme il entend merveilleusement ceux qui le prient avec confiance et persévérance.
Mais nous sommes également conscients que ce don sublime est lié à une grande mission et à une lourde responsabilité. L’église des Minimes offre maintenant de vastes possibilités pour l’apostolat et donc des opportunités uniques pour renforcer la tradition catholique à Vienne.
Que la très sainte Vierge Marie des Neiges et son saint époux nous aident de leur puissante assistance à remplir cette responsabilité, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du plus grand nombre d’âmes possible !
Les miracles de la divine Providence
Comment la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X en est-elle venue à entretenir une si magnifique église à Vienne ? Avec Dieu, rien n’est impossible, et de toute évidence, Dieu a voulu rendre possible l’impossible, humainement parlant.
En effet, les circonstances de cette merveilleuse histoire à succès ne peuvent être décrites autrement que comme miraculeuses. Citons les pierres angulaires les plus importantes qui suggèrent que Dieu y a participé dès le début :
– 18 novembre 2020 : En la fête de la consécration des églises de Saint-Pierre et Saint-Paul, nous avons reçu la proposition tout à fait inattendue de reprendre l’église des Minimes de la “Congrégation italienne Madonna della Neve”. Elle avait été donnée en 1784 par l’empereur Joseph II comme église nationale italienne à Vienne (le couvent des Minimes a ensuite été déplacé dans l’ancien monastère des Trinitaires, près de l’église de la Trinité).
– 20 mai 2021 : Fête de saint Bernardin de Sienne. Jeune prêtre, saint Bernardin avait reçu de la Sainte Mère le don des pouvoirs miraculeux, et nous ne lui demandions rien d’autre qu’un miracle. Le saint nous a exaucés, car il fut accepté à l’unanimité de faire don à la FSSPX de la plus importante église mariale de la ville de Vienne !
– 25 mai 2021 : En ce jour de commémoration de deux papes italiens – saint Grégoire VII et saint Urbain Ier –, à la veille de la fête de saint Philippe Néri, le grand apôtre de Rome, eut lieu la signature notariale des contrats de donation. Avec cela, il était clair pour nous que Dieu donnait évidemment à la FSSPX la mission de poursuivre fidèlement l’héritage multiséculaire de la communauté italienne de Vienne.
– 29 juin 2021 : Les saints Apôtres Pierre et Paul avaient parrainé le début de notre entreprise : providentiellement ils étaient présents au couronnement. Le jour de leur solennité, la nouvelle propriété était définitivement inscrite au registre foncier de la ville de Vienne.
La FSSPX est donc officiellement devenue propriétaire de l’église des Minimes. Que nous apprend ce parrainage ? Il est certain qu’avec l’église des Minimes nous n’avons reçu aucun autre mandat que celui de continuer fidèlement à Vienne la tradition apostolique que saint Pierre et saint Paul ont implantée dans l’Eglise de Rome, la Mère et Maîtresse de toutes les Eglises, au nom du Christ, et de la défendre avec fermeté contre toutes les aberrations d’aujourd’hui.
Nous ne sommes pas un Tradi Club désuet, mais simplement des catholiques romains, et nous avons le désir ardent de servir l’Eglise catholique de toutes nos forces et de l’aider à retrouver sa tradition apostolique vieille de 2000 ans, de laquelle seule découle toute la vitalité surnaturelle, comme de la racine à l’arbre largement ramifié de l’Eglise.
Que Dieu tout-puissant bénisse cette œuvre qui a émerveillé tout le monde. Que tous ses saints auxiliaires accompagnent notre nouvelle mission de leur intercession constante, notamment saint Clément-Marie Hofbauer, patron de notre prieuré viennois, qui a travaillé pendant quatre ans comme recteur de l’église des Minimes et y a ravivé l’amour eucharistique dans le cœur des Viennois par ses célébrations grandioses en l’honneur du Saint-Sacrement.
Avec ma bénédiction sacerdotale.
Pater Stefan Frey