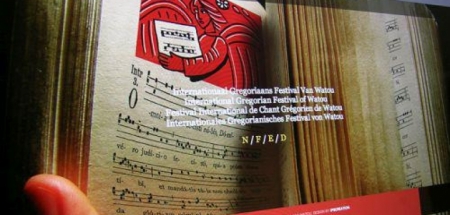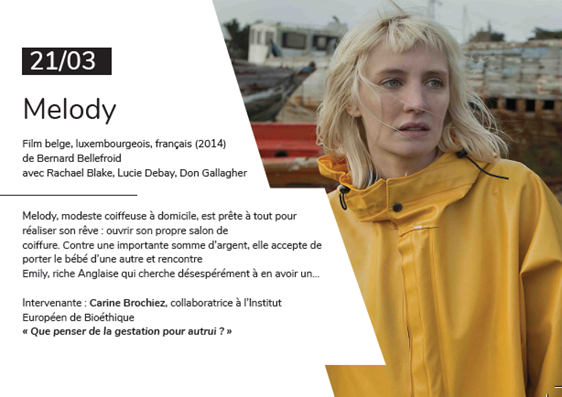Lu sur le site du mensuel « La Nef » :
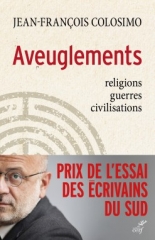 Jean-François Colosimo, directeur des Éditions du Cerf, essayiste, a consacré l’ensemble de ses recherches aux métamorphoses contemporaines de Dieu.
Jean-François Colosimo, directeur des Éditions du Cerf, essayiste, a consacré l’ensemble de ses recherches aux métamorphoses contemporaines de Dieu.
La Nef – Dans un panorama grandiose, votre livre apparaît comme l’une des charges les plus virulentes contre la modernité fille des Lumières : alors que ces Lumières semblent un acquis unanimement loué, que leur reprochez-vous principalement ?
Jean-François Colosimo – En proclamant la mort de Dieu, les Lumières donnent libre cours au culte de l’humanité autonome, prométhéenne, libre de tout, y compris d’elle-même. La glorification du progrès de demain passe par la liquidation de l’obscurantisme d’hier. À commencer par le fait religieux que les Encyclopédistes transforment en une illusion et une pathologie contraires à l’avènement de la Raison. Ils en dressent une légende noire et lui attribuent le monopole de la violence. Or, la modernité, en divinisant le fait politique, va fabriquer des religions séculières purement mortifères. Voyez Robespierre et la Terreur, Lénine et le Goulag, Hitler et la Shoah : avec la descente apocalyptique du ciel sur la terre, l’homme nouveau et régénéré s’édifie sur l’élimination massive des « dégénérés ». Les totalitarismes sont d’abord des systèmes de croyance absolutisée détournant crédos, icônes et rites pour rasseoir le sacrifice sanglant.
Dieu n’est donc pas mort, la sortie de la religion est une illusion, dites-vous : mais si cela saute aux yeux dans les pays musulmans où l’islam est bien vivant et même parfois très véhément, qu’est-ce qui vous permet d’affirmer cela pour l’Occident totalement sécularisé ?
Le réveil du monde musulman nous aveugle pareillement. L’islamisme représente cet « islam des Lumières » moderne et réformé que certains appellent de leurs vœux. En ce sens, les djihadistes sont aussi les enfants des sans-culottes et des bolcheviks. Quant à l’Occident, c’est une fiction. L’Amérique se distingue foncièrement de l’Europe par sa religion civile et impériale : Dieu figure sur le dollar, le président jure sur la Bible, le Capitole est un temple et Thanksgiving un offertoire populaire. Résultat : la mobilisation de la jeunesse au service de guerres lointaines et idéalisées bat son plein. La même Europe qui se veut sécularisée se rêve sans ennemi. Dépourvue d’armée ou de diplomatie comme elle l’est de tout projet symbolique, c’est en fait elle, et non pas le christianisme, qui sort de l’histoire.
En quoi le concept de « théologie politique » cher à Carl Schmitt est-il un athéisme ?
Schmitt invente cette notion dans l’entre-deux-guerres pour expliquer pourquoi toutes les idées politiques modernes sont des concepts théologiques laïcisés. Ce qui n’est pas faux. Mais il endosse et naturalise cette mutation au point de se rallier au nazisme tout en se proclamant catholique. Sur un mode allemand, il professe « l’Église de l’ordre » contre la « révolution de l’Évangile ». Il revivifie philosophiquement les hérésies anciennes dans lesquelles il se reconnaît : comme les ariens, il préfère le monothéisme à la Trinité ; comme les manichéens, il suppose une certaine égalité entre le Bien et le Mal ; comme les marcionites, il élude Yahvé et méprise le Juif. Schmitt destitue la théologie de l’histoire, qui repose sur le mystère de la liberté, pour maximaliser la sacralité de la force qui n’est jamais que l’impiété poussée au maximum.
Parmi les « aveuglements » que vous dénoncez, comment analysez-vous la question du « choc des civilisations », est-ce un mythe ou une réalité ? Et idem pour la mondialisation, quel clivage fondamental révèle-t-elle ?
Telle qu’exposée par Samuel Huntington, la théorie du choc des civilisations est moins erronée dans l’intuition que fautive dans les développements. Les grands ensembles supposés l’animer ne sont en rien consistants : le « bloc islamique » est traversé par la guerre civile à laquelle se livrent sunnites et chiites tandis que la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie se sont dissociées du « bloc slavo-orthodoxe » pour s’associer à l’OTAN contre Moscou. Ce qui veut dire que le choc des civilisations n’empêche pas l’implosion des cultures.
Quant à la mondialisation, elle est à la fois centripète et centrifuge. Au centre, elle suscite un consommateur unique et identique. À la périphérie, elle provoque un éclatement paroxystique des identités. Plus elle unifie, plus elle nucléarise. Ce n’est pas l’un ou l’autre, mais les deux mouvements en même temps et pour longtemps. C’est aussi pourquoi le « christianisme culturel », en tant que réflexe identitaire et identité reconstruite, ne saurait être confondu avec le sursaut attendu de la foi et dont la France a besoin.
Propos recueillis par Christophe Geffroy
Jean-François Colosimo, Aveuglements. Religions, guerres, civilisations, Cerf, 2018, 544 pages, 23 €.
Cette interview a été publiée dans le n° 302, avril 2018 du magazine.
Ref. Aveuglements
Jean-François Colosimo, est un historien, essayiste, théologien, éditeur et enseignant français, auteur de plusieurs livres et films. Il est directeur général des éditions du Cerf, après avoir été président du Centre national du livre de 2010 à 2013. Chrétien orthodoxe, il enseigne depuis 1990 l'histoire de la philosophie et de la théologie byzantine à l’Institut Saint-Serge (Paris).
JPSC