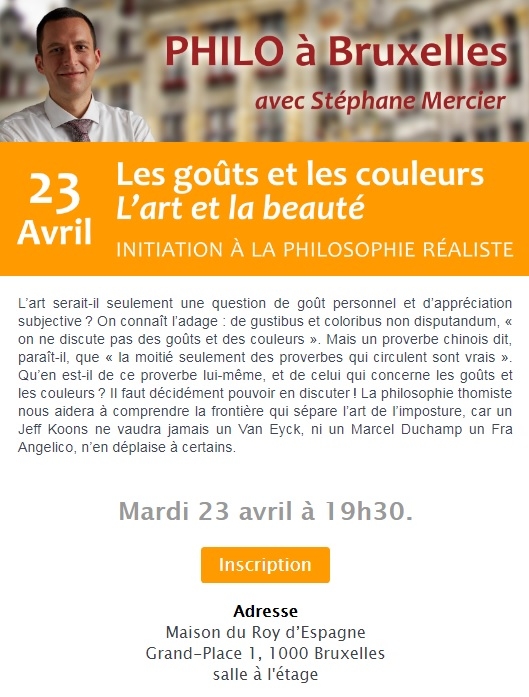Lu sur aleteia.org :

Henri Hude : « Notre société relativiste est profondément frustrante »
Dans son dernier essai, "Ce monde qui nous rend fous" (Mame), le philosophe Henri Hude, chroniqueur pour Aleteia, propose aux futurs décideurs une réflexion sur l’origine culturelle des comportements irrationnels qui se répandent dans la société et le monde du travail.
Aleteia : Pourquoi les décideurs ont-ils besoin de réfléchir sur la santé mentale ?
Henri Hude : Tout simplement parce qu’il y a un grave problème de santé publique, qui s’aggrave d’année en année, comme le signalent l’OMS et le ministère de la Santé. C’est la « crise neuronale », notamment l’épidémie de burn out et de dépression. Cette crise a des causes profondes, dans notre culture présente. Il faut une réflexion philosophique pour y faire face. Notre société sans Dieu, sans autre Absolu que notre liberté coupée du Bien, et qui se pose en Absolu, est profondément frustrante. D’autant plus profondément qu’elle s’installe dans le déni en érigeant des rationalismes réducteurs, censés protéger la psyché des émotions négatives. Ces censures bloquent la prise de conscience du problème, mais laissent prospérer la frustration. Et comme l’homme n’y comprend rien, l’angoisse se développe. Le projet postmoderne de déculpabilisation a cru aboutir, mais l’euphorie passée, la déception s’installe, et la culpabilisation, différente car plus profonde et moins consciente, revient au galop. L’individu postmoderne, pour ne pas « dévisser », se jette dans une surenchère de transgression. Mais la descente aux enfers est de plus en plus difficile. Face à sa crise, le système culturel se raidit, devient intolérant, ne tolère même plus que les questions soient posées. L’irrationalité se répand, le relativisme devient dogmatique, le délire officiel se conjugue à la censure politiquement correcte. Cette culture est pathologique.
Vous écrivez que « nos rationalismes sont des délires ». Admettons que ce soit bien là le fond de notre monde devenu fou. Cette folie ne comporte-t-elle pas des aspects plus visibles et plus concrets ?
Oui, évidemment. Mais ce sont des prolongements de ce centre de folie, et ils se constituent par rayonnement à partir de ce centre : le « doute » et les « soupçons ». Si nous n’identifions pas ce centre, nous nous battrons contre des moulins à vent, ou accuserons des boucs-émissaires. Ces prolongements forment ce que Byung-Chul Han appelle la « société de fatigue ». Ce qui repose l’âme, c’est de pouvoir jouir de Dieu au quotidien dans la paix. Ceci étant exclu par notre culture, et presque culpabilisé par notre société, la frustration est intense. Nous essayons d’expliquer nos problèmes par la libido, mais cette « libido » n’est elle-même qu’une pauvre compensation, construite par idéalisation assez délirante du désir et du plaisir sexuels. Nous en arrivons collectivement à la dynamique de transgression comme thérapie de groupe à la culpabilisation, à l’hyperexcitation dans l’instantané comme divertissement à l’angoisse. La déconstruction suicidaire de la culture fonctionne comme un substitut, une forme dégradée de mystique du Néant. Le rythme infernal du travailou du changement ne sont pas des conséquences naturelles du progrès technologique, mais des addictions pathologiques et pathogènes, une authentique névrose hystérique collective, qui, comme toute névrose, est un désordre dont le malade tire malgré tout certains profits psychiques, avant tout celui de pouvoir fuir le face à face avec la vérité : en l’espèce, la profonde fausseté de la culture postmoderne. Il faut arrêter ces folies.
Ce monde qui nous rend fous. Réflexions philosophiques sur la santé mentale, Mame, avril 2019, coll. « Humanisme chrétien », 263 pages, 22 euros.
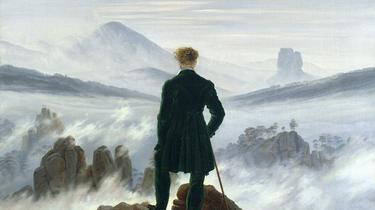
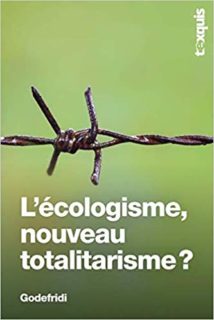

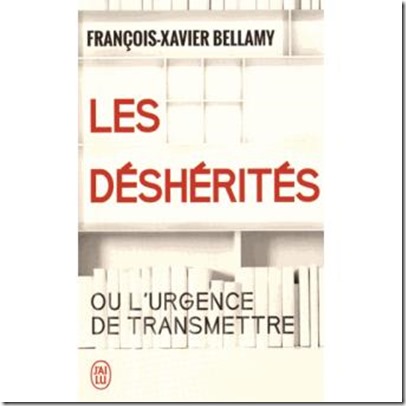
 « Les observateurs présents lors de la récente réunion de la Conférence épiscopale allemande, dans la petite ville de Lingen (Basse-Saxe), en mars dernier, ne s’y sont pas trompés. La décision annoncée par le cardinal Marx, l’homme fort de l’Église allemande, d’engager celle-ci dans une « démarche synodale » (synodaler Weg) est apparue pour beaucoup comme la première étape d’un Sonderweg, d’une voie particulière par rapport à l’Église universelle.
« Les observateurs présents lors de la récente réunion de la Conférence épiscopale allemande, dans la petite ville de Lingen (Basse-Saxe), en mars dernier, ne s’y sont pas trompés. La décision annoncée par le cardinal Marx, l’homme fort de l’Église allemande, d’engager celle-ci dans une « démarche synodale » (synodaler Weg) est apparue pour beaucoup comme la première étape d’un Sonderweg, d’une voie particulière par rapport à l’Église universelle.