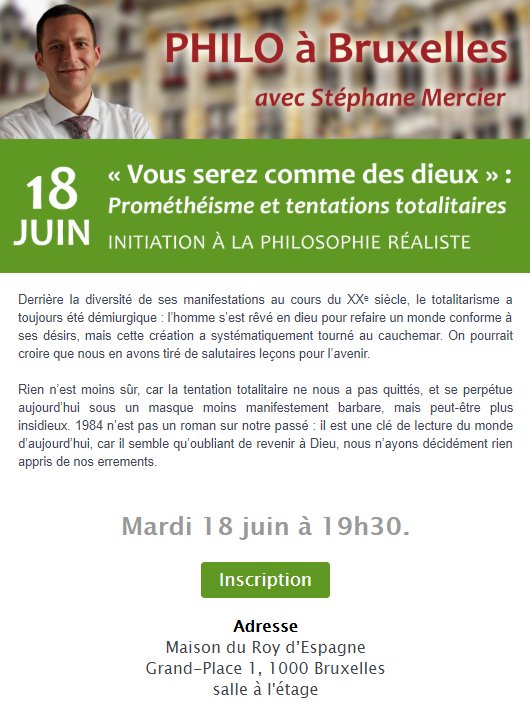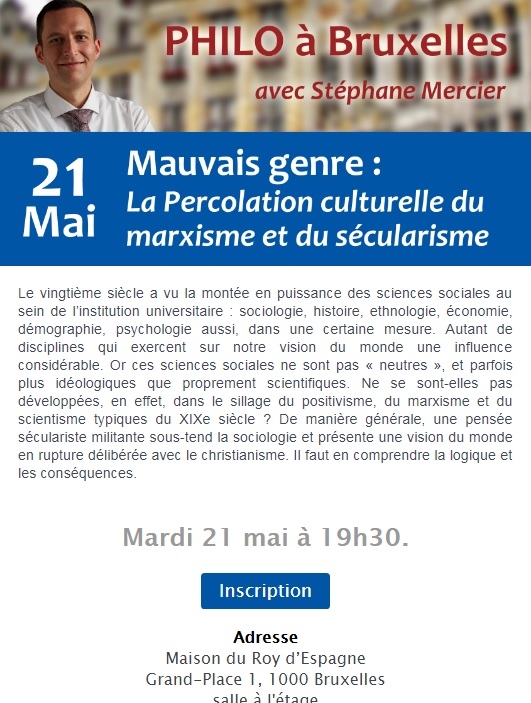Conférence de Mathieu Bock-Côté à Bruxelles sur le correctivisme politique (source)
Idées - Page 60
-
L'empire du politiquement correct; une conférence de Mathieu Bock-Côté
-
18 juin : Philo à Bruxelles avec Stéphane Mercier : "Vous serez comme des dieux"
-
Voyage au bout des ruines libérales-libertaires
De Philippe Maxence sur le site de l'Homme Nouveau :
Voyage au bout des ruines libérales-libertaires
avec Matthieu Baumier
À la jointure de l’essai polémique et de la réflexion philosophique, Matthieu Baumier s’en prend dans ce nouveau livre aux « déconstructeurs », principalement dans la version macronienne et mondialiste qui règne sans partage aujourd’hui. Avec le talent qu’on lui connaît – et qui s’épanouit dans plusieurs revues et publications, globalement conservatrices –, Baumier tire à jet continu contre cette société moderne dont il montre, derrière Zygmunt Bauman, qu’elle n’est qu’une « société liquide », s’appuyant elle-même sur une « pensée liquide ». Au cœur des ruines qu’il constate et qu’il dénonce : « L’absence absolutisée de la Limite. » Les grands prêtres de cette pensée magique, Baumier les recouvre non seulement de son mépris mais aussi d’une étiquette. Qui sont exactement les tenants du courant « libéral-libertaire » ? Tout simplement les partisans du néo-libéralisme économique et ceux de la libéralisation absolue des mœurs.
Mais notre auteur ne se contente pas de déconstruire les « déconstructeurs », de montrer l’inanité de leur modèle, la prétention de leurs ego ou leur simplisme abyssale.
Tout en gardant son ton de hussard au grand galop contre les idées faibles, il lance, ici ou là, quelques formules, afin d’indiquer la voie d’une reconstruction. Plutôt qu’anti-moderne, Baumier se voit en « contre-moderne » et, plagiant de manière revendiquée Joseph de Maistre, explique que c’est au sens, non d’une modernité contraire, mais du contraire de la modernité. Le « nouveau monde » n’a qu’à bien se tenir. À défaut d’être abattu, il est au moins démasqué.
Voyage au bout des ruines libérales-libertaires, Matthieu Baumier, éditions Pierre-Guillaume de Roux, 230 p., 17 €.
Ce billet a été publié dans L'Homme Nouveau, je commande le numéroLien permanent Catégories : Culture, Débats, Idées, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -
Europe : la voie romaine
Sur le site web France Catholique, cette réflexion d’Aymeric Pourbaix dans le contexte des récentes
 élections européennes :
élections européennes :" Parmi les surprises, nombreuses, de ces élections européennes figure la hausse de la participation – près de dix points de plus par rapport à la précédente édition en 2014. C’est d’autant plus intéressant que ce regain concerne toute l’Union européenne, avec le taux de participation le plus élevé depuis vingt ans (au-dessus de 50 %). Signe que désormais, qu’on le veuille ou non, les électeurs perçoivent l’Europe comme un élément structurant de la vie des nations. Un enjeu de pouvoir majeur.
Europe en panne
Pour autant, reste à gagner les cœurs et les âmes. Et de ce point de vue, l’Europe technocratique est en panne, à la recherche d’un sens, comme on l’a vu lors du 60e anniversaire du traité de Rome, en mars 2017, lorsque quasiment tous les chefs d’état européens se sont pressés au Vatican pour écouter le Pape. Il ne s’agit donc pas tant d’opposer les nations à l’Union européenne que de revenir à ce qui constitue le cœur de l’Europe, ce qui a présidé à sa fondation.
Dans un maître ouvrage intitulé La voie romaine, Rémi Brague affirme que ce qui constitue l’essence de l’Europe est sa « romanité », c’est-à-dire sa capacité à transmettre. De la même manière que les Romains, démontre-t-il, se sont inspirés en particulier de l’héritage grec afin de civiliser les peuples – « les barbares à soumettre ». Formant ainsi un creuset unique au monde, entre passé et avenir, facteur de progrès humain et au développement inégalé. Et dont le ciment a été le christianisme, lui qui possède la clef des rapports entre spirituel et temporel.
Or selon Brague, cette romanité est aujourd’hui menacée par la volonté de rompre avec le passé, et notamment le passé chrétien. C’est le fameux débat qui eut lieu en 2005 sur l’inscription des racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Inscription qui a été refusée mais dont l’absence est criante, tant elle masque le vide de sens.
Car cette référence n’est pas uniquement une incantation liée à un passé révolu, mais bien son principe originel, fondateur d’une culture et d’une civilisation. La foi chrétienne, ancrée dans sa romanité, c’est le « big-bang » de l’Europe : c’est de là que tout est parti.
Revenir au principe actif
C’est pourquoi, au-delà du résultat des élections, la question fondamentale est de revenir à ce principe actif, force puissante sans laquelle rien ne peut se faire, aucune création n’est durable. « En dehors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). De cette romanité revivifiée par la foi chrétienne, en revanche, tout peut repartir.
Comment ? Par l’éducation, la culture, les médias, les métiers de la transmission, etc. Il n’est pas étonnant que deux des saintes patronnes de l’Europe, Brigitte de Suède et Catherine de Sienne, aient toutes deux œuvré pour ramener vers Rome le cœur des papes et des fidèles. Nous en avons un besoin criant."
 Certes, des métissages du bas-empire romain, finalement submergé par les invasions barbares, est née une nouvelle civilisation que symbolise la superbe sculpture du chevalier de Bamberg (photo) conjuguant la sève spirituelle de la jeunesse, de la foi chrétienne et du souvenir de la grandeur de Rome.
Certes, des métissages du bas-empire romain, finalement submergé par les invasions barbares, est née une nouvelle civilisation que symbolise la superbe sculpture du chevalier de Bamberg (photo) conjuguant la sève spirituelle de la jeunesse, de la foi chrétienne et du souvenir de la grandeur de Rome. Aujourd’hui, l’Europe aux cheveux blancs a perdu la foi en elle-même, et même la foi tout court après l’avoir transmise à l’Afrique subsaharienne qui cherche à assimiler, avec son génie propre, cet héritage ouvert par la colonisation.
Qu’adviendra-t-il demain des brassages migratoires actuels: un polyèdre nébuleux ou une identité nouvelle puisée aux vraies racines d’une civilisation multiséculaire ?
Les mentalités qui prévalent de nos jours au sein du gouvernement de l’Eglise ne me paraissent pas correspondre à cette voie romaine dont parle Rémi Brague.
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Europe, Foi, Histoire, Idées, International, Jeunes, Patrimoine religieux, Société, Spiritualité 1 commentaire -
Quel acte de repentance la Belgique doit-elle au Congo ?
Selon un article publié par Belgicatho, une campagne de communication serait actuellement lancée afin d’inviter les Belges à s’excuser auprès du peuple congolais pour la colonisation. Cause toujours pourrait-on dire : sous une forme ou une autre, la colonisation est un phénomène inhérent à toute l’histoire de l’humanité.
 L’anticolonialisme ne date pas tout à fait d’hier non plus et son avatar idéologique est aussi un pourvoyeur de mythes et de légendes déformant volontiers les faits réels.
L’anticolonialisme ne date pas tout à fait d’hier non plus et son avatar idéologique est aussi un pourvoyeur de mythes et de légendes déformant volontiers les faits réels.Il en va ainsi dans l’histoire du Congo auquel, quoi qu’on en dise aujourd’hui, la Belgique a beaucoup apporté en un siècle: une conscience nationale, la langue française et la religion catholique. Mais son œuvre économique et sociale remarquable s’est noyée, dès le 30 juin 1960, dans l’immaturité politique d’un peuple auquel le colonisateur a jeté précipitamment l’indépendance à la tête, sans ménager les transitions nécessaires. Voilà certainement le reproche appelant la repentance majeure attendue de la Belgique métropolitaine dont l’inconséquence est à l’origine des heurs et malheurs qui accablent aujourd’hui encore son ancienne colonie : cette repentance elle la doit tant aux colonisés qu’aux coloniaux victimes du chaos résultant de cette décolonisation ratée.
Pour prendre la mesure de la réalité de la vie ordonnée prévalant au Congo sous le régime colonial d’autrefois, rien de tel que les témoignages des produits africains de celui-ci. Le Père Ekwa, responsable de l’enseignement catholique au Congo de 1960 à 1975 a connu la colonisation, de l’enfance à l’âge adulte. Le court extrait de son témoignage, parmi tant d'autres, renvoie au site mémoires du congo où on les trouve rassemblés.
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, Histoire, Idées, International, Justice, Politique, Société, Témoignages 0 commentaire -
Dieu, le grand oublié
Une réflexion de Jean-Pierre Snyers :
Dieu, le grand oubliéDans son livre intitulé "Traité d'athéologie", Michel Onfray écrit que l'athéisme repose sur l'indémontrabilité de l'existence de Dieu". Le moins que l'on puisse dire est que cette façon de penser n'est guère pertinente. Si on y va par là, si on se contente d'un tel "argument" pourquoi un chrétien ne pourrait-il pas lui répondre que le théisme repose sur l'indémontrabilité de l'inexistence de Dieu"? Sans s'en rendre compte, monsieur Onfray fait un acte de foi; un de ces actes qu'il accompli chaque jour en prenant sa voiture sans avoir la preuve formelle qu'il n'aura pas d'accident ou en mangeant un repas sans avoir la preuve qu'il n'est pas empoisonné.
On me dira que c'est à celui qui affirme l'existence d'une chose d'en apporter la preuve. Fort bien quand on en reste à des exemples simplistes du style de celui que l'univers a été créé par un éléphant rose. Mais quand on se trouve devant une horloge, est-ce à celui qui croit que celle-ci a comme source un horloger d'en apporter la preuve? Ne serait-ce pas plutôt à celui qui croit qu'elle n'en a pas et quelle vient du hasard de l'apporter? De même, autant je puis accepter facilement qu'un mécanicien puisse fabriquer un moteur, de même il m'est impossible de penser qu'un moteur puisse fabriquer un mécanicien ou un meuble un menuisier. Tel est pourtant ce que je devrais croire si je n'étais pas persuadé que Dieu existe. La simple logique m'amène à penser que ce qui a de la conscience d'être ne peut venir que de Celui est est la conscience d'être et que ce qui a de la vie, de la pensée, de la soif d'absolu ou de l'amour ne peut venir que de Celui qui, selon le mot de saint Thomas d'Aquin: "La totalité vivante de ce vers quoi notre coeur s'élance". Puisse notre monde basé sur le matérialisme ne pas l'oublier. Puissent les humains redécouvrir Celui qui, seul peut répondre à leurs aspirations les plus profondes.
-
Un roman vieux d’un siècle qui en dit beaucoup sur notre époque
Du Père Jean-Dominique Dubois sur aleteia.org :
Ce roman vieux d’un siècle en dit beaucoup sur notre époque
Parmi les œuvres originales de la littérature chrétienne du XXe siècle, figure "Le Maître de la Terre". Ce roman apocalyptique imagine les temps modernes sous le règne d’une religion laïque universelle débarrassée du christianisme. Le pape François en a conseillé la lecture aux journalistes qui l’accompagnaient aux États-Unis pour comprendre ce qu’est la « colonisation idéologique ».
Il y a des hommes visionnaires. L’intelligence de leur époque, de ses courants de pensée et de leurs conséquences à long terme présente indéniablement quelque chose d’impressionnant. L’auteur du Maître de la Terre est anglais, prêtre catholique (1871-1914) venu de l’anglicanisme en 1903 par souci de vérité intellectuelle quant à sa foi chrétienne. Prédicateur et écrivain, l’auteur de ce roman sur la crise des derniers temps est à la fin de sa vie, à la veille de la Grande Guerre, lorsqu’il tente de faire percevoir ce qui va arriver durant le siècle à venir si ce qu’il a compris de la pensée de son époque n’est arrêté par rien ni personne, par aucune force pouvant se mesurer à l’humanitarisme devenue religion universelle.

Robert-Hugh BensonLe Maître de la terre. La crise des derniers temps Le Maître de la terre. La crise des derniers temps, de Robert-Hugh Benson, éditions Pierre Téqui, rééd. 2000, 422 pages, 15 €
Lien permanent Catégories : Culture, Eglise, Ethique, Idées, Livres - Publications, Politique, Religions, Société 0 commentaire -
Alimentation, climat, santé, progrès, écologie... : toutes ces idées qui nous gâchent la vie
Panique morale sur l’environnement : ces idées fausses qui polluent de plus en plus le débat politique (source)
Sylvie Brunel est géographe, économiste et écrivain. Elle est notamment l’auteur de Famines et politique (Presses de Sciences Po, 2002), Nourrir le monde. Vaincre la faim (Larousse, 2009) et Plaidoyer pour nos agriculteurs (Buchet-Castel, 2017)
Sylvie Brunel publie « Toutes ces idées qui nous gâchent la vie » (JC Lattès). « C’est la fin du monde. La Terre se meurt. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Changeons nos modes de vie avant qu’il ne soit trop tard ! » Voici ce que nous entendons tous les jours. Des formules accusatrices qui nous somment de nous amender. La vie devient plus difficile. Les gilets jaunes descendent dans la rue. L’écologie devient un mot négatif, à bannir, alors qu’elle aurait dû nous mobiliser et nous passionner. Et si ceux qui nous culpabilisent en prétendant nous imposer maints sacrifices se trompaient du tout au tout ? Si leurs diktats et les sacrifices qu’ils justifient reposaient sur des indicateurs biaisés ? Oui, le monde se transforme, mais il n’est pas pire qu’hier. C’est même plutôt l’inverse : les choses vont en s’améliorant, contrairement aux discours toujours accusateurs des tenants de l’apocalypse, cette science de l’effondrement annoncé qui a désormais un nom : la collapsologie…
Extraits d’un entretien dans Atlantico.
Sylvie Brunel — La collapsologie ou science du désastre fait recette. Ce qui n’a qu’un seul effet, démobiliser : à quoi bon agir si tout est foutu ? Au lieu de nous galvaniser, tous ensemble, dans la recherche de solutions durables – ce qui a toujours été le propre de l’humanité, sinon nous ne serions pas passés d’un milliard à 7,5 milliards d’hommes en deux siècles, vivant beaucoup plus longtemps et en meilleure santé, cette vision larmoyante de l’écologie crée de la violence, de l’apartheid, des délires de mortifications individuelles et collectives, particulièrement en Europe, qui est pourtant le continent qui a le plus fait pour l’écologie. L’ère des « désastrologues », comme les appelait déjà Rabelais, ne peut qu’engendrer un vaste retour en arrière. Particulièrement sur ces questions essentielles que sont l’agriculture et l’énergie.Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Economie, environnement, Ethique, Idées, International, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -
Pourquoi l'idéologie du progressisme est incompatible avec la foi
De Laurent Fourquet sur aleteia.org :
Le progressisme dérangé par la foi
 Shutterstock-PopTika
Shutterstock-PopTikaLaurent Fourquet | 18 mai 2019
L’idéologie du progressisme se définit comme une croyance autoritaire dans l’indiscutable supériorité de notre époque pour dominer le monde et les questionnements religieux de l’homme. Dans sa logique, la victoire de la raison sur la foi n’est pas une nécessité, mais un besoin.
Le « progressisme » aujourd’hui dominant en Occident considère que la foi religieuse doit inéluctablement s’effacer devant l’explication rationnelle du monde qui la supplante en la rendant inutile. Au fond, à quoi bon croire puisque la raison rend compte de la totalité de l’univers et que nous sommes à la veille de comprendre rationnellement l’intégralité des phénomènes non seulement physiques mais aussi culturels grâce aux sciences humaines ? On aura reconnu là le thème dominant de toute une flopée d’ouvrages qui prétendent expliquer quelle merveilleuse chance nous avons de vivre à notre époque de lumière et qui, sans surprise, sont encensés par des magazines pour lesquels la supériorité de notre modernité sur ses devancières constitue précisément une conviction absolue — ce que l’on appelle aussi un dogme.
La victoire de la raison sur la foi
C’est ici d’ailleurs que le raisonnement dominant s’inverse, partant de l’éloge de la raison pour se transformer en affirmation autoritaire de l’indiscutable supériorité de notre époque. Lorsqu’une pensée se contredit au point de se transformer sans s’en apercevoir en son contraire, c’est généralement parce que ses arrière-pensées, c’est-à-dire ce qu’elle pense vraiment mais ne peut pas dire, le lui imposent. Alors, qu’en est-il du discours sur le triomphe de la raison et l’effacement irréversible de la foi religieuse ? Quelles sont les « arrière-pensées » de ce discours ? Peut-être y verrons-nous plus clair si nous percevons que, pour celui-ci, la croyance en la victoire de la raison sur la foi n’est pas une nécessité mais un besoin.
-
La Belgique est en train de vivre une dérive qui témoigne d’un vrai désarroi moral
« La Belgique est en train de vivre une dérive morale »
Un entretien publié sur le site de la Libre (Bosco d'Otreppe) relayé par Didoc.be :

Romancière, philosophe, Éliette Abécassis s’inquiète dans « L’envie d’y croire », son dernier ouvrage, de l’impact de la technique sur nos vies, notre intelligence, notre avenir. Bosco d’Otreppe l’interroge dans La Libre Belgique du 11-5-19.
— Avec le numérique, tout a changé en 20 ans, écrivez-vous. Mais quel est le point le plus fondamental qui aurait été bouleversé ?
Je pense que c’est notre rapport au monde, et donc aux autres, qui est aujourd’hui médiatisé par la technique. Le portable et les écrans ont envahi aussi bien notre espace vital que psychique : nous ne pouvons plus nous en passer. Nous sommes devenus esclaves de la technique que nous avons inventée, mais qui a pris le contrôle des rapports humains, de nos relations et qui nous « chosifie ». Je ne suis pas conservatrice, la technique a aussi apporté des bienfaits — en matière médicale notamment —, mais elle a clairement changé notre rapport au monde et à l’homme.
— Au point que « le temps des mamans est révolu », écrivez-vous dans une formule-choc. Que voulez-vous dire ?
J’ai commencé à écrire ce livre il y a 3 ou 4 ans quand j’ai offert des portables à mes enfants et que, pour ma part, tout a changé. Avant, sur le chemin du retour de l’école on bavardait ensemble, on achetait un petit pain, on prenait un goûter à la maison et on se racontait notre journée. Depuis qu’ils ont leur portable, je me retrouve dans ma cuisine, seule. Eux sont la tête penchée sur leur écran, et quand on le leur reprend, ils sont fous de rage car en proie à une véritable addiction. Mes enfants ne sont donc plus vraiment mes enfants. On les a captés. Le temps des mamans est en effet révolu. C’est le temps que les enfants attendaient pourtant avec impatience… Aujourd’hui ils préfèrent, l’école terminée, se ruer sur leurs écrans.
— Quand vous dites que la technique nous a « chosifiés », qu’entendez-vous exactement ?
Je crois qu’avec notre rapport à la technique, nous avons perdu quelque chose de profondément humain. Nous devenons d’ailleurs nous-mêmes des objets, car nous devenons un produit dès que nous naviguons sur Google. Quand un service est gratuit, c’est que nous en sommes le produit. Tous les jours nous nous vendons, nous vendons nos données, notre temps et notre âme à la technique qui est en train de nous dévorer.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Ethique, Idées, Livres - Publications, Philosophie, Société 0 commentaire -
17 mai : Philo à Bruxelles avec Stéphane Mercier : la percolation culturelle du marxisme et du sécularisme
-
Quand le cas médical difficile de "Monsieur Vincent Lambert" est devenu une "affaire" puis une "cause"
(Source) Du Père Bruno Saintôt, jésuite (DEA philosophie (Lyon III), DEA théologie (Centre Sèvres). Maître assistant en philosophie, responsable du Département Ethique biomédicale au entre Sèvres. Recherches sur le lien entre anthropologie (philosophique et théologique) et éthique) :
« Monsieur Vincent Lambert » et nous : que personne ne s’empare du tragique !
Qu’on le veuille ou non, la vie de Monsieur Vincent Lambert est liée à la nôtre, l’organisation de son soin est liée à l’organisation globale du soin médical et social. En effet, depuis la médiatisation d’un conflit qui porte sur les interprétations différentes de sa volonté et de son bien, le cas médical difficile de Monsieur Vincent Lambert est devenu une affaire puis une cause.
Sollicité pour répondre aux trois questions ci-dessous, je me sens le devoir d’écrire depuis que sa mort est, semble-t-il, définitivement programmée et médiatisée. Comment accepter que la mort de quelqu’un, une mort provoquée par la médecine et scénarisée par les journaux, fasse médiatiquement et symboliquement des gagnants et des perdants sur la scène conflictuelle de la recherche du bien ? Comment serait-il possible de réclamer, si ce jour-là arrive, un silence et un jeûne médiatiques pour que personne ne s’empare du tragique ? Comment rester dans le respect et la décence pour lui, pour ses proches, pour ceux qui sont comme lui, pour tous ? Comment refuser posément que la cause euthanasique puisse s’emparer du tragique d’une situation pour en faire une revendication ?
Selon vous, que nous dit l’affaire dite « Vincent Lambert » ? Et pourquoi le cas singulier de cet homme est-il devenu une affaire ?
Il serait d’abord bon de parler de « Monsieur Vincent Lambert » : cette personne est hospitalisée et elle doit être considérée avant tout avec respect jusque dans nos usages du langage. Parler d’emblée d’affaire, c’est la déposséder de sa singularité et du respect de sa dignité. Elle ne doit pas être le prétexte à des réclamations ou l’emblème de convictions à défendre. Il faudrait donc distinguer cas, affaire et cause.
Dans les réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) les médecins et les soignants traitent de cas, c’est-à-dire de situations singulières où il faut connaître précisément la singularité de la personne malade pour prendre une décision informée qui soit respectueuse de l’expression de sa volonté, de la relation avec ses proches et de la déontologie médicale.
Une affaire est un cas problématique exposé au grand public. Mais, quand un casdevient une affaire, les journalistes et le grand-public ne peuvent avoir accès qu’à certaines informations qui deviennent alors emblématiques d’exigences ou de réclamations concernant la justice, les droits personnels ou certaines grandes valeurs. L’enjeu est moins la singularité de cette personne et de la décision la concernant que ce qu’elle représente en fonction des valeurs et des convictions défendues par les protagonistes.
Quand l’affaire se durcit, elle devient une cause où les positions finissent par se polariser entre « pour » et « contre » en absorbant ainsi toutes les autres nuances, et donc toute la complexité du cas. « Monsieur Vincent Lambert » est ainsi devenu l’emblème de la possibilité ou non de « faire mourir », c’est-à-dire d’euthanasier une personne qui n’est pas en fin de vie, dont les directives anticipées sont inexistantes et dont la volonté est l’objet de conflits, et qui dépend du soin médical pour continuer à vivre alors même que ses conditions de vie sont jugées par certains « insupportables ».
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Doctrine, Eglise, Ethique, Idées, Justice, Médias, Politique, Santé, Société 0 commentaire