De Samuel Pruvot et Théophane Leroux, avec Erwan de Botmiliau sur le site de Famille Chrétienne :
Rémi Brague : « Notre simple existence est un défi pour le monde »
Entretien avec le philosophe Rémi Brague, pour qui la Passion reste la profanation majeure.
Qu’est-ce qu’un sacrilège ?
On ne peut pas faire pire que crucifier Dieu. Tout sacrilège perd son pantalon par rapport à la Passion ! Tout sacrilège est ridicule par rapport à ce qui s’est réellement passé.
Mesurer la gravité des actes
Pour le Catéchisme de l’Église catholique, il ne faut pas sous-estimer, d’un point de vue moral, la gravité des actes de profanation même si l’intention des profanateurs n’est pas toujours claire. « Il y a des actes qui par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances […], sont toujours illicites en raison de leur objet : ainsi le blasphème et le parjure, l’homicide et l’adultère » (§ 1756).
Les actes antichrétiens ont augmenté de plus de 220 % en dix ans… Les vols dans une église, c’est une vieille histoire : de simples larcins, avec peut-être un petit frisson blasphématoire. Les tags, profanations, etc., restent de l’ordre de la bêtise. La recrudescence de ces dix dernières années est curieuse : qu’est-ce qui a pu se passer dans le cerveau de certains détraqués dans les années 2010 ?
Les chrétiens sont-ils persécutés sous nos latitudes ?
Il y a une persécution mais qui est soft, ou plutôt une décision de la part des gens qui ont le pouvoir politique ou médiatique de ne pas nous écouter : nous comptons pour du beurre. Toute mention de ce qui est chrétien est accompagnée d’un ricanement. Que faire contre ? Peut-être montrer que nous sommes plus malins qu’eux et que nous avons à dire quelque chose de plus intéressant. Ça suppose que nous soyons deux fois meilleurs pour réussir à nous faire pardonner le fait que nous sommes chrétiens.
▶︎ À LIRE AUSSI. Rémi Brague : « Le christianisme déculpabilise »
Pourquoi le christianisme suscite-t-il la haine ?
Jésus l’a dit : le disciple n’est pas plus grand que le maître. Il est tout à fait normal que ce qui arrive au maître arrive aux disciples. Notre simple existence est un défi pour le monde : la transgression que représente l’idée d’un Dieu incarné est énorme. Cela gêne moins de supposer une sorte de division du travail comme dans le psaume : le Ciel est à Dieu, la Terre est aux hommes (1). Les religions païennes – dont l’islam – respectent cette division. Le christianisme, lui, suppose une aventure de Dieu avec l’humanité, laquelle est rendue à son tour capable d’une caractéristique divine : la sainteté. Le paganisme, c’est le refus de l’alliance entre Dieu et son peuple, qui culmine dans l’Incarnation. Et c’est l’usage idolâtrique du divin qui en fait le miroir de nos propres désirs : être tout-puissant, écraser ses ennemis, etc. C’est le rêve de chaque homme pécheur, donc notre rêve à tous si on n’y fait pas attention.
N’y a-t-il pas aujourd’hui une perte du sens du sacré ?
C’est un phénomène intéressant de la culture contemporaine : il devient de plus en plus difficile de blasphémer. Où trouver quelque chose de sacré dont on pourrait se moquer ? Toutes les différences sociales étant arasées, il n’y a plus rien d’inviolable.
Le christianisme passe pour être l’un des derniers lieux du sacré, par contresens, puisqu’il est le lieu de la sainteté, pas de la sacralité. Les chrétiens sont considérés comme étant les seuls à pouvoir être choqués. C’est devenu un fonds de commerce.
Les chrétiens sont considérés comme étant les seuls à pouvoir être choqués. C’est devenu un fonds de commerce.
Quelle est la différence entre le sacré et le saint ?
Le sacré, c’est ce par quoi vous vous soumettez à quelque chose qui demande votre vie. On le reconnaît à ce qu’il se nourrit de sang : la Nation, le prolétariat, la race… Les dieux ont soif. Le saint, c’est ce qui fait vivre, ce qui vous donne la vie, pas ce qui vous la prend. Nous employons le mot « sacré » tous les jours, mais ce qui est vraiment visé, c’est plutôt le saint. Le sacré se concentre dans l’individu et ne fait que le ramener à sa vérité de pécheur, puisque ce que je cherche dans l’idole, c’est l’idéal de ce que je devrais être. Cet individu qui n’a d’autres points de fuite que lui-même se trouve obligé de tourner en rond si la contemplation devient impossible : « Circulez, y’a rien à voir… »
C’est la liberté individuelle qui devient sacrée…
Nous nous imaginons libres, mais la liberté de l’homme moderne, c’est celle de l’esclave. Aristote dit que les hommes libres sont plus liés que les esclaves. Lorsque le fouet du garde-chiourme s’éloigne, les esclaves font ce qu’ils veulent. Les hommes libres ont la responsabilité, une conscience, un code d’honneur, les règles de la chevalerie et de la courtoisie, etc. Certaines choses se font et d’autres ne se font pas : d’une certaine manière, ils sont moins libres, puisqu’ils ne peuvent pas faire n’importe quoi. Une autre image, c’est la liberté du taxi : un taxi libre est vide, ne va nulle part et peut être pris d’assaut par ceux qui peuvent payer.
Samuel Pruvot et Théophane Leroux, avec Erwan de Botmiliau
(1) « Le Ciel, c’est le Ciel du Seigneur ; aux hommes, Il a donné la Terre » (Ps 113b, 16).
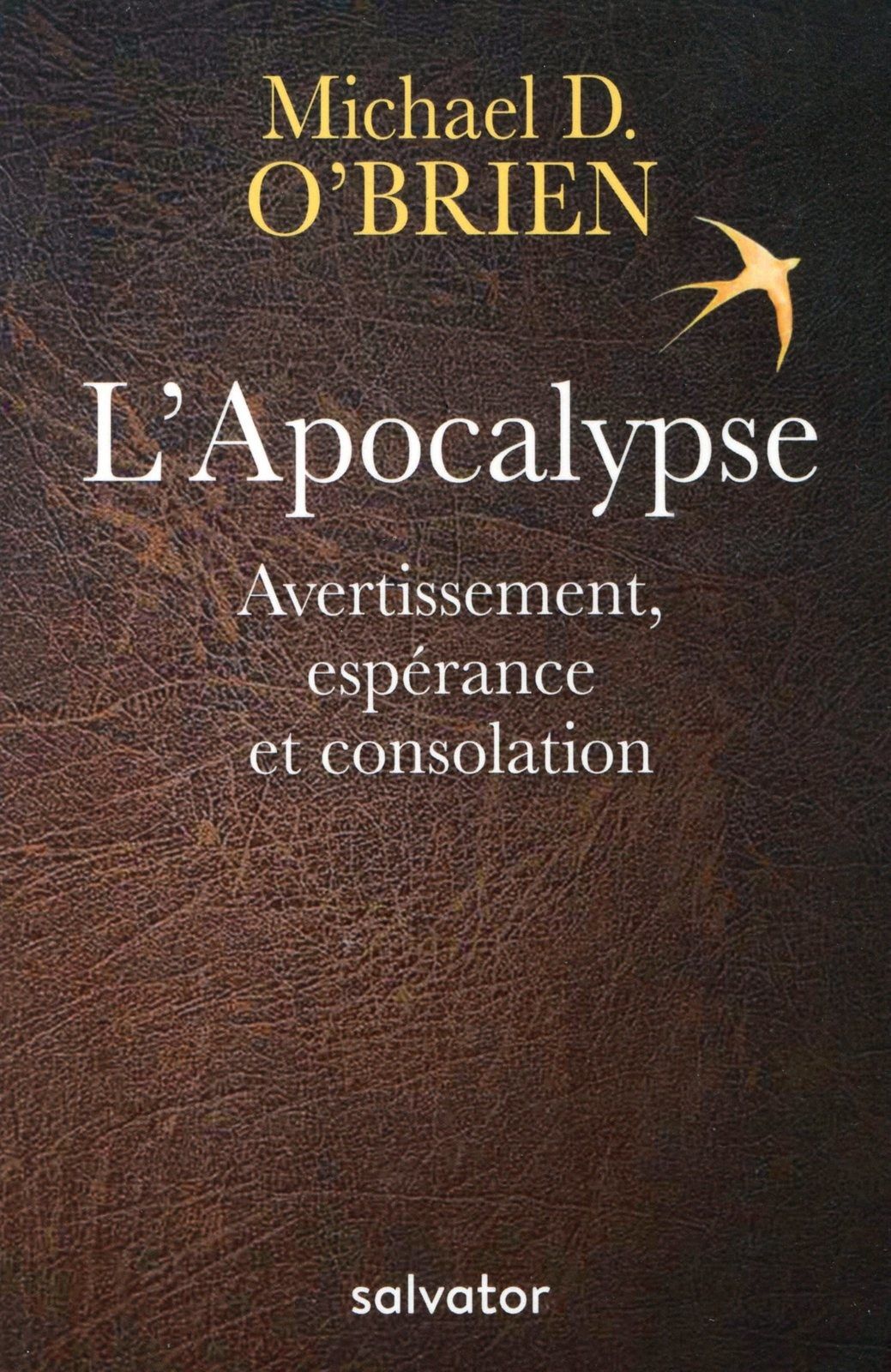



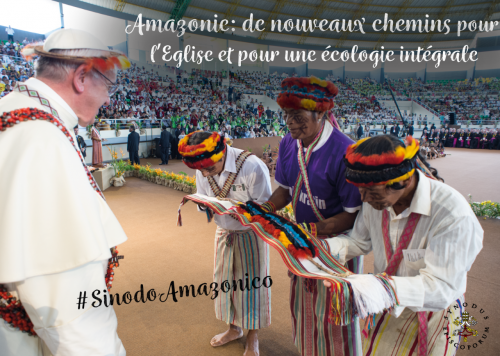 « Les élucubrations de l'"Instrumentum Laboris" m'ont fait revenir en mémoire le discours prononcé [par le Saint-Père Benoît XVI] au Sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida le 13 mai 2007, lors de la séance inaugurale des travaux de la CELAM (cf. w2.vatican.va). En voici un extrait, que les Pères synodaux seraient eux aussi bien inspirés de relire:
« Les élucubrations de l'"Instrumentum Laboris" m'ont fait revenir en mémoire le discours prononcé [par le Saint-Père Benoît XVI] au Sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida le 13 mai 2007, lors de la séance inaugurale des travaux de la CELAM (cf. w2.vatican.va). En voici un extrait, que les Pères synodaux seraient eux aussi bien inspirés de relire:

