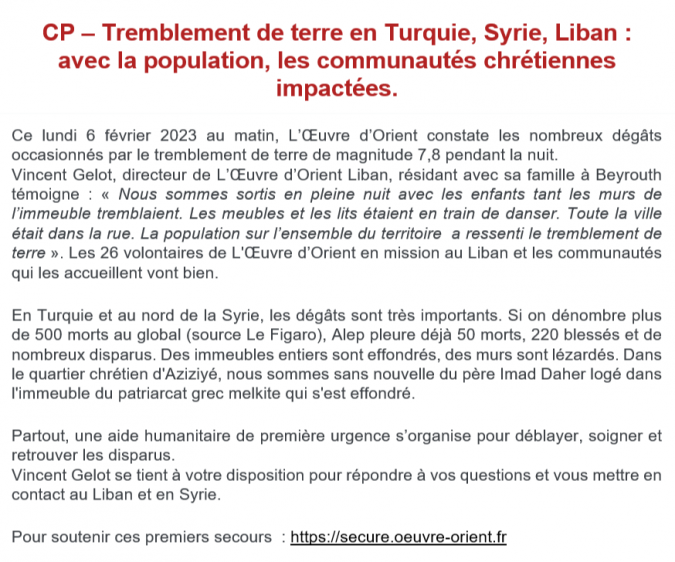De Nicola Scopeliti sur la Nuova Bussola Quotidiana :
Syrie, une triple tragédie : le tremblement de terre, la guerre et les sanctions scandaleuses
10-02-2023
"La situation était déjà très difficile en raison d'un conflit qui dure maintenant depuis douze ans. Les gens sont désespérés", explique à la Nuova Bussola la soeur Siba al Khoury d'Alep. De nombreuses régions touchées par le tremblement de terre sont sous le contrôle des rebelles et donc inaccessibles. Et puis il y a les sanctions occidentales : "Les sanctions sont inhumaines", déclare le père Francesco Patton, Custode de Terre Sainte. "et je trouve scandaleux qu'en un moment aussi tragique, nous soyons incapables de lever ou de suspendre les sanctions. Des gens meurent en Syrie".
"La situation était déjà très difficile en raison d'un conflit qui dure maintenant depuis douze ans. De nombreuses maisons avaient déjà été détruites par la guerre. Aujourd'hui, avec le violent tremblement de terre du 6 février, de nombreux autres bâtiments se sont effondrés ou ont subi de nouveaux dégâts importants. Les gens sont désespérés. Ils demandent de l'aide, mais sur leur visage, en plus de tant de souffrance, il y a de l'abattement et du désespoir. Lorsque nous parlons aux gens, nous entendons la question suivante : pourquoi cette terrible tragédie nous est-elle à nouveau arrivée ? Il est difficile de répondre, mais, en tant que sœurs, en plus de l'aide matérielle, nous avons également le devoir d'offrir une aide psychologique et spirituelle. Le Seigneur nous donnera la force d'affronter aussi cette grave situation". S'adressant à La Nuova Bussola Quotidiana, Sœur Siba al Khoury, une religieuse des Sœurs enseignantes de Sainte Dorothée-Filles des Sacrés Cœurs de Vicence, qui vit à Alep. "Nous étions au lit quand nous avons senti la secousse du tremblement de terre. Nous sommes immédiatement descendus dans la rue et sommes restés sur la route pendant plus de quatre heures, jusqu'à ce que les autorités nous donnent la permission de rentrer, pour récupérer nos affaires les plus essentielles". Leur maison a été endommagée et l'administrateur apostolique, le père Raimondo Girgis o.f.m., les a emmenées avec d'autres religieuses dans les locaux du vicariat.
De nombreux bâtiments se sont effondrés à cause de la forte secousse. D'autres, jugés dangereuses en raison des dégâts, sont en cours de démolition. "De nombreux Syriens qui se sont retrouvés sans abri abandonnent leur pays et cherchent refuge ici, à Alep. Des églises ont été ouvertes pour accueillir les personnes déplacées", explique Sœur Siba. Mais aussi des jardins d'enfants et des écoles. De même, les couvents accueillent de nombreuses familles. De nombreuses personnes ont passé les nuits dans des lieux de culte. Il fait très froid et nous sommes occupés, avec d'autres volontaires, à apporter de la nourriture et des couvertures". Elle poursuit : "Il y a un besoin d'assistance médicale, en particulier pour les personnes âgées, les femmes et les enfants". À Alep, comme dans le reste de la Syrie, il y a tant de pauvreté causée par l'embargo et les sanctions internationales. Et maintenant, il y a la difficulté de recevoir des aides. L'électricité est fournie en hoquet, pendant quelques heures par jour, poursuit Sœur Siba. Les hôpitaux sont peu nombreux, et malheureusement, il y a tant de "blessés". Les gens errent dans les rues, confus et cherchant de l'aide. Ils ont peur de rentrer chez eux. Ils vivent des heures d'angoisse car ils ne savent pas s'il y aura d'autres secousses, peut-être de forte intensité comme le prédisent les "experts".
À Alep, il y a l'hôpital catholique Saint-Louis qui fournit des soins médicaux gratuits aux Syriens les plus pauvres et les plus vulnérables. Il a reçu la visite du cardinal Mario Zennari, nonce apostolique. "Sa présence parmi nous est un signe fort de la proximité du pape et nous sommes particulièrement émus", déclare le père Bahjat Karakach, curé de la paroisse latine, "Le cardinal a également pu voir de près les destructions causées par le tremblement de terre". Un vrai drame". En Syrie, entre autres, 90 % de la population se trouvent en dessous du seuil de subsistance, et cette énorme catastrophe a rendu la population encore plus pauvre. Il est plus que jamais nécessaire que l'aide internationale atteigne la population épuisée. Malheureusement, il y a tellement d'accrocs. Difficultés d'acheminement des marchandises, difficultés d'acheminement des produits de première nécessité dans les endroits touchés par le tremblement de terre. "À Alep, poursuit Sœur Siba, les gens continuent de creuser avec leurs mains à la recherche de survivants. Dans la partie orientale de la ville, la plus bombardée pendant la guerre, de nombreux bâtiments étaient déjà précaires, maintenant avec les répliques, beaucoup se sont effondrés".
Une partie des zones touchées par ce tremblement de terre est sous le contrôle des rebelles opposés au régime de Bashar al Assad, d'autres zones sont sous le contrôle du gouvernement d'Assad. Outre les difficultés causées par le conflit, toujours en cours, les routes, endommagées par le tremblement de terre, sont aussi partiellement inutilisables en raison des chutes de neige de ces derniers jours. Les équipes de secours peinent à atteindre les localités, notamment dans les territoires du nord-ouest de la Syrie, où opère le groupe djihadiste "Hayat Tahrir al Sham" (HTS), dirigé par Mohammad al Jolani et défini par les Nations unies comme un mouvement terroriste.
Les sanctions sont inhumaines", a déclaré le père Francesco Patton, Custode de Terre Sainte, la Custodie est en effet présente en Syrie avec les communautés de la vallée de l'Oronte, d'Alep et de Lattaquié, "et je trouve scandaleux qu'en un moment aussi tragique, nous soyons incapables de lever ou de suspendre les sanctions". Des gens meurent en Syrie. L'aide qui arrive provient de pays islamiques, comme l'Égypte, l'Iran, l'Algérie... L'Occident loupe à nouveau le train". Le père Patton poursuit en soulignant qu'il semble que la plupart des aides internationales "aillent à la Turquie et que la Syrie soit coupée du circuit international précisément à cause des sanctions décidées par les États-Unis et l'Union européenne".
Il convient également de noter que la première secousse et l'essaim sismique qui a suivi ont également été ressentis en Israël. Mercredi, une secousse sismique de magnitude 3,3 a été ressentie à environ 20 kilomètres au sud-est de la ville d'Ariel, en Cisjordanie, comme l'a enregistré le Service géologique israélien. Il s'agit de la dernière d'une série de secousses de gravité variable qui ont frappé la région ces derniers jours.