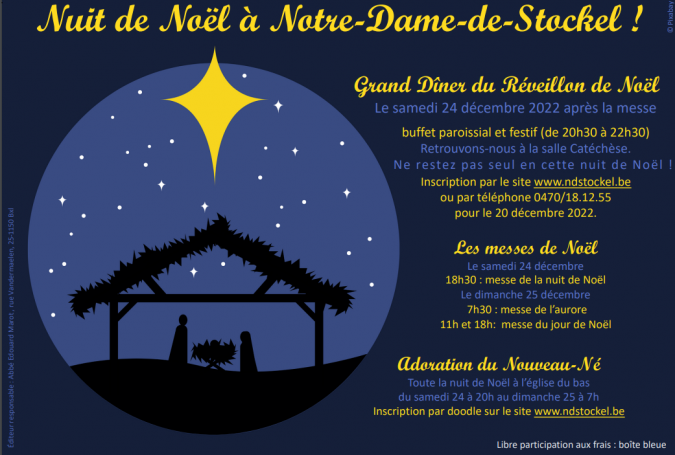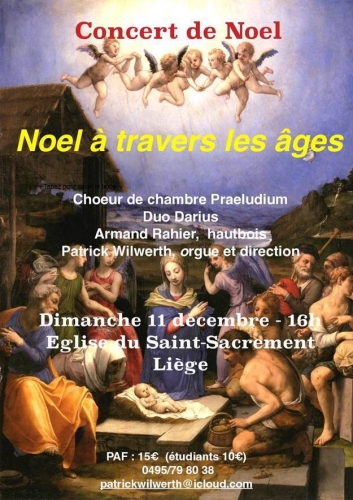En ce 4e dimanche de l’Avent, la liturgie nous donne d’entendre le récit de ce que l’on pourrait appeler l’Annonciation à Joseph : la péricope de l’Evangile selon Saint Matthieu au Chapitre 1er, versets 18 à 24.
Dans ce passage, l’évangéliste nous raconte les « origines » de Jésus-Christ.
Marie, la mère de Jésus, qui avait été accordée en mariage à Joseph, « fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint », « avant qu’ils aient habité ensemble » précise Saint Matthieu – pour exprimer combien Joseph est étranger à cette naissance ; pour nous signifier qu’il n’est pas lui-même le géniteur de cet enfant.
Joseph, « qui était un homme juste » poursuit le texte, prit donc la décision de répudier Marie.
Quoi de plus « normal » jusque là ? Voici une fiancée promise à son époux – au point que dans le judaïsme de l’époque, on les considérait déjà comme mariés – qui tombe enceinte avant d’avoir commencé une vie commune avec son époux… La conclusion s’impose comme une douloureuse évidence : Marie a trompé son époux ; elle a commis un péché d’adultère – du moins Joseph le croit-il – et il paraît juste à l'humble charpentier de Nazareth de s’en séparer légalement par un acte de répudiation... jusqu'à ce que l'Ange du Seigneur intervienne pour lui faire comprendre sa méprise et lui révéler l'origine divine de l'enfant de Marie.