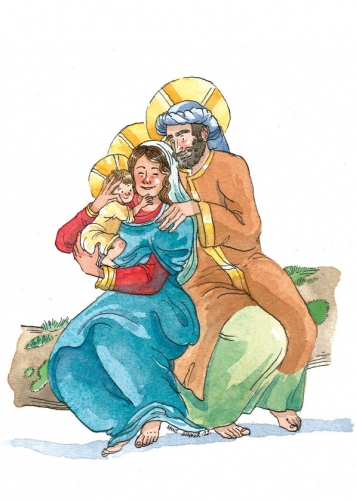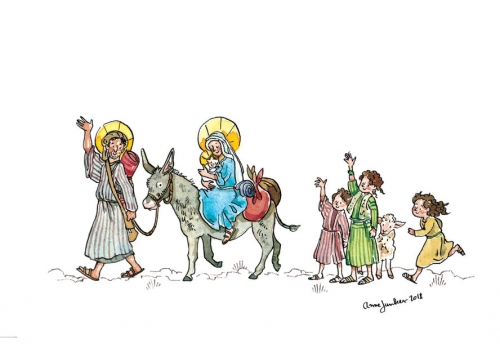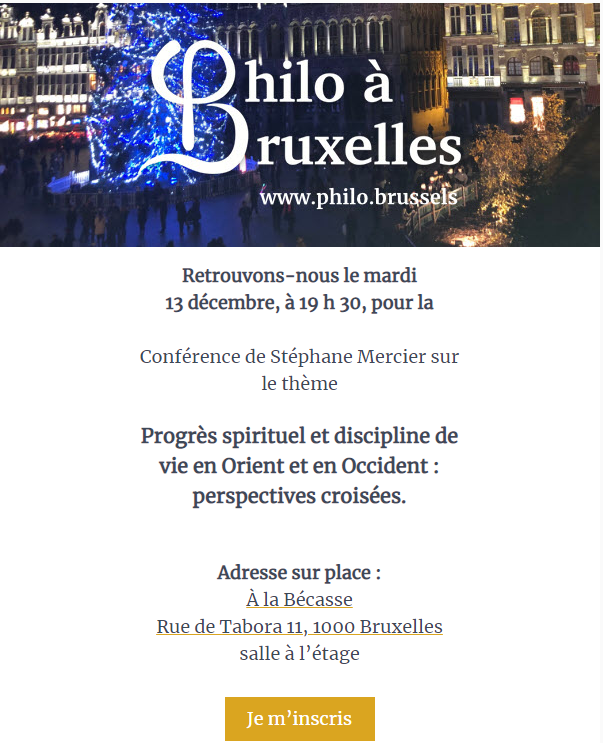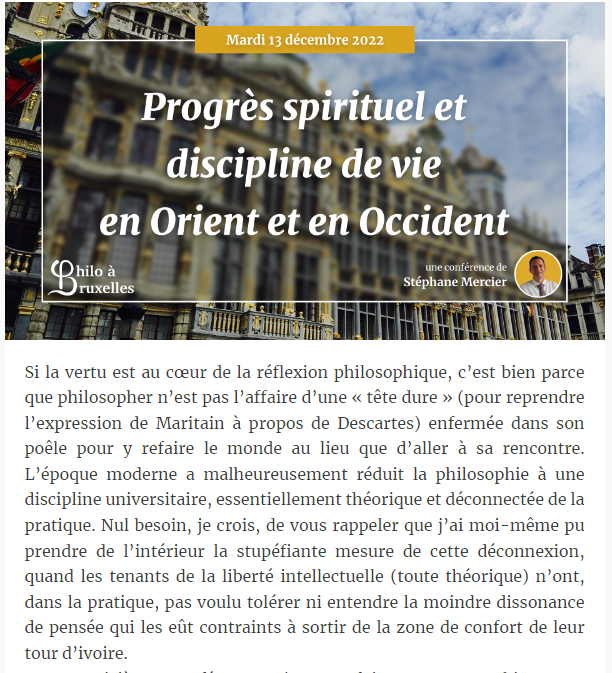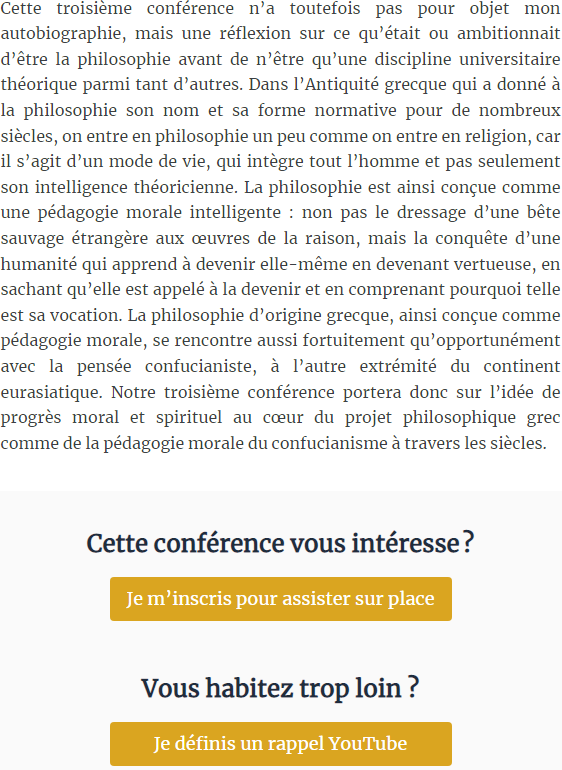D'Eric Sammons sur crisismagazine.com (traduction française de Benoît et moi) :
En communion, sans joie, avec le pape François
Comment un catholique peut-il être en communion avec le pape s’il ne veut rien avoir à faire avec lui ?
Pour les catholiques fidèles, le pontificat de François a été comme essayer de survivre à 12 rounds avec un champion poids lourd. Passons en revue quelques-uns des coups reçus :
- « Qui suis-je pour juger ? »
- « Se reproduire comme des lapins »
- « Une pluralité de religions est voulue par Dieu »
- S’acoquiner avec des politiciens pro-avortement
- Un accord scandaleux avec le parti communiste chinois
- Promouvoir le travail du Père James Martin
- Les scandaleuses nominations à l’Académie pontificale pour la vie.
Et ce ne sont là que quelques exemples ! Je suis sûr que vous pourriez en citer beaucoup d’autres. Après neuf ans de ce pontificat, la plupart d’entre nous se sentent au minimum un peu sonnés.
Cette situation malsaine peut conduire à un vrai examen de conscience. En tant que catholiques, nous sommes préprogrammés pour respecter, voire apprécier, nos papes. Mais si nous voulons être honnêtes, François est un homme difficile à aimer ou à respecter. Son antagonisme envers les catholiques traditionnels et orthodoxes indique que ce sentiment est réciproque. Un tel désamour conduit à l’inévitable question : comment un catholique peut-il être en communion avec le pape s’il ne veut rien avoir à faire avec lui ?
Ce n’est pas une question rhétorique. L’Église catholique a toujours souligné l’importance d’être en communion avec Rome. Dès les premiers jours du christianisme, Rome a été considérée comme le lieu de l’unité mondiale de l’Église. Ne pas être en communion avec le successeur de saint Pierre, c’est se séparer du corps du Christ. Mais en même temps, être un catholique fidèle signifie adhérer obstinément aux enseignements de l’Église tels qu’ils nous ont été transmis par l’Écriture et la Tradition. Alors que se passe-t-il quand on nous demande d’être en communion avec quelqu’un qui s’efforce de bouleverser ces enseignements ?
Afin de résoudre ce paradoxe troublant, nous devons comprendre ce que signifie être « en communion avec ».
Premièrement, cela ne signifie pas être « en accord » avec quelqu’un sur tous les points de vue. Après tout, chaque catholique pratiquant est actuellement en communion avec tous les autres catholiques pratiquants dans le monde, et je garantis que ces millions de catholiques ont des vues très divergentes sur la politique, l’économie, la culture, et une foule d’autres sujets. Et ce qui est encore plus remarquable, c’est que beaucoup de ces catholiques pratiquants ont probablement des opinions hérétiques. J’imagine qu’il y a un grand nombre de catholiques, par exemple, qui, si on leur demandait d’expliquer la Trinité, donneraient des réponses hérétiques par ignorance ou incompréhension. Mais nous sommes toujours en communion.
Alors que signifie « en communion avec » ? Il s’agit d’une reconnaissance visible de l’Église visible. Dans l’Église invisible du protestantisme, il n’y a pas de véritable concept de « en communion avec ». Un protestant fréquente simplement l’église qu’il aime le plus, et s’il ne l’aime plus, il part et en fréquente une autre. Il est simplement un membre visible d’une communauté locale de croyants partageant les mêmes idées, tout en demeurant dans l' »église invisible » éthérée. »
Mais pour les catholiques, c’est très différent. Nous croyons que nous sommes membres d’une Église visible et universelle, qui comprend non seulement tous les catholiques d’aujourd’hui, mais aussi tous les catholiques de l’histoire et de l’avenir – les saints et les pécheurs. Cette appartenance est une réalité mystique qui n’est pas le fruit de notre communauté d’esprit, mais de notre participation commune à la Sainte Communion.
Cette communion est à la fois horizontale – entre tous les membres de l’Église catholique – et verticale – entre le tout dernier catholique baptisé et le pape, et même le boss du pape, Jésus-Christ. En d’autres termes, notre communion n’est pas une reconnaissance du fait que nous nous apprécions tous ou que nous sommes d’accord les uns avec les autres, mais une soumission mutuelle de notre volonté à celle du Christ.
En outre, cette communion est structurée ; elle est hiérarchique. Dans les plans de la providence divine, Notre Seigneur a établi un centre pour cette communion ici sur terre – l’évêque de Rome qui est le successeur de saint Pierre. En d’autres termes, pour être en communion les uns avec les autres, nous devons être en communion avec le pape. Ce n’est pas facultatif. Nous ne pouvons pas dire : « Bon, je suis en communion avec ma paroisse locale, mais pas avec le pape ». Agir ainsi revient à rejeter la structure communautaire mise en place par Celui qui crée la communion, Jésus-Christ.
Qu’en est-il lorsque ce centre de communion devient lui-même une source de scandale ? Que se passe-t-il lorsqu’il semble s’opposer aux enseignements qui viennent du Christ ?
Certains diront que dans cette situation, François n’est pas vraiment le pape – soit il n’a pas été validement élu, soit son hérésie le démet automatiquement de ses fonctions. Mais il s’agit d’une tentative humaine de reconfigurer une réalité divine pour « résoudre » les problèmes d’aujourd’hui. Nous ne comprenons pas comment nous pouvons avoir un pape aussi mauvais et être encore en communion avec lui, alors nous essayons de régler le problème avec des solutions humaines.
Cela conduit cependant à des problèmes encore plus grands. C’est un peu comme les nombreuses tentatives anciennes d’expliquer le mystère de la Trinité avec des « solutions » humaines comme le modalisme [Doctrine hérétique qui nie la trinité des Personnes divines et considère le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme les modes d’une seule et unique substance. Le modalisme s’est répandu à Rome et en Afrique au iiie siècle, où il a été combattu par saint Hippolyte et Tertullien] ou l’arianisme [Doctrine d’Arius et de ses adeptes. L’arianisme professait que dans la Trinité, le Fils n’est pas parfaitement égal au Père ; il n’est pas de même nature (consubstantiel) et ne participe pas à son éternité (coéternel), donc sa divinité est secondaire] . De telles explications peuvent sembler plus simples et donc plus faciles à accepter pour les hommes et les femmes, mais elles conduisent en fin de compte à des une incompréhension de fond de notre Eglise et de notre communion en elle.
Comme nous l’avons déjà noté, notre communion est structurée ; elle est hiérarchique. Cela signifie que les membres ont des rôles différents à jouer, et ce n’est pas le rôle du laïc individuel – ou d’un prêtre ou d’un évêque individuel – de déclarer qu’un pape n’est plus pape ou qu’il n’a jamais été pape. En effet, le fait même qu’une quasi-unanimité de la hiérarchie reconnaisse aujourd’hui François comme pape indique clairement que nous devons l’accepter comme pape, et donc être en communion avec lui.
La papauté est un mystère de notre foi, et les mystères, naturellement, peuvent être difficiles à comprendre ou à accepter. Notre situation difficile actuelle me rappelle Jean 6:68-69, lorsque Jésus demande aux Douze s’ils vont aussi le quitter à cause de l’enseignement difficile de l’Eucharistie. Saint Pierre répond : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ; et nous avons cru, et nous avons appris à connaître que tu es le Saint de Dieu. » L’apôtre principal ne comprenait pas comment il était censé manger la chair du Christ et boire son sang, mais il en était venu à accepter Jésus comme le divin Sauveur et donc, pour saint Pierre, la parole du Christ était suffisante.
De même, il peut être compliqué d’accepter aujourd’hui le difficile enseignement de la papauté et la nécessité pour nous d’être en communion avec elle. Au temps de papes saints et sages, cet enseignement est naturel et facile. Mais nous ne vivons pas à une telle époque. Nous devons donc dire avec saint Pierre : « Seigneur, à qui irons-nous ? » Notre Seigneur a fait de la communion avec le pape une partie essentielle de la foi catholique – quelque chose qui a été attesté et pratiqué depuis 2 000 ans. Nous ne pouvons pas l’abandonner maintenant, même face à de graves défis.
C’est le test de notre époque. Essayerons-nous de « résoudre » humainement le problème de la papauté de François, ou ferons-nous confiance à notre Seigneur et resterons-nous en communion avec Rome, même en dépit des défis que cette communion apporte ? Nous pouvons avoir l’impression d’être au milieu d’un combat de poids lourds, mais notre devoir est de persévérer jusqu’au bout, quels que soient les coups que nous pouvons recevoir en chemin.