Contrairement aux idées reçues, le célibat n'a rien d'anormal ni d'ahurissant: en ce moment dans le monde, des millions de gens vivent dans le célibat, soit ordinaire, soit religieux (pensons aux moines bouddhistes!). Chez nous, même si le Christ ne l'a pas imposé, dès le début le célibat fut en honneur, librement, chez ceux qui devenaient prêtres; ou bien les hommes mariés renonçaient aux relations charnelles une fois ordonnés. Il devint une règle obligatoire dans le rite latin partir du XIIe iècle. A la différence de l'indissolubilité du mariage (qui est une `loi divine´), c'est donc une `loi ecclésiastique´ que, théoriquement, l'Eglise pourrait rendre facultative (comme c'est le cas chez les catholique de rite oriental).Mais Jean XXIII lui-même disait: `Nous ne le pouvons pas: le célibat est un sacrifice que l'Eglise s'est imposé librement.´ Et Vatican II `approuve et confirme´ cette loi à 95,98 pc des voix en 1965. D'autre part, il est faux de prétendre qu'il serait la cause principale de la rareté des vocations: la même crise se retrouve chez les pasteurs protestants, pourtant mariés pour la plupart; c'est une question de foi, comme le mariage religieux. Faux aussi d'affirmer qu'il inclinerait à la pédophilie: assurément ces faits, s'ils sont réels dans une frange minime du clergé, sont particulièrement graves: mais oublie-t-on que l'immense majorité des pédophiles vivent en couples?
Pourquoi donc cette `obstination´, malgré les échecs qu'on ne nie pas (même si `un seul pont qui craque fait plus de bruit que 100 ponts qui tiennent´ )? En fait, nonobstant les pressions de ceux que Joseph Folliet appelait déjà en 1964 `les marieurs de curés´, il existe `une haute convenance´ entre sacerdoce et célibat pour plusieurs raisons.1) D'abord, il est possible, car il ne rend pas les gens ni névrosés, ni frustrés. L'histoire abonde en exemples de célibataires équilibrés et joyeux. `Le Christ ne pouvait pas proposer aux hommes une voie qui les diminuerait´, pensait Mgr Ancel. Mais le célibat consacré appelle bien sûr en complément une certaine forme de vie fraternelle et une solide vie de prière.2) Surtout, c'est un soutien spirituel pour les gens mariés, qui, au fond, tiennent beaucoup plus qu'on ne le pense à notre célibat. Vécu dans la joie, le célibat est un puissant soutien pour leur chasteté et leur fidélité conjugales. `Si les laïcs peuvent pratiquer sans effort héroïque la chasteté prénuptiale, la chasteté et la fidélité conjugales, affirmait Jean Guitton, c'est en fait parce qu'ils voient vivre hors des cloîtres des êtres jeunes, forts, virils, radieux et radiants, qui sont chastes avec joie, avec aisance: les prêtres. L'abnégation de quelques-uns élève et assainit l'atmosphère pour tous.´ 3) Dans une société comme la nôtre, hyperérotisée, obsédée par le sexe, le témoignage du célibat consacré apparaît beaucoup plus indispensable qu'au XIXe iècle: ce n'est vraiment pas le moment de le remettre en cause! Car dans un monde qui tire de gras bénéfices du commerce des revues et des cassettes pornographiques, qui invente à la TV `l'île de la tentation´, qui encourage les moeurs les plus libres presque avec fierté, voilà précisément de quoi faire réfléchir: quel témoignage contestataire et révolutionnaire!
4) Ah! Je rêve d'un saint Paul passant à la TV pour souligner cette extraordinaire et joyeuse unité de vie qui est la nôtre!... Cessons de laisser croire que les séminaires regorgeraient d'adolescents prolongés, impubères et innocents: pendant 6 ou 7 ans, les responsables veillent à ce que les candidats aient, avec la grâce de Dieu, l'équilibre nécessaire. C'est donc en ne donnant son corps à personne que le prêtre peut donner son âme à tous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner toute sa vie pour ceux qu'on aime...5) Mais au-delà de l'étonnante disponibilité qu'il procure, le célibat se justifie avant tout - on ne le dit presque jamais - parce qu'il est rappel lumineux de la primauté du spirituel et anticipation eschatologique, si pauvre soit-elle, de la vie céleste `où on ne prend plus ni femme ni mari´ (Mt 22,30). Les valeurs charnelles de la sexualité, bénies par le Créateur, restent terrestres et provisoires. Ainsi, sans foyer humain sur cette terre, nous misons tout sur Dieu. Vatican II (dont on fait souvent une lecture curieusement sélective) l'a souligné fortement. Et c'est précisément parce qu'il est cette solennelle profession de foi en la vie éternelle que les forces du mal, pratiquement chaque semaine, s'attaquent à ce célibat. Il dérange: c'est le dernier verrou que l'on entend faire sauter! Le philosophe Marcuse, vers mai 68, pensait que le moyen le plus efficace de déclencher la subversion dans la société était de la bouleverser dans le domaine sexuel en général, et, en particulier, d'ébranler le célibat sacerdotal, considéré comme une citadelle: la capitulation générale s'ensuivrait immanquablement. Autant savoir...
En fait, ce que cherchent `les marieurs de curés´ , ce n'est pas tant des prêtres mariés, disait férocement le Père Manaranche, que des `prêtres divorcés´ . Ce serait tellement rassurant: `Voyez, ils sont comme nous´ ... Il est bien vrai qu'on peut s'égarer dans le célibat; tout comme d'ailleurs dans le mariage. D'où parfois le sourire des gens mariés devant la naïveté des prêtres `hors-les-murs´ qui s'imaginent que le mariage - idéalisé - va résoudre leur difficulté à vivre: or, on voit déjà apparaître des prêtres mariés qui sont séparés ou qui divorcent.
Guy Gilbert - pas suspect, pas `célibataire endurci´ ... - témoigne avec joie: `Aucune recette de cuisine pour ça. La prière quotidienne, patiente, laborieuse, aimante demeure le suprême aliment qui fortifiera un célibat qui reste et restera aux yeux du monde folie, question, étonnement, contestation.´ C'est pourquoi les prêtres, qui se trouvent heureux dans leur célibat, qui sont sans aucun complexe et sans infantilisme, qui ne ruminent aucun ressentiment contre l'`institution´ Eglise, qui sont psychologiquement sains, sexués comme tous les hommes, sensibles à la beauté, sereinement et respectueusement à l'aise devant une femme, sont pourtant sans regret de n'être pas mariés, tout en éprouvant une grande admiration pour le mariage. Et le complément irremplaçable de leur célibat, c'est une étonnante paternité spirituelle.
Oui, il importe que le prêtre de rite latin, aujourd'hui plus que jamais, reste célibataire. Il est appelé par pure grâce à manifester que le Seigneur est encore meilleur que les plus belles de ses créatures, et qu'il peut suffire, à lui seul, à combler de bonheur, à pleins bords et dès cette terre, le coeur d'un être humain. Avez-vous déjà assisté à une ordination sacerdotale? C'est prophétique, à contre-courant des slogans païens. Ces jeunes hommes peuvent dire en vérité au peuple chrétien, transposant les paroles de la Consécration: `Voici mon corps, livré pour vous.´ Quand on les voit étendus sur le pavé de la cathédrale, tandis que déferlent sur eux les superbes litanies des saints de tous les temps, que le sol tremble et que les anges du ciel les regardent en frémissant, ce spectacle, comme dirait Bernanos, `a de quoi faire réfléchir ceux qui baîllent à la grand-messe du dimanche´ . Moi, chaque année, il m'arrache des larmes de joie.
Doyen du Chapitre cathédral de Namur Directeur de la Revue `Pâque Nouvelle´
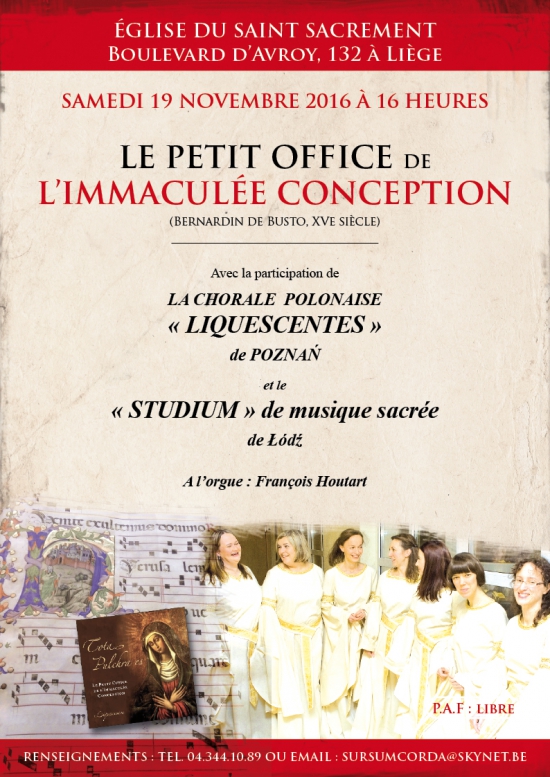
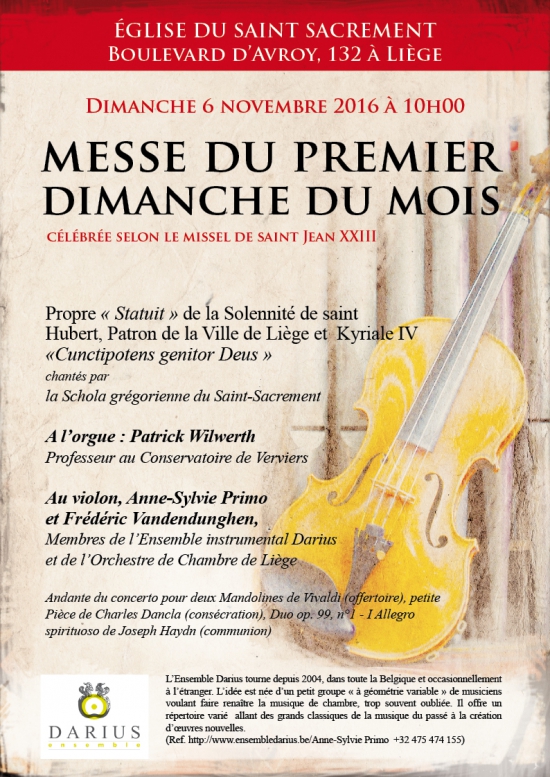


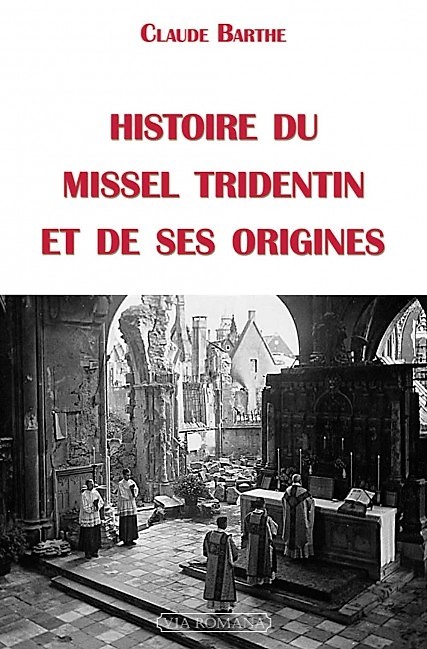
 Le voyage du pape François à Lund et Malmö pour le lancement du 5° centenaire de la Réforme nous remet en mémoire la question fondamentale de l’ecclésiologie à laquelle se réfèrent les communautés protestantes et de savoir exactement sur quoi on « dialogue » lorsqu’on parle d’œcuménisme.
Le voyage du pape François à Lund et Malmö pour le lancement du 5° centenaire de la Réforme nous remet en mémoire la question fondamentale de l’ecclésiologie à laquelle se réfèrent les communautés protestantes et de savoir exactement sur quoi on « dialogue » lorsqu’on parle d’œcuménisme.