De Regis Martin sur le National Catholic Register :
Le cardinal van Thuan, l'héroïque "témoin de l'espérance" qui a passé 13 ans dans une prison communiste
L'archevêque vietnamien a passé neuf ans en isolement, mais a déclaré : "Grâce à l'aide de Dieu, je n'ai jamais regretté mon destin."
3 août 2021
Peu de temps après la chute de Saigon - la plus belle des villes, autrefois connue comme le Paris de l'Orient - face à l'avancée des forces de l'armée nord-vietnamienne en avril 1975, marquant ainsi la fin du Sud-Vietnam indépendant, des centaines de milliers de soldats et de civils ont été systématiquement rassemblés et placés dans des camps dits de rééducation, où beaucoup d'entre eux ont langui pendant des années.
L'un d'entre eux était l'archevêque coadjuteur de Saigon récemment nommé, Francis Xavier Nguyen van Thuan, qui, en plus d'être visé en tant qu'homme de foi profonde et résolue, était le neveu du premier président de la nation, Ngo Dinh Diem, et donc un ennemi présumé de l'État. Les communistes étaient déterminés à réduire au silence toute opposition, en particulier lorsque sa source était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Dieu, par exemple, et tous ceux qu'il inspire. À cette fin, l'archevêque a passé 13 ans en prison, dont neuf en isolement.
Qu'est-ce que cela a dû être d'être enfermé dans des circonstances où, non seulement vous n'êtes pas autorisé à sortir, mais vous êtes forcé de rester entièrement seul ? Pendant neuf années ininterrompues, pas moins ? Certains d'entre nous (moi y compris) trouveraient sans doute que neuf minutes seraient presque insupportables.
Mais pour l'archevêque van Thuan, dont la vie avait été si récemment merveilleusement productive, la douleur de voir tout cela soudainement dépouillé par un système cruel et injuste a dû être indicible.
"Seul dans ma cellule de prison, se souvient-il, je continuais à être tourmenté par le fait que j'avais 48 ans, dans la force de l'âge, que j'avais travaillé pendant huit ans comme évêque et acquis tant d'expérience pastorale, et que j'étais là, isolé, inactif et loin de mon peuple."
Ce fut le moment le plus bas de sa vie. Et le fait de savoir, bien sûr, qu'il ne pouvait rien y faire - aucun tribunal n'allait intervenir pour défendre sa cause, rétablir l'honneur de son nom ou apporter la preuve des innombrables bonnes œuvres accomplies - lui a laissé le plus âpre sentiment d'abandon.
"Le plus dur, avouera-t-il plus tard, c'est que j'ai commencé à me sentir impuissant. Mes plans, mes activités, mes efforts, tout cela ne servait à rien. Cette impuissance pratique a décrit mon état pendant 13 ans. Je voulais faire tant de choses pour servir mon peuple, mais je ne le pouvais pas."
C'est alors qu'il a commencé à penser d'une manière nouvelle et plus profonde à la Croix, à l'impuissance pure et simple de l'Homme-Dieu qui y était suspendu dans une agonie mortelle. Il se rendit compte qu'il y avait là une âme sœur, quelqu'un qui avait plongé encore plus profondément que lui dans le bourbier du découragement.
"Lui aussi était immobilisé. Il ne pouvait ni prêcher, ni administrer aucun sacrement. Lui aussi était impuissant." Et pourtant, malgré la profonde impuissance et la douleur que le Christ lui-même a supportées, "c'est de là qu'il a accompli sa plus grande action : il nous a rachetés, nous les pécheurs. Grâce à son aide, je n'ai jamais regretté mon destin".
En effet, tout s'est cristallisé pour lui un soir où, au plus profond de son propre cœur, il a senti une voix, claire et sans équivoque, qui lui demandait directement : "Pourquoi te tourmenter ? Tu dois discerner entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tout ce que vous avez fait et désirez continuer à faire, les visites pastorales, la formation des séminaristes, des sœurs et des membres des ordres religieux, la construction d'écoles, l'évangélisation des non-chrétiens. Tout cela est un excellent travail, l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas Dieu ! Si Dieu veut que vous abandonniez tout cela et que vous remettiez le travail entre ses mains, faites-le et faites-lui confiance. Dieu fera le travail infiniment mieux que vous ; il confiera le travail à d'autres qui sont plus capables que vous. Vous n'avez qu'à choisir Dieu et non les œuvres de Dieu !
Quelle découverte stupéfiante ! Qu'au milieu de toutes ses douleurs, Dieu l'ait poussé à voir la différence, qui n'est pas plus grande que celle que peuvent imaginer la foi ou la théologie, entre les œuvres de Dieu, dont nous avons tous reçu l'abondance, et le Dieu qui les accomplit. Que nous sommes d'abord sauvés par ce que Dieu est, bien avant que nous puissions être sauvés par ce qu'il fait.
"Cette lumière", nous dit-il, dont la source ne pouvait être que Dieu lui-même, "a totalement changé ma façon de penser. Lorsque les communistes m'ont mis dans la cale du bateau, avec 1 500 autres prisonniers, et nous ont déplacés vers le nord, je me suis dit : "Voici ma cathédrale, voici les gens dont Dieu m'a donné la charge, voici ma mission - assurer la présence de Dieu parmi ces frères désespérés et misérables. C'est la volonté de Dieu que je sois ici. J'accepte sa volonté".
C'est devenu, dit-il, le moment de sa libération. "Et à partir de ce moment, une paix nouvelle a rempli mon cœur et est restée avec moi pendant 13 ans." À chaque instant par la suite, malgré tout ce que les circonstances extérieures conspiraient pour contrecarrer et même pour tuer son esprit, il recuit sa volonté, désormais fortifiée plus que jamais par la grâce de Dieu, "pour vivre le moment présent, en le remplissant à ras bord d'amour."
Francis Xavier Nguyen van Thuan est finalement libéré de prison en 1988, et passera les 14 années restantes de sa vie (il est mort en 2002), "devenant", comme nous le rappellera le pape Benoît dans son encyclique Spe Salvi, "pour les gens du monde entier, un témoin de l'espérance - de cette grande espérance qui ne vacille pas même dans les nuits de solitude".
En 2001, il a été créé cardinal par le pape Jean-Paul II, et en 2017, il a été déclaré vénérable par le pape François.

 Sursum Corda asbl
Sursum Corda asbl
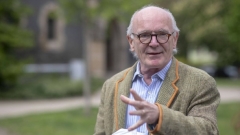 Lu et traduit cet article de Martin Moselbach (*) publié sur le site web américain « First Things » :
Lu et traduit cet article de Martin Moselbach (*) publié sur le site web américain « First Things » :