De Claire Lesegretain sur le site du journal la Croix :
Un évêque vietnamien face au communisme
Biographies. Deux livres consacrés à Mgr Van Thuan (1928-2002) rappellent la foi inébranlable de ce « martyr » du XXe siècle, dont le procès de béatification est en cours.

Mgr Van Thuan (ici en 2001) passera treize années en captivité au Vietnam, de 1975 à 1988. / Ciric
- Monseigneur Thuan. Un évêque face au communisme, d’Anne Bernet, Tallandier, 544 p., 23,90 €
- Van Thuan Libre derrière les barreaux, de Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Nouvelle Cité, 332 p., 21 €
Lorsque François-Xavier Nguyen Van Thuan vient au monde en 1928 à Hué, toutes les fées semblent se pencher sur son berceau. Sa mère Hiep appartient à la lignée aristocrate des Ngo Dinh, dont les ancêtres au XVIIe siècle furent parmi les premiers Vietnamiens à se convertir au catholicisme, et parmi les premiers à mourir martyrs au XVIIIe siècle. Son oncle Diem sera nommé ministre de l’intérieur de l’empereur Bao Dai en 1933.
Brillant, doué pour les imitations et les langues, le jeune Thuan sait dès l’âge de 13 ans qu’il deviendra prêtre. Le voilà interne à An Ninh, petit séminaire élitiste désireux de former de futurs saints. Au grand séminaire de Phu Xuan, il se rêve en curé de campagne. Mais après son ordination en 1953, il est nommé vicaire dans l’une des plus grosses paroisses du diocèse de Hué, ce qui présage une carrière foudroyante dont le père Thuan ne veut pas mais à laquelle il lui sera difficile d’échapper.
La superbe biographie qu’Anne Bernet consacre à cette grande figure de l’Église au Vietnam mêle intelligemment le parcours douloureux de ce « descendant des martyrs » avec l’histoire tout aussi douloureuse de son pays, soumis à de brusques revirements politiques puis à un régime dictatorial. Ainsi, l’oncle Diem devenu, en 1954, premier ministre d’un gouvernement soutenu par les États-Unis dans le Sud-Vietnam, qui se proclame l’année suivante président de la nouvelle République du Vietnam, sera assassiné à Saïgon en 1963.
Innombrables interrogatoires
Après un doctorat de droit canon à Rome en 1959, le père Thuan est rappelé au Vietnam où l’Église a besoin de nouveaux chefs. « Ne laissez pas une fausse modestie égarer votre jugement. Vous devez vous préparer à tenir ce rôle », lui explique l’évêque de Hué en le nommant au petit séminaire d’An Ninh.
Nommé évêque de Nha Trang (sud-est) en 1967, il fait inscrire sur son anneau épiscopal le « Todo pasa » de Thérèse d’Avila : « Tout passe, Dieu seul suffit. »Dans ce diocèse de 130 000 catholiques, il met en œuvre Vatican II, visite chaque paroisse, couvent et établissement scolaire, encourage les séminaristes, développe les formations pour laïcs afin qu’ils puissent résister à l’ennemi communiste…
Car, du fait des victoires du Vietnam du Nord (soutenu par l’URSS) sur le Vietnam du Sud (soutenu par les États-Unis), la réunification du pays sous le joug communiste s’annonce. Effectivement, lorsque Paul VI le nomme archevêque coadjuteur de Saïgon le 24 avril 1975, la ville vient de devenir Hô Chi Minh Ville. Là, dans le presbytère d’une paroisse excentrée, le « neveu des Ngo Dinh » est arrêté le 15 août 1975. Sans jugement, il est placé en résidence surveillée, et soumis à d’innombrables interrogatoires visant à lui faire avouer qu’il est « un espion du Vatican et un agent de l’impérialisme ».
Abandonné entre les mains de Dieu
Mgr Thuan résiste avec foi et bienveillance. Il est autorisé à célébrer seul sa messe quotidienne mais ne doit parler à personne. Il parvient pourtant à écrire et à faire passer des centaines de feuillets qui seront publiés sous le titre Sur le chemin de l’espérance (1976). Une audace qu’il paiera par de longs mois d’emprisonnement dans un cloaque nauséabond. « Cette détention était bonne pour lui et profitable au salut des âmes. Par conséquent, il lui fallait l’accepter et tenter de la faire tourner à son bénéfice et à celui de l’Église », écrit Anne Bernet avec finesse.
Une finesse qui manque parfois à l’ouvrage de Teresa Gutiérrez de Cabiedes, qui commence au 15 août 1975 et décrit, avec force détails, les conditions sordides des détentions successives de l’évêque, totalement abandonné entre les mains de Dieu. Transporté en bateau en 1976 dans le Vietnam du Nord, il est emprisonné deux ans près de Hanoï, puis six ans dans une résidence des agents de la Sécurité publique où il lui est toujours interdit de parler à qui que ce soit. « Les communistes savaient que, même emprisonné, Mgr Thuan représentait toujours un danger, incarnant à la fois la figure politique d’un Walesa et celle, religieuse, d’un Wojtyla vietnamien », écrit Anne Bernet. Mais, à force de gentillesse et d’humour avec ses gardiens, il parvient à se faire traiter avec humanité.
Après treize années de captivité, Mgr Van Thuan sera exilé à Rome, avant d’être fait vice-président puis président du Conseil pontifical Justice et Paix (1998-2002) et, enfin, créé cardinal un an avant sa mort, en 2002.
Claire Lesegretain
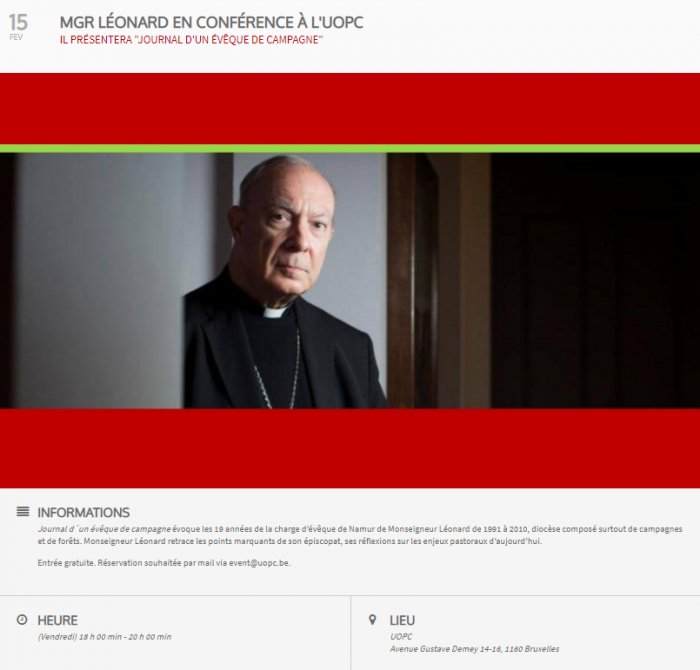
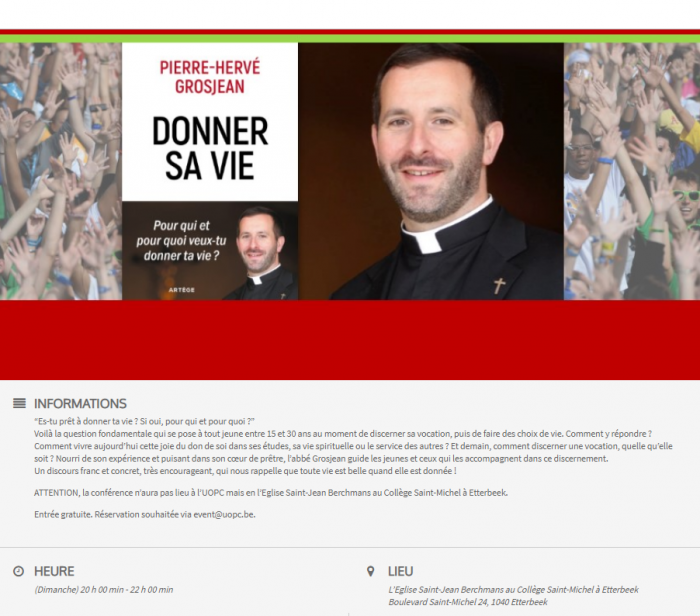

 Comme le laissait prévoir l’archevêque de Kinshasa, la conférence épiscopale du Congo n’était pas représentée hier à l’intronisation de Félix Tshisekedi comme président successeur de Kabila par la grâce des manipulations électorales de ce dernier :
Comme le laissait prévoir l’archevêque de Kinshasa, la conférence épiscopale du Congo n’était pas représentée hier à l’intronisation de Félix Tshisekedi comme président successeur de Kabila par la grâce des manipulations électorales de ce dernier :