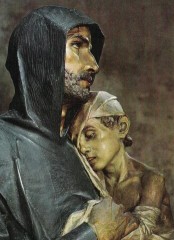De Hugh Somerville-Knapman OSB sur le Catholic Herald :
Pax Invictis par Tess Livingstone : la vie et l'héritage du cardinal George Pell
8 mars 2025
Pour ceux qui vivent aujourd'hui, l'héritage de George Pell sera à jamais marqué, voire défini, par la parodie de justice qu'il a subie de la part du système judiciaire de l'État australien de Victoria. L'État de Victoria était l'État d'origine de George Pell, et le traitement épouvantable qu'il y a subi devrait nous alerter sur un élément peu connu de la réalité de sa vie d'adulte : en dépit de son éminence et de son rang, il était en grande partie un étranger. Pour beaucoup, dans ses deux foyers, l'Église et l'Australie, le courage des convictions de Pell était pour le moins déstabilisant. Beaucoup ne voulaient pas l'entendre.
En effet, il semblait avoir quelque chose de Georgius contra mundum, et Pell s'est souvent retrouvé, sinon seul, du moins isolé. On peut dire que cela a été le plus évident lors de sa nomination au Vatican au Secrétariat de l'économie par le pape François en 2014. Conformément à sa mission avouée de réformer la curie papale, François a nommé un homme dont il savait certainement qu'il avait des principes tout en étant expérimenté dans les réalités de l'administration ecclésiastique, qu'il était loyal sans être un larbin, qu'il agissait plutôt qu'il ne parlait, qu'il était tenace et intrépide, même s'il était parfois trop inflexible, et qu'il était imperméable aux blandices ou aux menaces. Comme François l'a dit à un évêque anonyme : « C'est un homme honnête ». Trop honnête, peut-être.
Une telle personne est susceptible d'être accueillie avec au moins de l'ambivalence dans la plupart des endroits. Dans sa préface au livre de Tess Livingstone, George Weigel souligne le traitement papal auquel Pell a été confronté à partir de 2014. Après avoir affiché des références réformistes, François les a renforcées en nommant Pell pour faire face à l'enchevêtrement des finances du Vatican. Le pape et le préfet étaient tous deux des outsiders curiaux, et tous deux apparaissaient comme des hommes qui n'accepteraient aucune absurdité. Weigel note que l'outsider Pell avait deux options lorsqu'il est entré dans la fosse aux lions curiale : aller lentement et essayer de gagner les récalcitrants, ou « mettre la pédale au plancher » et faire le maximum dans ce qui pouvait être, et était, une petite enveloppe de temps. Sans surprise, Pell a choisi cette dernière voie : l'ingratitude soyeuse n'était pas sa ligne de conduite.
Ce choix était basé, selon Weigel, sur l'hypothèse que François était aussi sérieux que Pell dans son intention de réformer les finances du Vatican, et que Pell bénéficierait donc d'un soutien papal sans faille. Dans la pratique, certaines décisions de François ont renforcé le pouvoir des récalcitrants et sapé celui qu'il avait nommé, son compagnon d'infortune, comme le révèle Livingstone. Pell était un outsider, même pour le pape lui-même, et n'a jamais fait partie de la cour parallèle que François a créée entre lui et la curie établie. Pell, qui n'était pas un béni-oui-oui, s'est retrouvé seul à tenir un calice empoisonné : un outsider à la fois pour l'ancienne et la nouvelle curie papale, et de plus en plus une cible.
Au fur et à mesure que la deuxième édition, entièrement mise à jour, de la biographie de Livingstone, parue en 2002, avance, Pell l'outsider apparaît clairement. Pell a été trahi au cœur même de l'Église à laquelle il avait consacré sa vie, et il a été trahi dans son pays natal par une société dont il était un fier fils. Il était loyal envers les deux, mais n'a jamais pu s'accommoder des faiblesses et des défauts de l'un ou de l'autre. Nous voyons qu'il avait des amis, bons et loyaux, mais peut-être trop peu là où il en avait le plus besoin.
Livingstone est manifestement une admiratrice de Pell, comme le serait toute personne qui prendrait soin d'examiner objectivement sa vie et son héritage ; son livre permet à cette vie et à cet héritage d'être mieux connus. Il s'agit rarement d'une biographie critique, et elle tend même parfois vers l'hagiographie, mais ce qu'elle présente de la vie et de l'œuvre de Pell justifie son approche positive. Compte tenu de la plume venimeuse de plusieurs journalistes australiens, dont les livres sur Pell sont au mieux des hachettes et au pire des calomnies éhontées, il était impératif qu'un compte rendu plus gracieux, généreux et complet de la vie et de l'héritage de Pell voie le jour, et qu'il le fasse.