De Massimo Introvigne sur Bitter Winter :
Ukraine : Les orthodoxes unis contre Poutine
03/02/2022
Même l'Eglise orthodoxe en communion avec le Patriarcat de Moscou a appelé les Ukrainiens à la résistance, comparant le président russe à Caïn.
Il y a un aspect religieux dans la guerre en Ukraine, et certaines de ses caractéristiques sont surprenantes et paradoxales. D'autres ne le sont pas. Dans son premier discours à la nation dans lequel il a annoncé l'intervention armée, Poutine a évoqué le lien entre le "monde russe" et l'Église orthodoxe dirigée par le patriarche de Moscou. Il a également offert comme preuve des conspirations occidentales en Ukraine le fait qu'en 2018, l'Église orthodoxe ukrainienne s'est séparée du Patriarcat de Moscou et a rejoint l'autre grande juridiction orthodoxe mondiale, le Patriarcat œcuménique de Constantinople, qui est basé à Istanbul, l'ancienne Constantinople.
Tous les orthodoxes ukrainiens n'ont pas accepté cette décision. Certains sont restés avec le patriarche de Moscou dans l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou. M. Poutine a déclaré que ces orthodoxes ukrainiens en communion avec Moscou étaient persécutés par l'Église orthodoxe ukrainienne majoritaire et par le gouvernement, et que l'un des objectifs de ses troupes était de mettre fin à ces persécutions.
Environ soixante pour cent des Ukrainiens adhèrent à l'Église orthodoxe ukrainienne en communion avec le patriarche œcuménique de Constantinople. Un chiffre estimé entre quinze et vingt pour cent fait partie de l'Église en communion avec le patriarche de Moscou. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine compte également des catholiques : plus de quatre millions, soit un peu moins de dix pour cent de la population. Ils suivent le rite grec, ce qui signifie qu'ils ont des traditions, un droit canonique et des pratiques liturgiques différents, mais restent en pleine communion avec le Saint-Siège. Il existe également une importante minorité de catholiques de rite latin.
Pour compléter la carte des chrétiens ukrainiens, il existe près de dix mille communautés protestantes. Les Témoins de Jéhovah comptent également plus de neuf cents salles du Royaume et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom d'Église mormone, compte une quarantaine de congrégations et l'un de ses temples se trouve à Kiev.
La situation religieuse en Russie est également importante pour comprendre la guerre. Ici, dans les sondages, plus de 60 % de la population affirme faire partie de l'Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou. Toutefois, ce chiffre inclut de nombreuses personnes qui ne participent que rarement ou jamais aux activités de l'église, et le Patriarcat de Moscou s'inquiète de sa perte d'influence auprès des jeunes générations. Invité par les autorités politiques ou par le Patriarcat lui-même, je suis intervenu dans plusieurs conférences en Russie sur les causes de ce phénomène. Mon impression est qu'il y a des causes communes à la plupart des pays européens, qui ont été frappés par des vagues de sécularisation plus ou moins agressives, et une cause spécifique à la Russie, où beaucoup considèrent que le Patriarcat de Moscou ressemble trop souvent à une agence de relations publiques pour Poutine, une sorte de "ministère de la religion" du régime.
De nombreux évêques orthodoxes n'acceptent toutefois pas cette analyse, qui exigerait une certaine autocritique de leur part. Ils attribuent leurs problèmes à la concurrence agressive des religions et des "cultes" importés de l'Occident, dont le nombre est cependant relativement faible et ne peut statistiquement pas expliquer l'hémorragie de membres actifs qui a frappé le Patriarcat.
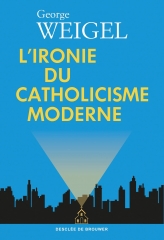 L’Américain George Weigel, auteur d’une biographie de référence de Jean-Paul II, vient de publier en français un essai important défendant une thèse quelque peu iconoclaste : catholicisme et modernité (*) ne s’opposeraient pas. Thèse certes discutable, mais qui mérite assurément d’être présentée ici, car elle ouvre la porte à un nécessaire débat de fond dans l’Église sur cette question essentielle. Le site web du mensuel la Nef qui publie cette analyse de Anne-Sophie Retailleau promet d’y revenir plus en détail dans un prochain numéro de la revue….
L’Américain George Weigel, auteur d’une biographie de référence de Jean-Paul II, vient de publier en français un essai important défendant une thèse quelque peu iconoclaste : catholicisme et modernité (*) ne s’opposeraient pas. Thèse certes discutable, mais qui mérite assurément d’être présentée ici, car elle ouvre la porte à un nécessaire débat de fond dans l’Église sur cette question essentielle. Le site web du mensuel la Nef qui publie cette analyse de Anne-Sophie Retailleau promet d’y revenir plus en détail dans un prochain numéro de la revue….  Retraçant avec brio 250 ans de l’histoire de l’Église, confrontée à l’émergence de la pensée moderne, George Weigel entend réfuter cette historiographie traditionnelle qu’il estime erronée. Ainsi, entreprend-il une analyse originale des rapports entre catholicisme et modernité, et déroule le fil de l’histoire de l’Église dans son rapport avec ce nouveau défi des temps contemporains. Cette relation est d’abord marquée par un rejet originel des nouveaux principes de la modernité issus de la Révolution française. Progressivement, l’enchaînement aboutit à une lente maturation entraînant l’Église, sous l’impulsion de papes visionnaires, au dialogue avec le monde moderne. Cette longue histoire de maturation constitue pour l’auteur « le drame du catholicisme et de la modernité », compris comme le déroulement d’une action scénique divisée en cinq actes. Chacun de ces moments marque les étapes d’un apprivoisement de la modernité par l’Église. Non dans le but de s’y soumettre, mais au contraire de proposer une nouvelle voie de recherche de la vérité qui répondrait aux aspirations les plus nobles auxquelles le monde moderne aspire.
Retraçant avec brio 250 ans de l’histoire de l’Église, confrontée à l’émergence de la pensée moderne, George Weigel entend réfuter cette historiographie traditionnelle qu’il estime erronée. Ainsi, entreprend-il une analyse originale des rapports entre catholicisme et modernité, et déroule le fil de l’histoire de l’Église dans son rapport avec ce nouveau défi des temps contemporains. Cette relation est d’abord marquée par un rejet originel des nouveaux principes de la modernité issus de la Révolution française. Progressivement, l’enchaînement aboutit à une lente maturation entraînant l’Église, sous l’impulsion de papes visionnaires, au dialogue avec le monde moderne. Cette longue histoire de maturation constitue pour l’auteur « le drame du catholicisme et de la modernité », compris comme le déroulement d’une action scénique divisée en cinq actes. Chacun de ces moments marque les étapes d’un apprivoisement de la modernité par l’Église. Non dans le but de s’y soumettre, mais au contraire de proposer une nouvelle voie de recherche de la vérité qui répondrait aux aspirations les plus nobles auxquelles le monde moderne aspire.

