Lu dans la rubrique "La Journée" de la Libre de ce jour :
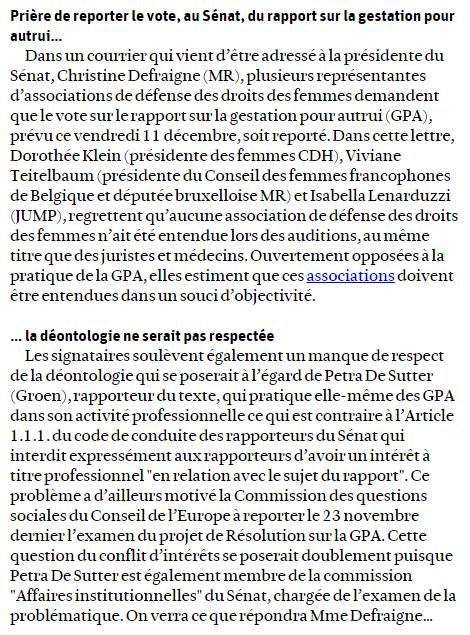
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Lu dans la rubrique "La Journée" de la Libre de ce jour :
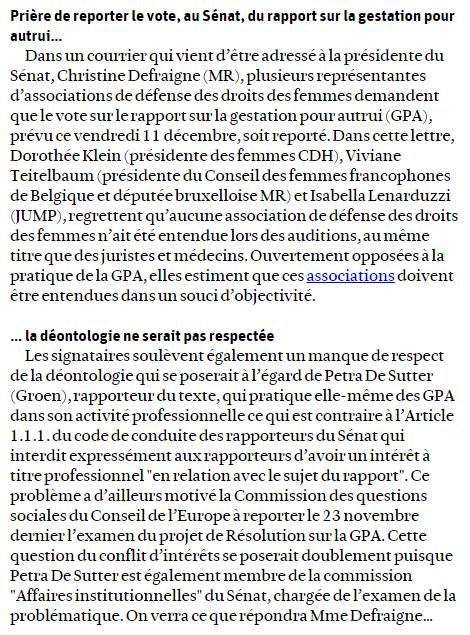
Daech a-t-il un rapport avec l’islam ? (25 mn, par Arnaud Dumouch, 7 déc 2015)
Qu’est-ce que le salafisme ? Est-ce un simple « piétisme » ? C’est une lecture fondamentaliste du Coran incréé, dicté par Dieu, infaillible en tout et même en science. Pour le salafisme, le Texte Sacré incréé est à prendre LITTERALEMENT.
Le salafisme conduit-il au Wahhabisme et à Daech (l’Etat islamique violent) ? Comparaison avec la lecture des chrétiens Evangéliques du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament n’est pas le Coran. Le Coran contient de nombreux versets violents.
Daech a-t-il la source de son antijudaïsme violent et de son organisation totalitaire dans le Nazisme et le communisme ? Non, c’est une apparence. Il a juste un cheminement qui présente des analogies fortes, mais cette haine des Juifs est issue de ses propres sources (Coran et Hadiths), accompagné d’un mécanisme d’échec extérieur, d’orgueil intérieur « nous sommes la meilleure communauté » et de théorie du complot Juif expliquant tout « L’Antéchrist sera un Juif borgne » (Hadith).
Pourquoi cela ne va-t-il pas s’arrêter ? Lire la prophétie d’Ezéchiel 38, 2 qui provoqua l’espoir des zélotes et la guerre des Juifs contre les Romains de Flavius Josèphe http://eschatologie.free.fr/livres_au... : « Au moment où tout semblera perdu, Dieu donnera la victoire au peuple saint ». Ezéchiel 39, 12
Est-ce que cette guerre vient de l’islam et de ses textes, comme semble le dire le Président d’Egypte Al-Sissi ? Que penser du « Pas d’amalgame » ?
Arnaud Dumouch est philosophe et théologien catholique. Il s'est spécialisé dans l'eschatologie, théologie des fins dernières.
Sur l'islam, dans un regard catholique, consulter "Le mystère de l'islam", Editions Docteur Angélique, http://www.docteurangelique.com/titre...
Du Bulletin d'Information de l'Institut Européen de Bioéthique :
Edition spéciale ! Non à l'euthanasie pour souffrances psychiques
Belgique : deuxième alerte de spécialistes sur l’euthanasie pour souffrances psychiques
Ce mardi 8 décembre 2015, 65 spécialistes ont publié dans le journal belge De Morgen, une carte blanche dénonçant l’euthanasie pour souffrances psychiques, pointant "l’impossibilité d’en objectiver l'incurabilité". «Nous voyons, par exemple, comment certaines personnes qui ont été déclarées incurables et qui, sur cette base, ont obtenu le droit à une euthanasie, y renoncent parfois finalement quand de nouvelles – et fragiles – perspectives se font jour. Ceci prouve paradoxalement que la maladie ne pouvait être qualifiée d’incurable. »
Cette mise en garde n’est pas la première. Au mois de septembre déjà, une carte blanche publiée dans Le Soir par une quarantaine de professionnels avait défrayé la chronique. L’évènement déclencheur à l’époque, avait été le cas d’Emily, connue sous le nom de Laura, qui, à l'âge de 24 ans, avait obtenu le droit d’être euthanasiée. Cette dernière s’était finalement rétractée au dernier moment. Mais tout le processus était en place avec l’aval des médecins.
Le cas de Laura a beaucoup secoué les professionnels de la santé, particulièrement dans le domaine psychiatrique, qui y voient une interprétation excessive de la loi. Pour eux, « le caractère inapaisable de la souffrance mentale ne peut être constaté ». Or, comme le montrent les chiffres d’une étude réalisée par des experts belges et publiée dans le Journal du Médecin de juillet 2015, les cas d'euthanasie pour souffrances psychiques ont tendance à se multiplier. Cette étude, portant sur 100 demandes d’euthanasie pour souffrance mentale entre 2007 et 2011, révèle ainsi que 48% des demandes d’euthanasie pour raison psychique ont été acceptées par les médecins.
Et le cas récemment médiatisé du Docteur Van Hoey, filmé en train d’assister le suicide d'une de ses patientes, une dame âgée, déprimée à cause du décès récent de sa fille, n'a fait que renforcer l'inquiétude des professionnels. La Commission de contrôle de l’euthanasie a d'ailleurs décidé derenvoyer ce dossier devant le Parquet, ce qui constitue une première en Belgique et témoigne du malaise sur cette question.
Ce vendredi 4 décembre aux cliniques Saint Luc, s’est tenu un colloque « Euthanasie et psychiatrie »au cours duquel Ariane Bazan, Professeur de Psychologie à l’ULB et signataire des deux cartes blanches, a pu développer ses inquiétudes sur la pratique actuelle de l’euthanasie pour motif psychique. Cette dernière a ainsi expliqué qu’un psychiatre ne peut jamais déclarer un patient définitivement condamné, puisque la dépression est par définition un trouble ou une souffrance subjective qui peut brutalement prendre fin, dans un contexte particulier ou au contact d’un professionnel particulier. Il y a en définitive autant de possibilité de traitements que de soignants. Insistant sur la spécificité du traitement psychiatrique, Ariane Bazan a ainsi affirmé qu'« il n’y a pas de patients intraitables, il n’y a que des thérapeutes incapables. »
Au cours du même colloque, Francis Martens, Psychologue, Président du Conseil d’Ethique de l’APSY-UCL, a dénoncé la pratique de l’euthanasie envers les personnes dépressives, estimant qu’il s’agissait là d’une démission des politiques et de la société dans la résolution des problèmes sociétaux actuels. Il est en effet avéré que les deux principales causes de dépression sont la solitude et le chômage. Au lieu de résoudre directement ces problèmes, la société n’aurait pour seule réponse que le suicide et l’euthanasie ? C’est la question qu'a posée Francis Martens.
Tout en se disant « alarmés par la banalisation croissante de l’accès à l'euthanasie pour seul motif de souffrance psychique », les 65 signataires de cette deuxième carte blanche insistent « pour que soit retirée de la législation actuelle la possibilité d’une euthanasie au seul motif de souffrance psychique. »
Source: RTBF, Le Journal du médecin, La Libre, Le Soir
ETUDE | Le sommet de la COP21 ambitionne de limiter à 2 °C la hausse de la température sur Terre d’ici à la fin du siècle. Les négociateurs s'appuient sur un diagnostic substituant à la complexité du climat une simplification qui, en incriminant le CO2, institue un processus dont la politique humaine aurait la maîtrise. Si tout engagement politique coûteux — on parle de 100 milliards de dollars par an — a besoin de certitudes, la science a besoin de libre discussion critique. Or celle-ci est écartée. Pourquoi ?
QU'EN EST-IL DE L'IMPACT de l’activité humaine sur notre environnement ? Comment l’apprécier en vérité et objectivité ? Ces questions sont liées à trois types de discours : 1/ la science qui décrit des phénomènes complexes, 2/ la politique qui doit gouverner pour l’avenir, 3/ l’interface entre les deux, qui est la représentation des conclusions scientifiques par les médias, représentation qui forge l’opinion et pour ainsi dire un « inconscient collectif ». Or la science témoigne toujours de la complexité tandis que les médias et les politiques ont besoin d’idées plus simples (I). Jusqu’où la simplification du complexe peut-elle légitimement aller ? (II) Comment se produit le réchauffement climatique et qu’en disent les scientifiques ? (III)
Commençons par étudier comment fonctionne le rapport entre science et politique : ce qu’on appelle le « principe de précaution »
Lire la suite sur Liberté Politique
Le Salon Beige relaie les propos de René Brague publiés par FigaroVox :
Tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans
Rémi Brague est interrogé par Le Figaro sur les terroristes et l'islam. Extraits :
"Les djihadistes qui ont mené les attentats de janvier et du 13 novembre en appellent à Allah. Ont-ils quelque chose à voir avec l’Islam ?
De quel droit mettrais-je en doute la sincérité de leur islam, ni même le reproche qu’ils adressent aux « modérés » d’être tièdes. Rien à voir avec l’islam ? Si cela veut dire que les djihadistes ne forment qu’une minorité parmi les musulmans, c’est clair. Dans quelle mesure ont-ils la sympathie, ou du moins la compréhension, des autres ?J’aimerais avoir là-dessus des statistiques précises, au lieu qu’on me serine « écrasante majorité » sans me donner des chiffres.
Les djihadistes invoquent eux-mêmes Mahomet, le « bel exemple » (Coran, XXXIII, 21). Ils expliquent qu’avec des moyens plus rudimentaires qu’aujourd’hui, il a fait la même chose qu’eux : faire assassiner ses adversaires, faire torturer le trésorier d’une tribu vaincue pour lui faire cracher où est le magot, etc. Ils vont chercher dans sa biographie l’histoire d’un jeune guerrier, Umayr Ben al-Humam, qui se jette sur des ennemis supérieurs en nombre pour entrer au paradis promis. Il n’avait pas de ceinture d’explosifs, mais son attitude ressemble fort à celle des kamikazes d’aujourd’hui.
Les imbéciles objectent souvent : « Oui, mais Hitler était chrétien. » Ce à quoi il faut dire que : 1) non seulement il avait abandonné la foi dans laquelle il avait été baptisé, mais il haïssait le christianisme. Les Églises, catholique et protestantes, étaient sur son cahier des charges et devaient, après la victoire, subir le même sort que les Juifs ; 2) à ma connaissance, Hitler n’a jamais été donné en exemple aux chrétiens.
Le but des terroristes semble être de déclencher en Europe une guerre civile entre les communautés musulmanes et le reste de la population. Comment éviter que la communauté musulmane soit identifiée au terrorisme ?
Effectivement, il est prudent de dire ce que ce but semble être. Nous le devinons à partir de cas précédents comme les Brigades rouges italiennes : créer des conditions dans lesquelles la répression atteindra, même sans les viser, l’ensemble des musulmans, afin de créer chez eux un réflexe de solidarité avec les terroristes. Je ne sais d’ailleurs pas si cela a jamais marché…
Il y a là-derrière un problème de logique : tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans. Donc être musulman est une condition nécessaire pour être islamiste, mais elle n’est pas suffisante. Pour tout musulman, être islamiste est une possibilité mais, heureusement, ce n’est pas une nécessité. Il est stupide de prêter a priori de noirs desseins à tous les musulmans. On a donc raison de ne pas les mettre tous dans le même panier. Les gens qui peignent des slogans hostiles sur les mosquées sont des crétins malfaisants qui font le jeu des islamistes de la façon que je viens de dire.
Il serait bon que l’effort pour éviter le fameux « amalgame » soit clair des deux côtés. Et que les musulmans trouvent un moyen de faire comprendre haut et fort, par la parole comme par le comportement, qu’ils désapprouvent le terrorisme. Le problème est que personne n’a autorité pour les représenter.Nous aimons mieux les « modérés ». Mais les intellectuels médiatiques qui parlent en leur nom représentent-ils d’autres qu’eux-mêmes ? [...]
Une opinion de Hadrien Desuin publiée sur Aleteia.org le laisse penser :
Quand l’Europe vend son âme à la Turquie
L'accord migratoire fait entrer en Europe une Turquie islamiste et autocratique.
Les années passent et la Turquie du parti islamiste AKP dévoile peu à peu son visage. De scrutin en scrutin, la démocratie turque donne à Erdogan toujours plus de pouvoirs et d’audace. Au besoin en faisant revoter les électeurs récalcitrants. La presse acculée voit ses derniers journalistes indépendants surveillés, censurés, menacés, arrêtés. La police, la magistrature, les armées sont sous contrôle. Les partis kurdes sont caillassés ou incendiés. La répression a repris de Gaziantep à Diyarbakir. L’islamisation d’abord rampante, se fait désormais au grand jour. Les femmes sont reléguées ou sommées de se voiler.
A mesure que le régime turque se durcit, l’Europe qui lui faisait face s’amollit. Le rapport de force s’est inversé. Hier âpre à la négociation, l’Europe aujourd’hui se tait devant les violations répétées des libertés. Le matin, Orban est sermonné à Budapest quand il jugule le flot de migrants et l’après-midi Erdogan est courtisé à Ankara. Pour avoir laissé transiter des centaines de milliers de migrants, de nouveaux chapitres d’adhésion de la Turquie vont s’ouvrir.
Pompier pyromane du Moyen-Orient, après avoir sévi en Libye et agité l’Égypte, la Turquie se durcit aussi à l’extérieur. Elle ose s’attaquer à la Russie en Syrie.
Ses tentatives pour renverser Bachar Al-Assad se sont heurtées à la résistance russe. Mais s’il a renoncé à Damas, Erdogan n’a pas mis une croix sur Alep. Par l’intermédiaire de ses alliés djihadistes et des minorités turkmènes, il entend garder la main sur son étranger proche. Il veut conserver sa tutelle sur tout le nord syrien, Kurdistan compris.
L’Allemagne se soumet et entraîne l’Europe vers un nouvel élargissement.
La politique turque de bon voisinage a fait long feu parce qu’Erdogan s’estime désormais trop puissant pour se préoccuper du bien être de ses voisins. Fâchée avec Israël et l’Iran, l’Égypte et la Grèce, Chypre et l’Arménie, l’ivresse turque effraie toute la région. Mais la Turquie est sûre d’elle même. Et l’Europe se tait, elle consent. Puisqu’elle est incapable de contrôler ses bordures, elle sous-traite sa politique migratoire à la Turquie. Et elle se place dans une situation de dépendance stratégique inédite.
Une bonne partie de la facture sera sans doute réglé par Berlin. Erdogan sait bien que la capitale de l’Europe est prussienne. Mais il ne suffit pas de l’acheter, un chèque de trois milliards d’euros ne saurait suffire. A l’occasion de la visite de la chancelière, il a fait de la poursuite du processus d’adhésion la condition d’un accord. Et puis Bruxelles, adoubée par les 27 complices de l’Allemagne, s’est inclinée.
Donald Tusk, le président du Conseil européen a annoncé un accord sur le contrôle migratoire en compagnie d’Ahmet Davutoglu. Mais c’est Angela Merkel, la chancelière de l’Europe qui a négocié la transaction. Acculée par une majorité CDU-CSU en ébullition, elle a rencontré Erdogan dès le 19 octobre à Istanbul pour régler les modalités pratiques de l’accord européen. Menacée au Bundestag, elle n’a plus d’autre choix que colmater les brèches qu’elle avait elle même ouverte cet été. Son appel généreux à accueillir toute la misère d’Europe centrale, les réfugiés des guerre de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, se termine en fin de non-recevoir. Les attentats de Paris ont fini, mais un peu tard, de la convaincre. La Turquie, elle, peut se frotter les mains.
Du "fil d'actu" d'Alliance Vita :
Techniques de modification du génome humain : une préoccupation majeure
La technique du Crispr-Cas9 permettant la modification du génome humain est au cœur des préoccupations d’une conférence internationale qui se déroule du 1er au 3 décembre à Washington, à l’initiative de l’Académie américaine des sciences et de médecine, et à laquelle participent la Royal Society britannique et l’Académie des sciences chinoises.
Dans une tribune publiée dans la revue Nature, la biologiste Jennifer Doudna, co-créatrice avec la Française Emmanuelle Charpentier de cette technique, annonce attendre de cette conférence la sécurité, la communication, la coopération internationale, la réglementation, la prudence, pour espérer dérouler les orientations claires de ce qui est éthiquement acceptable ou non.
Cette technique est un outil de génie génétique simple, peu coûteux, souple qui permet de corriger l’ADN défectueux de tous types de cellules, végétales, animales ou humaines. “C’est un peu comme un couteau suisse qui coupe l’ADN à un endroit précis et qui peut être utilisé pour introduire toute une série de changements dans le génome d’une cellule ou d’un organisme”, explique Emmanuelle Charpentier. Une de ses applications potentielles les plus importantes sera de permettre de nouvelles approches thérapeutiques pour certaines maladies génétiques humaines.
Mais les inquiétudes suscitées sont vives, surtout depuis l’annonce en avril 2015 d’une équipe chinoise qui avait modifié un gène défectueux dans plusieurs embryons humains. En effet, la technique CRISPR-Cas9 rend possible la modification de l’ADN humain dans les embryons, les ovules ou les spermatozoïdes, et cela de manière transmissible de génération en génération ; en somme, le « bébé à la carte », et « l’amélioration du génome humain ».
En octobre 2015, le Comité international de bioéthique de l’Unesco a appelé à un moratoire sur les techniques d’édition de l’ADN des cellules reproductrices humaines afin d’éviter une modification contraire à l’éthique des caractères héréditaires des individus, qui pourrait faire resurgir l’eugénisme.
Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA : « l’éthique n’exige pas d’interdire purement et simplement l’utilisation d’une technique prometteuse, mais nous demandons aux politiques et aux scientifiques d’édicter des lignes directrices sûres et efficaces, pour déterminer les limites à ne pas franchir. Ces techniques d’édition de l’ADN appliquées aux cellules reproductrices humaines ou à l’embryon humain donnent légitimement le vertige : nous risquons l’avènement du bébé à la carte. A l’heure où le climat et notre planète occupent tous nos dirigeants, il faut rappeler que le génome humain fait partie du «patrimoine de l’humanité » le plus précieux. Son intégrité doit absolument être préservée pour les générations futures. C’est donc un défi majeur pour les gouvernants qui, malheureusement, n’en ont pas encore pris conscience.»
Lu sur le site « pro liturgia » :
 Dans une église, l’autel est le centre de gravité. L’architecture chrétienne a constamment essayé de mettre cette réalité en relief. Or on ne peut pas séparer l’autel de sa finalité propre : la célébration liturgique du sacrifice de la croix, comme le précisent les textes de la liturgie eucharistique. Autel et sacrifice sont donc étroitement liés.
Dans une église, l’autel est le centre de gravité. L’architecture chrétienne a constamment essayé de mettre cette réalité en relief. Or on ne peut pas séparer l’autel de sa finalité propre : la célébration liturgique du sacrifice de la croix, comme le précisent les textes de la liturgie eucharistique. Autel et sacrifice sont donc étroitement liés.
Or, depuis le Concile, un changement s’est opéré : ce n’est plus tant l’autel que le célébrant qui est le centre de gravité. Et - c’est un fait incontestable - ce glissement de sens a été engendré par la généralisation de messes célébrées face au peuple.
On est ainsi passé de la notion de “sacrifice” à la notion de “communauté rassemblée pour le repas eucharistique”.
La célébration face au peuple, aujourd’hui très largement généralisée, est une idée typiquement cléricale qui ne repose ni sur la tradition liturgique de l’Eglise ni sur des bases théologiques. Selon le P. Louis Bouyer, (photo) le face à face prêtre-fidèles est donc un complet contresens.
Le P. Joseph Gélineau, que personne ne saurait taxer d’intégrisme, écrit dans un numéro de “La Maison-Dieu” de 1960 : “Il est nécessaire d’observer que le problème de l’autel versus populum tel qu’il se pose aujourd’hui est relativement nouveau dans l’histoire de la liturgie. Durant une période assez longue et pour une bonne part de la chrétienté, la question dominante, au dire de plusieurs historiens, ne fut pas celle de la position réciproque du célébrant et des fidèles, mais celle de l’orientation au sens strict ; c’est-à-dire de se trouver face à l’Orient pour la prière. L’Orient symbolisait alors la direction de l’ascension et du retour du Christ.”
D’où est venue l’idée d’un face à face entre le célébrant et l’assemblée ? La réponse est simple : elle nous est venue de Martin Luther qui notait dans son livre “Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes” de 1526 : “Nous conserverons les ornements sacerdotaux, l’autel, les lumières jusqu’à épuisement, ou jusqu’à ce que cela nous plaise de les changer. Cependant nous laisserons faire ceux qui voudront s’y prendre autrement. Mais dans la vraie messe et entre vrais chrétiens (sic), il faudrait que l’autel ne restât pas ainsi et que le prêtre se tournât toujours vers le peuple, comme sans aucun doute Christ l’a fait lors de la Cène. Mais cela peut attendre.” On sait que tous les luthériens n’adopteront pas ce face à face. Aujourd’hui encore, dans beaucoup de communautés issues de la Réforme, les services religieux sont célébrés versus orientem.
Toutefois, l’idée de Martin Luther avait pour fondements le rejet de la messe comme sacrifice afin de ne plus y voir que la Cène comme repas fraternel soudant la communauté locale. C’est la communauté qui devait valider la célébration de la Cène, le pasteur n’étant en quelque sorte que le porte-parole ou le délégué de cette communauté.
Chez de nombreux prêtres catholiques de l’après-concile, le retournement des autels a donc été la conséquence d’une volonté d’insister sur le sacerdoce commun des fidèles devant déboucher sur une participation “active”, c’est-à-dire “activiste” qui contredit la participation “effective” - la ”participation actuosa” - souhaitée par Vatican II. Cette participation “active” devant instiller dans l’esprit des fidèles l’idée que c’est à la communauté paroissiale, avec “sa” sensibilité, d’organiser la liturgie en ne respectant plus que un schéma de base établi autour de quatre pôles : “pénitence - Parole - Eucharistie - repas convivial”.
Ainsi, avec la généralisation de la célébration face au peuple dans les paroisses, c’est non seulement l’aspect sacrificiel de l’Eucharistie qui a été gommé, mais aussi la valeur de la Communion eucharistique et la différence entre le sacerdoce ministériel du prêtre et ce sacerdoce commun à tous baptisé.
Université de la vie 2016 : « Une société à Panser ! »
Du lundi 11 janvier au 1e février aura lieu la 11e édition de l’Université de la vie, le cycle de formation en bioéthique d’Alliance VITA, sur le thème : « Panser la société – Comment agir en faveur d’une culture de vie ? ». Cette formation se déroulera en visioconférence dans 113 villes, en France et dans une demi-douzaine d’autres pays.
Déjà suivie par plus de 20 000 personnes les années précédentes, l’Université de la vie 2016 s’adresse autant à ceux qui y ont déjà participé qu’aux « nouveaux arrivants ». Cette année, la formation sera centrée sur l’action. Décidé avant les évènements dramatiques du mois de novembre 2015, le thème « Panser la société » répond à de profondes attentes. Constatant à quel point notre société manque de repères vitaux, de nombreuses personnes ne veulent pas subir passivement ses errances, mais désirent agir concrètement, et se relier pour changer la donne.
Chacune des quatre soirées permettra de réfléchir aux souffrances et aux contradictions de notre société et aux solutions pour y remédier. Chacun est invité à prendre position personnellement face aux défis humanitaires, politiques et culturels à relever.
Une approche spécifique
Le thème 2016 sera abordé avec l’approche spécifique d’Alliance VITA nourrie d’une part, de l’expérience de ses services d’écoute des personnes confrontées aux épreuves de début ou de fin de vie, et d’autre part, de son travail de sensibilisation du public et des décideurs. François-Xavier Pérès, Tugdual Derville, Caroline Roux, Henri de Soos, Valérie Boulanger et le docteur Xavier Mirabel partageront leurs analyses et expliciteront les convictions et les façons d’agir de l’association, avec une animation globale assurée par Blanche Streb.
Leurs interventions seront complétées par l'apport de cinq experts : les philosophes François-Xavier Bellamy, Thibaud Collin et Martin Steffens, la spécialiste en accompagnement Anne Davigo-Le Brun et le docteur en droit Grégor Puppinck. Il s’agira d’éclairer plusieurs concepts indispensables à l’action, comme par exemple : épreuve, deuil, démocratie, loi naturelle, droits de l’homme, culture…
Innovations sociales
Innovation supplémentaire de cette année, Alliance VITA a également demandé à quatre fondateurs d’œuvres destinées aux personnes fragiles ou fragilisées de témoigner de leur parcours et de leur regard sur la société : Laurent de Cherisey (Simon de Cyrène), Etienne Villemain (Les Maisons Lazare), Christian de Cacqueray (Service catholique des funérailles) et Jean-Marc Potdevin (Réseau Entourage). La façon dont leurs innovations sociales sont nées et ont été conduites contient pour tous une valeur d’exemple et d’émulation. Par ailleurs, de nombreux autres experts et témoins interviendront dans les villes où se tiendra l’Université de la vie, chaque soirée se terminant par un temps de « décrochage en région » qui permet d’animer une phase locale dans chaque ville qui le souhaite.
Pour la troisième fois, l’Université de la vie sera diffusée dans toute la France en simultané dans 113 salles, par un système de visioconférence depuis une salle parisienne. Comme en 2015, l’Université de la vie sera également proposée à l’international. Les villes de Berlin, Bruxelles, Liège, Lausanne, Zurich, Rome, New-York, Casablanca, notamment, assureront une retransmission. Un effort particulier sera de plus effectué pour faciliter l’interactivité au sein des salles et entre elles.
En savoir plus :
Dates des soirées : les lundis 11, 18 et 25 janvier et 1er février, de 20h15 à 22h30.
Informations et inscriptions sur : http://www.universitedelavie.fr
Cliquer ici pour visionner le mini clip d’annonce
Le défi de l'intégration des communautés musulmanes (source)
Samir Khalil Samir est un jésuite égyptien, spécialiste de l’Orient chrétien et musulman. Dans son livre Les raisons de ne pas craindre l’Islam (voir recension ici), il aborde la difficile question de l’intégration des communautés étrangères, en particulier musulmane, en Europe. Nous avons sélectionné ici quelques passages de ce livre.
— Presque tous les pays qui ont connu l’intégration du tiers-monde ces dernières années s’interrogent sur les chemins à suivre pour réaliser au mieux l’intégration des étrangers. Quel est votre avis sur les modèles qui ont été adoptés en Europe jusqu’à présent ?
Il existe trois modèles pris comme référence jusqu’à maintenant.
1) L’assimilation
Selon ce schéma, l’étranger doit complètement s’intégrer, non seulement aux lois et à la langue du pays d’accueil mais aussi à sa culture et à ses mœurs en renonçant à ses propres particularités. C’est en gros la recette française, proposée au nom de la laïcité qui fait que tous sont théoriquement égaux devant l’Etat, une recette qui a montré ses limites car elle présuppose et exige une identification intégrale des citoyens avec l’Etat et la suppression de toute différence, ce qui dans les faits est impossible à réaliser et à contrôler.
2) Le melting-pot
C’est le modèle américain du creuset où les immigrés doivent se fondre dans la population locale, en gardant quelques prérogatives au niveau de la culture et des mœurs. Ce modèle a eu le mérite de renforcer le sens de l’appartenance des minorités à la plus grande nation du monde, en leur conférant une fierté légitime, symbolisée par le drapeau, par l’hymne et par la participation à quelques grands événements collectifs.
Pourtant le melting-pot montre ses limites justement sous l’effet des nouveaux flux migratoires et des différents taux de croissance démographique dans les diverses communautés ethniques, facteurs qui provoquent la crise de l’ensemble des valeurs partagées qui formaient le noyau dur de la société américaine, le Wasp (white anglo-saxon protestant). Ceux qui représentaient des minorités sont déjà ou s’apprêtent à devenir des majorités, ils réclament des droits et le pouvoir, ils brisent les équilibres qui s’étaient renforcés, ils veulent de nouvelles règles.
3) La société multiculturelle
Le troisième modèle, qui est attentivement observé en Europe, est celui du multiculturalisme. Il se fonde sur le principe que toutes les cultures sont dignes et peuvent aisément cohabiter et que la pluralité des expressions est en soi une garantie de richesse et d’amélioration de la cohabitation sociale.
Lu sur Aleteia.org (Jules Germain)
Le cri d’alerte d’une musulmane convertie au catholicisme
Alors que l'Église catholique allemande continue de soutenir activement la politique d’accueil des réfugiés, des voix catholiques commencent à se lever face à certains risques de dérives.
Cette ancienne musulmane a émis récemment d’importantes critiques envers la gestion allemande de la crise des migrants. Comme nous le rapporte nos confrères du site kath.net, elle a évoqué les réelles menaces d’une immigration musulmane incontrôlée venue de pays non démocratiques. Elle exprime ses inquiétudes de manière frontale, quitte à choquer la modération habituelle des catholiques d’outre-Rhin. Elle a dit notamment dans une interview au Neuen Osnabrücker Zeitung : « Nous devons nous poser deux questions : voulons-nous continuer à préserver les droits de l’homme en Allemagne ? Peut-on laisser l’Allemagne devenir un pays majoritairement musulman ? ».
Donner un passeport à tous les réfugiés sans s’assurer qu’ils soient « capables d’être démocrates ou de savoir s’ils sont prêts ou non à utiliser la violence » est une politique irresponsable « vis-à-vis des droits de l’homme » d’après elle. S’il s’avère que l’on rencontre parmi eux de violents islamistes, qu’ils soient ou non liés à Daesh, l’Allemagne ne pourra pas refuser d’en endosser la responsabilité.
L’équivalent d’une nouvelle ville chaque mois
Elle poursuit en disant que si jamais, dans les dix années à venir, plus de 10 millions de musulmans venaient, ils pourraient constituer la majorité de leur classe d’âge. C’est justement le rythme actuel des arrivées ; or, la natalité allemande est dramatiquement faible. Ce pourrait tout à fait être le cas si l’on se refuse à réguler l’immigration. Il faut savoir que pour le seul mois de novembre, le nombre de 180 000 réfugiés a été dépassé en seulement trois semaines (chiffre du 23 novembre). C’est donc une ville de taille moyenne de plus chaque mois qui peut transformer radicalement la société allemande. Ce n’est pas un fantasme mais simplement la réalité. De nombreuses critiques, venues même de la gauche, commencent d’ailleurs à émerger en Allemagne.
Elle s’étonne également du fait que les jeunes hommes violents qui attaquent les chrétiens, les yézidis ou les musulmans démocrates, puissent tout de même rester en Allemagne. « Ils doivent repartir. » Il serait impensable de leur donner le droit d’asile. C’est une grave erreur et une illusion de notre trop belle âme, selon elle, de supposer d’avance que tous les réfugiés partagent les valeurs démocratiques. Ils sont nés dans un pays, que ce soit la Syrie, l’Afghanistan ou le Pakistan qu’elle connait bien, « avec l’idée que les femmes n’ont pas les mêmes droits ni la même dignité que les hommes et que les non-musulmans ne sont pas des êtres humains à part entière ».
Se protéger des prédicateurs radicaux
Sabatina James critique par ailleurs le fait que l’Allemagne ne mette aucune limite aux prédicateurs les plus radicaux. « Nous les laissons faire et l’on s’étonne ensuite que la jeunesse suive. » Connaissant des repentis de la mouvance salafiste, elle sait que ce sont des personnes en recherche de Dieu. C’est d’ailleurs une preuve de la triste situation des Églises en Allemagne selon cette convertie : il est devenu plus fréquent aujourd’hui dans les rues allemandes de croiser un salafiste qui distribue le Coran qu’un chrétien pouvant « expliquer le Sermon sur la montagne » et de paroles si fortes telles que celles du Christ : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ».
Et c’est bien pour préserver les droits de l’homme, et tout particulièrement ceux des femmes, ainsi que les valeurs de ce même sermon sur la montagne que l’Allemagne ne peut tout accepter : c’est la garantie du caractère démocratique de ce pays qui risque fort de se réduire à peau de chagrin si l’Allemagne ne change rien à son action.
Extraits de la revue de presse de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles :
« Les représentants des cultes et ceux de la laïcité en Belgique, Noureddine Smaili, le président de l’Exécutif des musulmans, Mgr Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, Philippe Markiewicz, président du Consistoire et Henri Bartholomeeusen, président du Centre d’action laïque, ont répondu immédiatement présents à l’invitation du « Soir » de les faire dialoguer. Leur premier message, hier matin, ne faisait d’ailleurs aucun doute : « Tous ensemble face à ce sectarisme », chacun d’eux insistant à plusieurs reprises sur le fait que ce qui se joue n’est absolument pas une guerre de religions ou de civilisations. « Ce n’est pas l’islam qui en cause ici », affirment avec force Mgr Léonard, Philipe Markiewicz et Henri Bartholomeeusen. Ils se veulent aussi résolument aux côtés des musulmans pour traverser ces terribles événements. Aux côtés, mais pas sans demandes au président de l’Exécutif…
« C’est Mgr Léonard qui, très rapidement, « ouvre les hostilités », avec bienveillance, certes, mais avec fermeté : « Je me fais beaucoup de souci pour la communauté musulmane, ainsi que pour le sort des réfugiés, commence-t-il. Car les amalgames redoutés vont apparaître. » «Mais je crois qu’un message doit venir de vous, poursuit-il en s’adressant au président de l’Exécutif des musulmans de Belgique. D’abord, un message pour enlever cette idée d’un islam violent, qui doit passer par un recul critique par rapport aux textes. Il faut dénoncer les interprétations qui sont faites de certains versets du Coran, comme des appels à la violence. Ensuite, je crois que vous auriez grand intérêt à lancer le message de la liberté de conscience : dire que chacun est libre partout dans le monde d’avoir ou de ne pas avoir une religion ! Libre de changer de religion, alors que pour un musulman, il est difficile, voire dangereux, de se dire athée ou de devenir chrétien. Enfin, affirmer également la liberté de tout homme et de toute femme de se marier avec un partenaire d’une autre religion.» cliquez ici : Page complète
fermeté : « Je me fais beaucoup de souci pour la communauté musulmane, ainsi que pour le sort des réfugiés, commence-t-il. Car les amalgames redoutés vont apparaître. » «Mais je crois qu’un message doit venir de vous, poursuit-il en s’adressant au président de l’Exécutif des musulmans de Belgique. D’abord, un message pour enlever cette idée d’un islam violent, qui doit passer par un recul critique par rapport aux textes. Il faut dénoncer les interprétations qui sont faites de certains versets du Coran, comme des appels à la violence. Ensuite, je crois que vous auriez grand intérêt à lancer le message de la liberté de conscience : dire que chacun est libre partout dans le monde d’avoir ou de ne pas avoir une religion ! Libre de changer de religion, alors que pour un musulman, il est difficile, voire dangereux, de se dire athée ou de devenir chrétien. Enfin, affirmer également la liberté de tout homme et de toute femme de se marier avec un partenaire d’une autre religion.» cliquez ici : Page complète
« […] Mgr Léonard livre également son analyse de la perte des valeurs auprès des jeunes : « Nous pâtissons du fait que tout en étant ouvert à la pensée d’autrui, nous manquons souvent d’identité. Or, les jeunes ont besoin de pouvoir s’identifier. Dans une atmosphère où tout est vague, sans conviction, ils cherchent des points de repères. Par exemple, les mouvements de jeunesse ont joué un rôle, mais peut-être avec un trop peu d’identité à présent. Nous manquons aujourd’hui d’engagement, de force, même s’il faut trouver le bon dosage entre identité et ouverture, pour éviter de dévier vers l’identitaire, et le repli. » Le Primat de Belgique, très bientôt à la retraite, affirme cependant qu’il existe quelques paroisses, minoritaires, certes, où les jeunes sont très nombreux. De celles qui proposent une « identité claire » cliquez ici : Page complète … »
JPSC