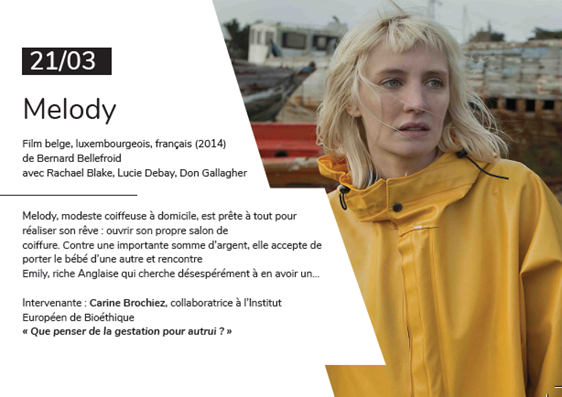Lu sur le blog du « Salon beige (extrait):
 "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
« Le lieutenant-colonel du groupement local de gendarmerie de l'Aude, âgé de 45 ans, a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait négocié avec le terroriste pour prendre la place des otages dans le Super U de Trèbes.
Alors que le terroriste venait d'abattre deux personnes, il a pris la place des otages au terme de négociations avec l'auteur des faits. L'assaillant a ensuite ouvert le feu à plusieurs reprises sur le gendarme, le blessant grièvement. Le gendarme avait laissé son téléphone ouvert sur la table et c'est lorsqu'ils ont entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu et a abattu le terroriste, qui se réclamait du groupe djihadiste État islamique.
Son sacrifice rappelle celui de saint Maximilien Kolbe, qui, à Auschwitz, s'est offert de mourir à la place d'un père de famille.
Son père a été enterré récemment par un aumônier militaire avec lequel il préparait depuis son mariage religieux. Il venait de se convertir. Il a reçu hier soir des mains d'un chanoine de Lagrasse les derniers sacrements de l'Eglise. Requiescat in pace.
La mère d'Arnaud Beltrame se confie :
"Il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, fait tout pour la patrie." "C'est sa raison de vivre, défendre la patrie". "Il me dirait : 'Je fais mon travail maman, c'est tout.'". "Cela fait partie de sa façon d'être."
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Richard Lizuret a souhaité «rendre solennellement hommage à l'héroïsme de notre camarade» et «s'incliner devant le courage, le sens du sacrifice et l'exemplarité de cet offficier qui a donné sa vie pour la liberté des otages». Les drapeaux et étendards de la gerndarmerie sont mis en berne ce samedi.
Né à Etampes, dans l'Essonne, Arnaud Beltrame n'avait pas d'enfant. Après Saint-Cyr et l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, il a été nommé dans un peloton de véhicules blindés à Satory (de 2002 à 2006), puis a rejoint le premier régiment d'infanterie (RI) de la Garde républicaine (chargé de la protection du président de la République), jusqu'en 2010. De 2010 à 2014, il a été chef de la compagnie d'Avranches dans la Manche, puis officier d'état major auprès du ministère de l'Écologie et du Développement durable à Paris de 2014 à 2017. Il a accédé au rang de lieutenant-colonel en 2016. Le 1er août 2017, il est devenu officier adjoint de commandement (OAC) au groupement de gendarmerie de l'Aude. Arnaud Beltrame est décoré de l'ordre national du Mérite.
Par son sacrifice, il nous rappelle que nous devons retrouver la cohésion d'une nation. C'est grâce à ce genre d'acte héroïque que nous retrouverons ce qui nous permettra de vaincre ce nouveau totalitarisme […] »
Ref.Le héros de Trèbes, le Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, est mort
Et sur le site du journal " Le Monde ":
« [...] Vendredi 23 mars, la nuit était tombée depuis deux heures déjà lorsque le père Jean-Baptiste est arrivé au pas de course dans le hall moderne de l’hôpital de Carcassonne, comme s’il avait peur qu’il ne soit déjà trop tard. Le religieux, pas loin du double mètre, a demandé à voir Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel de 44 ans dont le « courage » et l’« héroïsme » ont été unanimement salués par la classe politique et sur les réseaux sociaux pour s’être substitué à l’une des otages du supermarché de Trèbes. Touché par plusieurs tirs du terroriste Radouane Lakdim, le militaire est mort, quelques heures plus tard, samedi matin.
Voilà des semaines que le prêtre préparait l’union religieuse d’Arnaud et de Marielle, déjà mariés civilement. Le couple et l’homme d’Eglise avaient consacré « une trentaine d’heures » à la préparation de la cérémonie, prévue pour début juin. « Je prie pour que ce mariage ait lieu, confiait le père Jean-Baptiste après une heure passée au service de réanimation auprès du militaire et de sa compagne. Je lui ai donné le sacrement du mariage, et le sacrement des malades. »
« Mort pour la patrie »
Le gendarme et le prêtre s’étaient rencontrés à l’été 2016, lors d’une visite guidée du couple dans une abbaye. A l’époque, Arnaud Beltrame travaille à Paris, au ministère de l’écologie, après avoir commandé la compagnie de gendarmerie d’Avranches de 2010 à 2014. Mais il vient régulièrement dans le Sud, où il retrouve Marielle, vétérinaire à la réserve africaine de Sigean, tout près de Narbonne. « On a sympathisé, c’est un homme extrêmement intelligent et courageux, et le contact a tout de suite été excellent, résume le père Jean-Baptiste. C’est un homme qui avait retrouvé la foi... »
Ref. Le gendarme Arnaud Beltrame, « un mec bien, humain avec ses troupes »
JPSC

 Mort en donnant sa vie pour celle d’une femme, Arnaud Beltrame, Maximilien Kolbe des temps modernes, est devenu l’honneur de la France. De Charlotte d’Ornellas sur le site web de « Valeurs actuelles » :
Mort en donnant sa vie pour celle d’une femme, Arnaud Beltrame, Maximilien Kolbe des temps modernes, est devenu l’honneur de la France. De Charlotte d’Ornellas sur le site web de « Valeurs actuelles » : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime". Dans le bi-mensuel
Dans le bi-mensuel