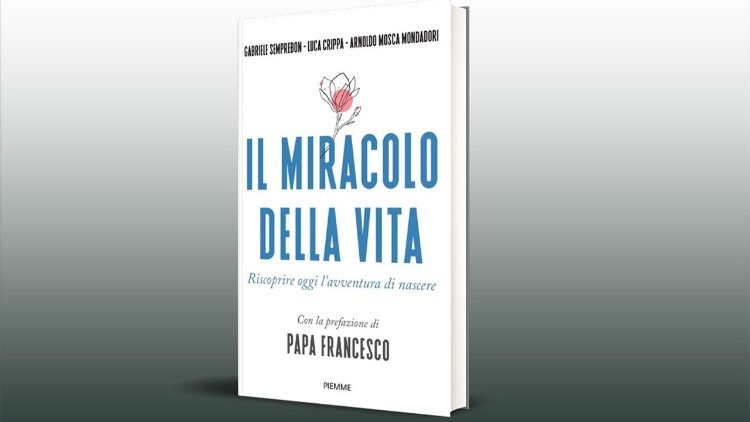Du "Collectif Hippocrate" (collectif de soignants) sur Mediapart :
25 mai 2023
Euthanasie – La CFCEE belge : une surveillance en trompe-l’œil
De nombreux partisans de la mort administrée affirment que l'euthanasie serait "une liberté très strictement encadrée en Europe". L'exemple de la CFCEE est très souvent cité. Ce serait la preuve que les dérives en Belgique seraient fantasmées. Cet article a pour objectif de remettre les points sur les i.
A l’heure de nouveaux débats concernant la fin de vie, de nombreux journalistes, politiques ou simples citoyens ont décidé de se tourner vers nos voisins belges et suisses. Il est vrai que ces pays ayant légalisé soit l’euthanasie, soit le suicide assisté, sont à même de nous fournir des données empiriques sur les conséquences d’une évolution de notre législation.
Pour défendre la légalisation de la mort administrée, l’argument de la mise en place de garde-fous est souvent avancé. Ceux-ci seraient en mesure de concilier respect de la volonté des patients et prévention des dérives. A ce titre, il est souvent fait référence à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) belge. Les partisans de la mort administrée la présentent souvent comme une instance de contrôle efficace. La preuve ? Seul un cas d’euthanasie aurait été envoyé devant la justice, ce qui signifierait que la commission effectue son travail, et que le cadre légal est respecté. Mais voilà… tout n’est pas aussi idyllique, et cette institution présente un niveau de dysfonctionnement élevé. Nous allons les relever dans cet article. Pour cela, nous nous fonderons sur des études et des enquêtes menées entre 2007 et 2020. A l’heure où de nombreux politiques disent vouloir faire évoluer la législation sur le modèle belge, il semble nécessaire d’en montrer les dangers.
Rappelons d’abord le droit belge en la matière : le site de la CFCEE rappelle qu’un médecin ayant pratiqué une euthanasie doit compléter un document d’enregistrement et le transmettre à la commission dans les 4 jours ouvrables suivant l’acte. Ainsi, le contrôle pratiqué par la CFCEE se fait a posteriori uniquement. Nous pourrions y voir là un premier élément problématique : si erreur il y a, il est de toute façon trop tard pour le patient euthanasié.
Une commission juge et partie
Le 4 octobre 2022, la CEDH a décidé de condamner la CFCEE pour son manque d’indépendance. Et pour cause : le médecin accusé par un individu d’avoir euthanasié sa mère à son insu était lui-même le président de la CFCEE. Ayant été amené à juger sa propre pratique euthanasique, il était fort improbable qu’il la considère comme illégale et s’accuse lui-même devant la justice. Par ailleurs, la patiente euthanasiée avait, peu avant son décès, fait un don à l’association pro-mort administrée LEIF, dont le président n’était autre que… ce même médecin.
La loi belge oblige le médecin traitant à consulter un à deux autres confrères pour confirmer le caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique du patient. Ces confrères doivent évidemment être indépendants, tant vis-à-vis du patient que du médecin traitant. Or, dans le cas présenté ci-dessus, les deux médecins consultés collaboraient étroitement avec l’association LEIF, présidée par le médecin en charge de l’euthanasie de la patiente. Indépendance disions-nous. De manière plus générale, la présence dans la commission de médecins appartenant à des associations ouvertement pro-euthanasie pose question. Le peu de dossiers remis à la justice ne prouve pas un respect profond de la loi, comme sont tentés de le faire croire certains militants, mais montre au contraire le fonctionnement opaque et, disons-le, corporatiste, de cette commission. Celle-ci agit en effet plus comme un bouclier protégeant les confrères que comme une véritable instance de contrôle. C’est d’ailleurs ce que sous-entend Wim Distelmans, ancien président de la CFCEE : « les informations fournies par les médecins sont toujours réputées exactes par la commission. » [1]
Globalement, les procédures instaurées ne peuvent être qu’opaques. Le caractère anonyme des formulaires à remplir rend impossible la vérification de l’indépendance de la commission, et leur caractère concis permet aux médecins de n’avoir à se justifier de rien.
En 2018, tous ces éléments ont poussé un membre de la CFCEE à démissionner. Pour cause : ses pairs avaient refusé de transmettre à la justice le cas d’un médecin ayant euthanasié un patient sans son consentement.
Une défaillance de contrôle
Autre point tout aussi grave, sinon plus : les euthanasies déclarées ne représenteraient qu’une partie des euthanasies pratiquées. Wim Distelmans, toujours le même, a ainsi confirmé que « certains médecins [pratiquaient], parfois ouvertement, des euthanasies sans les déclarer à la commission de contrôle. » [2] Et d’ajouter : « les cas douteux, évidemment les médecins ne les déclarent pas, alors on ne les contrôle pas. »
On ne parle pas ici de quelques brebis galeuses qui, malgré la légalisation de l’euthanasie, s’amuseraient à la pratiquer clandestinement. Nous parlons ici d’un pourcentage considérable de pratiques euthanasiques qui échapperaient à tout contrôle. En 2010, une enquête publiée dans le journal Palliative Medicine [3] portant sur le report des cas d’euthanasie en Flandres affirmait que seuls 52,8% des cas d’euthanasie étaient reportés. S’il faut prendre cette donnée avec des pincettes du fait de la difficulté évidente à recueillir des informations non déclarées, ce chiffre ne peut que nous alerter. En 2014, on peut lire dans une nouvelle étude parue dans le Canadian Medical Association Journal (CMAJ) [4] que les « actes mettant fin à la vie sans demande explicite du patient », bien qu’existant dans des pays non-permissifs, sont plus nombreux en Belgique qu’ailleurs. Au même moment, dans un article intitulé « Euthanasie : faut-il s’inspirer du modèle belge ? » [5], Radio France affirme qu’« 1,8% des décès en Belgique restent consécutifs à des injections létales non-déclarées. »
On peut lire dans une étude de 2015 publiée dans le New England Journal of Medicine [6] que 25 à 35% des euthanasies en Belgique ne seraient pas déclarées. Ces chiffres ont par ailleurs été corroborés par une autre étude datée de 2018 et parue dans le Journal of Pain and Symptom Management [7]. La même année, un rapport intitulé « How accurately is euthanasia reported on death certificates in a country with legal euthanasia” et publié dans le European Journal of Epidemiology [8] confirme qu’il existe une absence substantielle de report des cas d’euthanasie en Belgique, et que les certificats de décès ne suffisent pas pour évaluer la pratique euthanasique, y compris dans les juridictions où cela est légal.
Plus de 20 ans après la légalisation de la mort administrée, le problème n’est toujours pas réglé. Ainsi, comme le rapporte l’Institut Thomas More dans un article daté du 14 février 2023 : « la commission admet que les moyens financiers et humains dont elle bénéficie l’empêchent d’effectuer un contrôle sérieux. » [9]
Collectif Hippocrate
[1] Propos du Dr Wim Distelmans rapporté au journal néerlandais Standaard
[2] Ibid
[3] Smets, T., Bilsen, J., Cohen, J., Mette L Rurup, D., Mortier, F., & Deliens, L. (2010). “Medical Decisions at the End of Life in Flanders, Belgium - A Nationwide Post-mortem Survey of Euthanasia Cases Reported and Unreported to the Federal Review Committee.” Palliative Medicine
[4] Chambaere K, Bernheim JL, Downar J, Deliens L. “Characteristics of Belgian "life-ending acts without explicit patient request": a large-scale death certificate survey revisited.” CMAJ Open. 2014 Oct
[5] Says F. « Euthanasie : faut-il s’inspirer du modèle belge ? », Radio France, novembre 2014
[6] Chambaere K., Stichele R. V., Mortier F., Cohen J., Deliens L., « Récents Trends in Euthanasia and Other End-of-Life Practices in Belgium”, The New England Journal of Medicine, 2015
[7] Sigrid Dierickx,Joachim Cohen,Robert Vander Stichele,Luc Deliens,Kenneth Chambaere “Drugs Used for Euthanasia : A Repeated Population Based Mortality Follow-back Study in Flanders, Belgium, 1993-2013” Journal of Pain and Symptoms Management, 2018
[8] Cohen, J., Dierickx, S., Penders, Y. W. H., Deliens, L., & Chambaere, K. (2018). How accurately is euthanasia reported on death certificates in a country with legal euthanasia: a population-based study. European Journal of Epidemiology
[9] De Lamotte A. « La pratique de l’euthanasie en Belgique est sur la voie de dérives inquiétantes », Institut Thomas More, 14 février 2023


:focal(544.5x403.5:554.5x393.5)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/ipmgroup/EKWVGGREOREFJIRBY6TJ46PHMU.jpg)