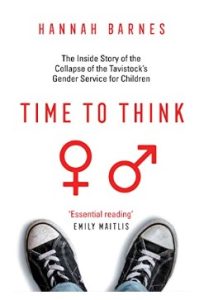On n’en a presque pas parlé mais la déclaration conjointe de l’Église catholique et du Grand rabbinat d’Israël émise en mai à Jérusalem sur « ce qui est interdit, autorisé, obligatoire » avec les malades en fin de vie a confirmé que les deux traditions religieuses continuent à être solidaires dans leur souci de demeurer fermes contre l’euthanasie.
À l’époque actuelle, il en faut du courage pour soutenir que « tout ce qui est techniquement réalisable n’est pas forcément éthique ». La pression de la culture dominante pour abattre toute résistance est très forte. Et pourtant, aucune des deux parties n’a fait mine de vouloir infléchir le moins du monde ses précédentes prises de position, y compris celle qui avait été définie comme « historique » en 2019 « des trois religions abrahamiques », islam y compris, contre « l’euthanasie active et le suicide médicalement assisté ».
Les délégations qui ont signé en mai dernier la déclaration conjointe étaient présidées, côté catholique, par le cardinal Kurt Koch et, côté juif, par le grand rabbin Rasson Arussi.
Le principe fondamental qui impose le refus de l’euthanasie est pour les deux parties la référence à Dieu « créateur et seigneur de toute vie », créée « selon l’image divine » et donc non susceptible d’être soumise, en ce qui concerne sa valeur et sa durée, à la domination de quelque personne ou groupe humain que ce soit.
En revanche, découle de ce même principe fondamental « l’importance des soins palliatifs et de déployer tous les efforts possibles pour soulager la douleur et les souffrances ».
La déclaration donne également l’information qu’à Jérusalem, « les délégations ont été reçues par le directeur général de l’hôpital Shaare Zedeq, où ils ont pu constater les modalités de traitement des malades en fin de vie, en conformité avec les principes énoncés ci-dessus ».
Mais il reste à voir à quel point tout cela est effectivement partagé, aussi bien dans le monde juif que dans l’Église catholique.
*
En effet, au sein de l’Église, la prise de position en faveur d’une loi pro-euthanasie débattue au parlement italien, exprimée en janvier 2022 par le théologien moraliste jésuite Carlo Casalone dans « La Civiltà Cattolica », la revue des jésuites de Rome publiée moyennant le contrôle ligne par ligne du Pape et de la secrétairerie d’État, a laissé des traces.
Dans cet article, Casalone reconnaissait que oui, la loi en débat s’écartait du magistère de l’Église catholique sur « l’illicéité du suicide assisté », mais poursuivait en soutenant – et citant le Pape François pour étayer ses dires – que « l’évaluation d’une loi de l’État exige de considérer un ensemble complexe d’éléments en faveur du bien commun » et concluait que, pour prévenir des lois encore pires, il valait mieux approuver la loi en discussion qui, à ses yeux, « ne s’opposait pas à une recherche responsable du bien commun possible ».
Il va sans dire que quelques semaines plus tard, le 9 février 2022, dans une audience générale du mercredi dédiée à saint Joseph, « patron de la bonne mort », le Pape François s’est exprimé publiquement avec des paroles très nettes contre le suicide assisté et les autres formes d’euthanasie, réfutant les thèses de « La Civiltà Cattolica », tout en évitant de la citer.
Et il faut ajouter que même la revue « Il Regno », qui est le porte-parole autorisé de l’aile progressiste de l’Église italienne, s’est opposée sans concession, par la plume du juriste Luciano Eusebi, à la loi débattue au parlement italien.
Mais tout cela n’enlève rien au fait que l’euthanasie soit malgré tout devenue, à différents niveaux de l’Église catholique, une question controversée, avec diverses prises de positions, pour ou contre, en guise de matière à débat.
Exactement comme cela est en train de se passer, sous des formes encore plus décomplexées, sur d’autres questions de morale catholique. Par exemple, dernièrement, sur l’encyclique de Paul VI « Humanae vitae » et sa condamnation de la contraception artificielle, qui a vu s’opposer d’un côté, en défense de l’encyclique, le cardinal Luis Francisco Ladaria, Préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi, et de l’autre, en faveur d’une relecture très évolutive de cette même encyclique, le président de l’Académie pontificale pour la Vie, Vincenzo Paglia, rejoint à son tour par le cardinal Matteo Zuppi, moins catégorique que lui mais tout aussi ouvert à des variations.
*
Bref, sur certaines questions, les positions classiques de l’Église catholique en matière de morale trouvent davantage de consensus chez les Juifs que chez nous, comme on a pu le voir dans le cas de l’euthanasie.
Cela est d’ailleurs confirmé par ce que déclarait le Pape Benoît XVI dans son discours avant Noël à la Curie romaine du 21 décembre 2012, le dernier de son pontificat.
Pour mener une critique de fond aussi bien sur les attaques actuelles contre la famille que sur le « gender » en tant que « nouvelle philosophie de la sexualité », Benoît n’a rien trouvé de mieux que de citer, pour appuyer ses dires, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim.
Voici donc ce qu’avait déclaré, mot pour mot, le Pape Joseph Ratzinger à cette occasion :
« Le Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim, dans un traité soigneusement documenté et profondément touchant, a montré que l’atteinte à l’authentique forme de la famille, constituée d’un père, d’une mère et d’un enfant – une atteinte à laquelle nous nous trouvons exposés aujourd’hui – parvient à une dimension encore plus profonde. Si jusqu’ici nous avons vu comme cause de la crise de la famille un malentendu sur l’essence de la liberté humaine, il devient clair maintenant qu’ici est en jeu la vision de l’être même, de ce que signifie en réalité le fait d’être une personne humaine.
Il cite l’affirmation devenue célèbre, de Simone de Beauvoir : ‘On ne naît pas femme, on le devient’. Dans ces paroles se trouve le fondement de ce qui aujourd’hui, sous le mot ‘gender’, est présenté comme une nouvelle philosophie de la sexualité. Le sexe, selon cette philosophie, n’est plus un donné d’origine de la nature, un donné que l’être humain doit accepter et remplir personnellement de sens, mais c’est un rôle social dont on décide de manière autonome, alors que jusqu’ici c’était à la société d’en décider. La profonde fausseté de cette théorie et de la révolution anthropologique qui y est sous-jacente, est évidente. L’être humain conteste d’avoir une nature préparée à l’avance de sa corporéité, qui caractérise son être de personne. Il nie sa nature et décide qu’elle ne lui est pas donnée comme un fait préparé à l’avance, mais que c’est lui-même qui se la crée.
Selon le récit biblique de la création, il appartient à l’essence de la créature humaine d’avoir été créée par Dieu comme homme et comme femme. Cette dualité est essentielle pour le fait d’être une personne humaine, telle que Dieu l’a donnée. Justement, cette dualité comme donné de départ est contestée. Ce qui se lit dans le récit de la création n’est plus valable : ‘Homme et femme il les créa’ (Gn 1, 27). Non, maintenant ce qui vaut c’est que ce n’est pas lui qui les a créés homme et femme, mais c’est la société qui l’a déterminé jusqu’ici et maintenant c’est nous-mêmes qui décidons de cela. Homme et femme n’existent plus comme réalité de la création, comme nature de l’être humain. Celui-ci conteste sa propre nature. Il est désormais seulement esprit et volonté.
La manipulation de la nature, qu’aujourd’hui nous déplorons pour ce qui concerne l’environnement, devient ici le choix fondamental de l’homme à l’égard de lui-même. L’être humain désormais existe seulement dans l’abstrait, qui ensuite, de façon autonome, choisit pour soi quelque chose comme sa nature. L’homme et la femme sont contestés dans leur exigence qui provient de la création, étant des formes complémentaires de la personne humaine. Cependant, si la dualité d’homme et de femme n’existe pas comme donné de la création, alors la famille n’existe pas non plus comme réalité établie à l’avance par la création. Mais en ce cas aussi l’enfant a perdu la place qui lui revenait jusqu’à maintenant et la dignité particulière qui lui est propre.
Bernheim montre comment, de sujet juridique indépendant en soi, il devient maintenant nécessairement un objet, auquel on a droit et que, comme objet d’un droit, on peut se procurer. Là où la liberté du faire devient la liberté de se faire soi-même, on parvient nécessairement à nier le Créateur lui-même, et enfin par là, l’homme même – comme créature de Dieu, comme image de Dieu – est dégradé dans l’essence de son être. Dans la lutte pour la famille, l’être humain lui-même est en jeu. Et il devient évident que là où Dieu est nié, la dignité de l’être humain se dissout aussi. Celui qui défend Dieu, défend l’être humain ! »
*
Vie, famille et sexe ne sont pas des questions marginales dans la vie de l’Église. La désorientation qui l’a envahie doit beaucoup à la cacophonie ambiante sur ces sujets.
Josef Seifert, un philosophe autrichien catholique réputé qui a fondé en 2017 une « Académie Jean-Paul II pour la vie humaine et la famille », parallèle à l’Académie pontificale pour la vie pilotée par Paglia, se dit très préoccupé par cette dérive de l’Église catholique et par le silence par lequel même ceux qui devraient parler restent sans réaction. Les quatre cardinaux des fameux « dubia » auront été les derniers, dit-il, « à avoir parlé avec clarté contre de telles erreurs et contre l’obscurcissement de l’enseignement catholique ».
Et pour que ce silence soit brisé, il a envoyé au printemps dernier une lettre-appel à tous les cardinaux. Confiant que Dieu puisse susciter en eux, ou à tout le moins en certain d’entre eux, « le don du saint courage ».