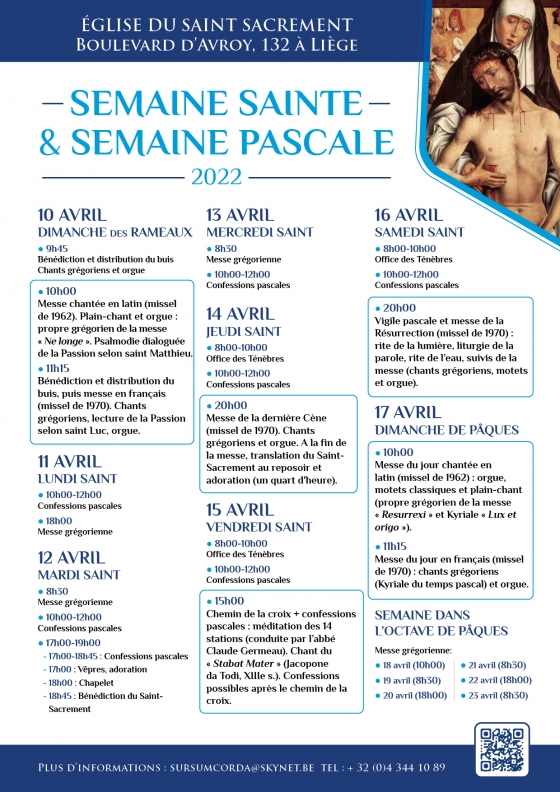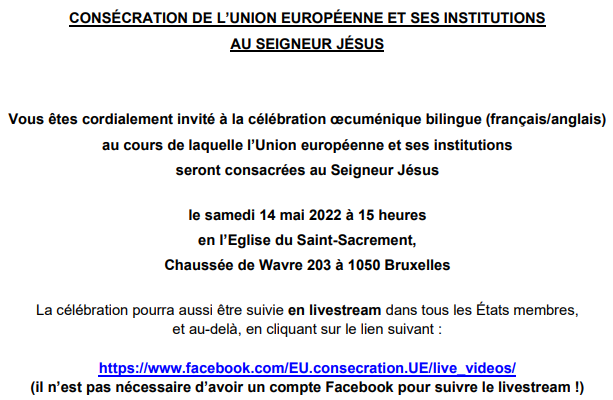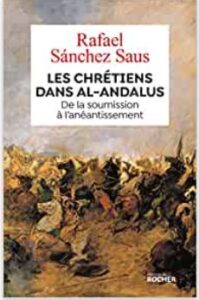De Vatican News (Donatien Nyembo SJ) :
Mgr Manamika : «Soyons fiers d’être chrétiens catholiques»
En visite au Vatican, l’archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika a rencontré le Pape François. Dans l’entretien qu’il a accordé à Vatican News, il évoque plusieurs sujets notamment la vie de son diocèse, la cause de canonisation du cardinal Émile Biayenda et le synode sur la synodalité.
Le 21 novembre 2021, le Saint Père avait accepté la renonciation au gouvernement apostolique de l’archidiocèse métropolitain de Brazzaville, en République du Congo, présentée par Mgr Anatole Milandou. Le même jour, il nommait pour lui succéder, Mgr Bienvenu Manamika, qui était son coadjuteur.
En visite, au Vatican où il a rencontré le Pape François, Mgr Manamika est revenu sur sa nouvelle charge, avouant que «plus un diocèse est grand, plus les difficultés le sont également. Et les joies de même». En d’autres termes, «les joies sont là, les difficultés sont là. Nous n'inventerons pas la roue, mais nous allons travailler pour consolider les acquis [...] Je me jette à l'eau en toute confiance, en essayant de faire la volonté de Dieu comme l'Église le veut», a-t-il déclaré.
Interrogé, par ailleurs, sur ses relations avec son prédécesseur, l’archevêque de la capitale congolaise a évoqué les souvenirs d’un père spirituel et d’un collaborateur dans la vigne du Seigneur. «Nos relations ont toujours été cordiales. J'ai été heureux de travailler avec lui et je continue à bénéficier de son appui spirituel et de ses conseils», nous a-t-il confié.
Assemblée du clergé de Brazzaville
Du 26 juin au 2 juillet 2022, se tiendra à Brazzaville une grande assemblée qui réunira les prêtres de Brazzaville au tour de leur évêque pour repenser leur identité sacerdotale, mieux la consolider. Cette assemblée qui portera sur la communion va se dérouler «dans un contexte marqué par de nouvelles mentalités dans la société et dans l’Église, contexte de tiraillement parfois entre la Tradition de l’Église et des habitudes acquises, de tension entre les intérêts personnels et communautaires». Pour l’ordinaire de Brazzaville, les consultations en cours en vue de cette assemblée concerne l’ensemble des baptisés dont les contributions se recueilleront à travers les conseils pastoraux paroissiaux.
«Le but de cette Assemblée est de consolider la communion au sein du Peuple de Dieu (communion entre clercs, consacrés et tous les baptisés pour un mieux-être en Eglise), cela implique de revisiter notre identité chrétienne en général et sacerdotale en particulier. Il s’agit aussi de remettre la confiance là où elle s’est émoussée, particulièrement dans la gestion du bien commun, de panser les blessures qui existent certainement, de recréer des passerelles là où elles sont défaites, de redonner de la crédibilité à nos services, bref d’insuffler un renouveau là où le sel s’est affadi et là où la lumière a pali.».
Après vingt ans à la tête de l’archidiocèse de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou cède la place à Mgr Bienvenu Manamika.
Marche synodale à Brazzaville
En communion avec l’Église universelle, l’Église-famille de Dieu qui est à Brazzaville poursuit sa marche synodale vers le synode de 2023 sur la synodalité. Mgr Manamika remarque qu’il a fallu un travail de longue haleine, ayant impliqué «la conférence épiscopale, les prêtres jusqu'aux communautés religieuses, pour expliquer ce concept [de synodalité] à tous les fidèles». «Les gens sont enchantés de savoir qu’ils sont consultés par le Saint-Père. Vous voyez, c'est extraordinaire: “Nous sommes consultés, donc nous sommes“. On se sent Église.», a expliqué le prélat congolais pour qui les fidèles, loin d’être sceptiques, ont été joyeusement surpris par cette démarche synodale. Ainsi, ce synode est le fruit de l’Esprit-Saint qui souffle comme Il veut. «Mais il va falloir que tout le travail remonte dans toute sa pureté», avertit-il.
Face à la tourmente que vit l’Église, cette dernière a besoin d’écouter tous ses enfants par ce synode qui devient le kairos, le temps favorable pour réapprendre à marcher ensemble. Le message fort de l’archevêque de Brazzaville à tous les fidèles chrétiens du Congo-Brazzaville et d’ailleurs est le suivant : «Soyons fiers d'être chrétiens, soyons fiers d'être chrétiens. N'ayons pas peur d'afficher notre foi. Ne nous laissons pas embarquer par n'importe quoi et par n'importe qui. Nous sommes chrétiens catholiques. Nous avons des bases solides. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à être fort. N'ayons pas peur non plus. Le Christ l'a dit, il a aussi promis que les puissances de la mort ne l'emporteraient sur cette Église.».
Mgr Manamika au Vatican
Le mercredi 6 avril 2022, le Saint-Père a reçu en audience Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville. C’était en marge d’une mission conjointe de la conférence épiscopale et de l’État congolais. «Nous avons parlé du futur voyage du Saint-Père dans le bassin et autour du bassin du Congo», a déclaré l’archevêque de Brazzaville sans plus de détails. Pour la ministre congolaise de l’environnement qui prenait également part à cette mission, l’État congolais sollicite, d’une part, une visite du Pape François au Congo-Brazzaville, à l’occasion de la célébration, l’année prochaine des 140 ans de l’évangélisation du pays ; et d’autre part, l’organisation d’un synode sur le bassin du Congo, à l’image de celui sur l’Amazonie.
Au Vatican, Mgr Manamika n’a pas manqué de s’informer sur l’évolution de la cause du serviteur de Dieu, le cardinal Émile Biayenda, affectueusement appelé «le Bon Cardinal» au Congo. Pour lui, le cardinal Biayenda est un saint et sa notoriété est incontestable. Malgré le retard enregistré par l’Église du Congo, «la cause est assez avancée. Il y a eu comme un sursaut, un ressaisissement de notre part [l’église du Congo]». Le procès se poursuit donc normalement, affirme Mgr Manamika. «J'ai rencontré les autorités compétentes et tous ceux qui travaillent là-dessus. J'en sors très satisfait tout en disant que nous devons continuer à y travailler.».