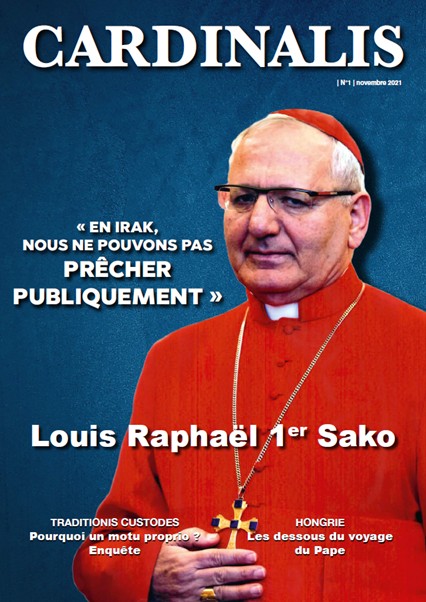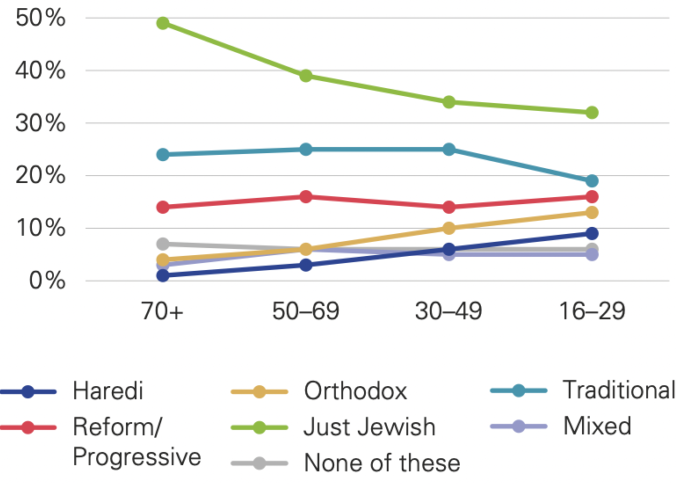Compilé par Gustavo Kralj sur Gaudium Press English Edition :

La reine Isabelle d'Espagne pourrait être bientôt béatifiée
18 février 2022
Selon le responsable de la commission de béatification, il existe déjà un miracle reconnu par Rome et attribué à l'intercession d'Isabelle, qui répondrait à la condition nécessaire pour sa béatification.
Espagne - Valladolid (18/02/2022 10:00 AM Gaudium Press) La cause de béatification de la reine Isabelle la Catholique est terminée. Selon le Père Jose Luis Rubio Willen, responsable de la Commission pour la béatification et la canonisation de la Reine Isabelle la Catholique, la béatification n'attend plus que la décision du Pape François.
Un miracle reconnu par Rome
Le procès de canonisation de la reine Isabelle la Catholique a été lancé par le pape Pie XII en 1957. Il s'est ouvert dix ans plus tard dans l'archidiocèse de Valladolid, en Espagne, où la reine est morte.
Au total, on compte déjà plus de 20 volumes de documentation historique et de nombreuses faveurs obtenues par son intercession.
Selon le père Rubio Willen, il existe déjà un miracle attribué à l'intercession d'Isabel et reconnu par Rome. Il s'agit de la guérison d'un prêtre atteint d'un cancer du pancréas avancé, qui s'est rétabli de manière inexplicable après que sa famille a prié en demandant l'intercession de la reine. Ce miracle remplirait les conditions nécessaires à sa béatification.
La plus grande reine de l'histoire universelle
Une fois ce miracle reconnu et approuvé par le pape, "la plus grande reine de l'histoire universelle sera béatifiée. Il n'y a pas d'autre femme comme elle, et il y a d'autres saintes reines. Avec Isabelle, l'histoire a changé et est entrée dans l'ère moderne. Elle a changé les cartes qui existaient alors, et sa mission était d'apporter l'évangélisation en Amérique", note le père Willen.
Pour l'instant, la Commission "Isabelle la Catholique" continue à promouvoir la dévotion parmi les fidèles par le biais d'imprimés, de livres, de vidéos et de symposiums. "Notre objectif - souligne le père Willen - est d'aider les gens à la remarquer comme une sainte, à la vénérer et à accueillir son intercession." (EPC)