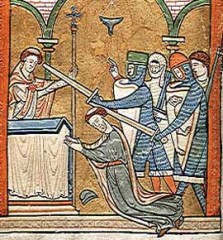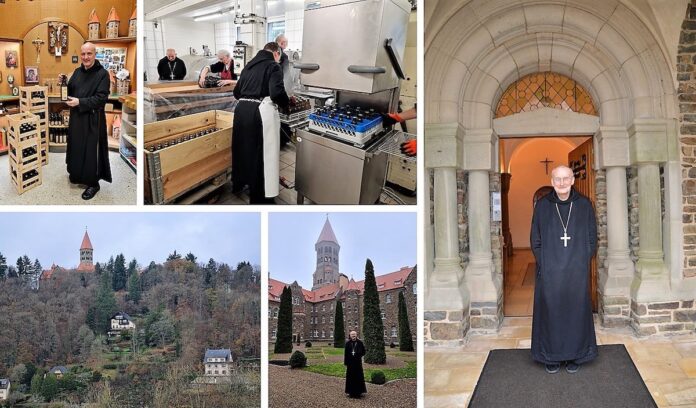D'Anna Bono sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana :
La dénonciation courageuse d'un évêque au Nigeria
31-12-2021
Monseigneur Matthew Hassan Kukah a dénoncé les violences au Nigeria et le silence du président Buhari. Il a dénoncé la disparition de centaines de garçons et de filles et le fléau des enlèvements. Dans l'une d'entre elles, un prêtre, le père Luke Adeleke, est mort.

Il faut du courage, surtout dans certains pays, pour accuser ouvertement le gouvernement et le chef d'État de ne pas valoriser la vie humaine, au lieu de se limiter, comme beaucoup, à déplorer la violence et la tyrannie sans citer de noms. Ce courage ne fait pas défaut à Monseigneur Matthew Hassan Kukah, évêque catholique de Sokoto, au Nigeria, qui, dans son message de Noël, a demandé au président Muhammadu Buhari de rendre compte, et ce n'est pas la première fois, du niveau insoutenable de violence qui ravage son pays. "Le silence du gouvernement fédéral", déclare Monseigneur Kukah, "nourrit l'horrible bête de la complicité avec les actions de personnes malfaisantes qui ont compromis l'avenir de générations entières d'enfants. Le président du Nigeria nous doit une explication et des réponses : quand les enlèvements, les séquestrations pour extorsion, les massacres brutaux, insensés et sans fin de nos compatriotes prendront-ils fin ? Quand nos réfugiés au Cameroun, au Tchad ou au Niger pourront-ils rentrer chez eux ? Il est urgent de répondre à ces questions".
Monseigneur Kukah, qui vit dans l'un des douze États du nord à majorité islamique de la fédération nigériane, parle avant tout de la situation dramatique de leurs habitants : dans le nord-est, ils sont persécutés par les djihadistes, qui sévissent contre les chrétiens et les musulmans qui ne respectent pas strictement la loi coranique, et menacés partout par la violence des groupes armés et des criminels de droit commun qui agissent presque sans être inquiétés : "une quantité sans précédent de cruauté s'est déchaînée sur des citoyens innocents dans les États du nord. Des innocents ont été arrachés à leur lit, à leur champ, happés par les marchés et même les autoroutes et sacrifiés aux dieux du mal. Les communautés ont été transformées en goulags de misère, de mort, de souffrance et de méchanceté".
Alors que les décès sont quotidiens et que la situation sécuritaire continue de se dégrader, le gouvernement semble avoir choisi d'ignorer le sort des Nigérians, de les laisser à la merci du mal. Il est clair, insiste Monseigneur Kukah, que l'administration du président Buhari ne valorise plus le caractère sacré de la vie humaine : "rien n'exprime le désarroi des familles comme le silence de l'État au niveau fédéral. Aujourd'hui, après plus de sept ans, on ignore le sort de plus de cent filles à Chibok, et plus de trois ans plus tard, on ne sait rien de Leah Sharibu. Les étudiants du Yauri Federal Government College et les enfants de l'école Islamiyya dans l'État de Katsina sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. En outre, nous avons perdu le compte des centaines d'autres enfants enlevés qui ne sont pas couverts par les médias, et des centaines de personnes et de familles qui ont subi le même sort".
Les filles de Chibok sont les 274 écolières, presque toutes chrétiennes, qui ont été enlevées en 2014 par le groupe djihadiste Boko Haram et pour lesquelles le monde a agi sans succès. Avec le temps, beaucoup ont été libérées, mais plus d'une centaine sont portés disparues : peut-être mortes, peut-être contraintes de se faire exploser sur les marchés et dans les gares routières pour semer la panique dans la population, peut-être vivantes et mariées de force aux djihadistes. Leah Sharibu est l'une des 109 écolières enlevées par Boko Haram en février 2018, la seule à ne pas avoir été libérée car elle est chrétienne et a refusé d'abjurer et de se convertir à l'islam. Les autres enlèvements mentionnés par Mgr Kukah se sont produits, et continuent de se produire, dans les États du nord-ouest. Dans le cas des étudiants, il y a maintenant au moins un millier de jeunes enlevés extirpés dans différentes écoles.
Mais le kidnapping est depuis longtemps un fléau national. La veille de Noël, un prêtre, le père Luke Adeleke, curé de l'église Saint-Antoine à Ijemo Fadipe, dans l'État d'Ogun, à l'extrême sud du pays, a également été victime. Gregory Fadele, directeur des communications sociales du diocèse d'Abeokuta, auquel appartient le père Adeleke, "Le père Luke venait de célébrer l'eucharistie pour la communauté et rentrait chez lui. Il voyageait avec un garçon de 11 ans qui, heureusement, n'a pas été blessé. Sur la route bordant la forêt, à un moment donné, des bandits ont commencé à tirer, probablement pour tenter de le kidnapper. Nous supposons qu'ils voulaient tirer dans les pneus de la voiture, mais les balles ont touché notre prêtre aux deux jambes. Le père Luke a commencé à perdre beaucoup de sang. Il était très faible, mais il a réussi à conduire jusqu'à l'hôpital, mais quand il est arrivé, il était déjà mourant.
Plusieurs autres prêtres ont été enlevés au Nigeria et presque toujours libérés, sans que l'on sache si c'est en échange du paiement d'une rançon. En général, les kidnappeurs agissent en réseau, explique le père Fadele, et lorsqu'ils voient une voiture dans laquelle ils supposent qu'il y a une personne qui, kidnappée, pourrait rapporter une rançon, ils agissent. Récemment, la situation s'est aggravée, ils entrent en action avec n'importe qui, quel que soit le type de voiture ou le bien-être économique présumé du conducteur. Dans les grandes villes, à l'exception de la zone nord où Boko Haram est actif, les enlèvements sont plutôt rares. Le problème se pose en dehors de la ville, dans les zones forestières ou sur les routes reliant les villes aux zones périphériques. Les enlèvements sont plus fréquents dans ces zones.
Les funérailles du père Adeleke ont eu lieu le 30 décembre dans la cathédrale des Saints Pierre et Paul à Adatan, dans le diocèse d'Abeokuta. Il n'avait que 38 ans. Aux appels de Monseigneur Kukah, le président Buhari a réagi avec irritation, déclarant qu'il déformait les faits, que la situation dans le pays n'était pas du tout si grave. En avril dernier, le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a déclaré que ses critiques à l'égard du président étaient "impies" et idéologiques.