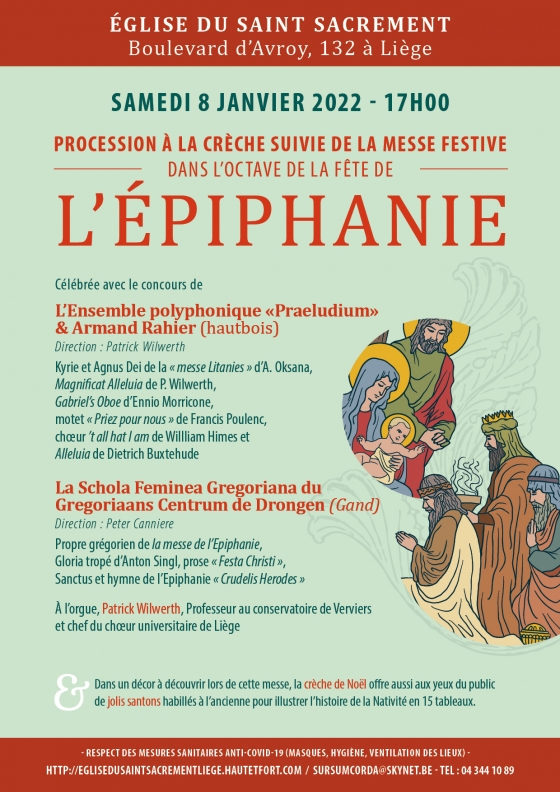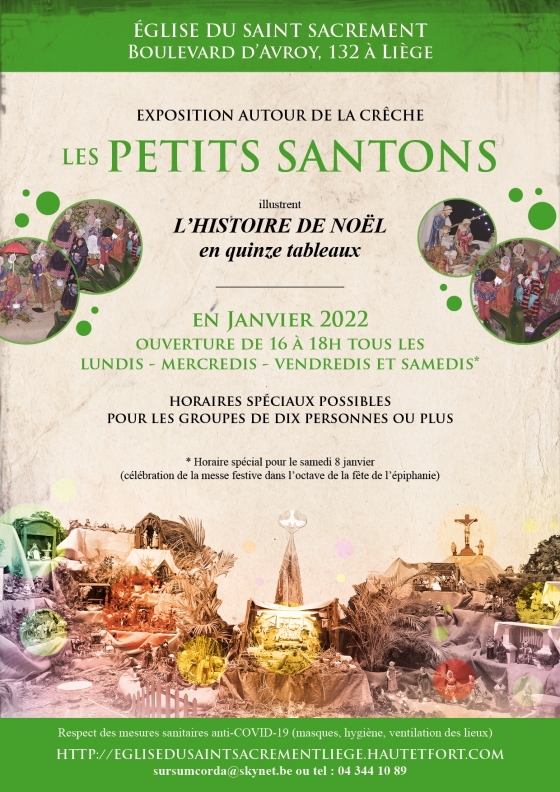Neuvaine à la Vierge des Pauvres (source)
Le 15 janvier 1933 est la date de la première apparition de la Vierge à Banneux; c'est donc le moment de "faire" une neuvaine pendant les jours qui précèdent cet anniversaire.
Introduction

Au cours de ses huit apparitions à Banneux, la Vierge des Pauvres a lancé à trois reprises un appel pressant à la prière: «Priez beaucoup ». Elle reprend une recommandation de Jésus lui-même qui parle de « la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager». (Luc 18,1) Les apôtres ont répété le même conseil. St Paul écrit : « soyez assidus à la prière» (Rom 12, 12), « Priez sans relâche » (1 Thess. 5, 17) Après l’Ascension, les disciples ont consacré à la prière ces jours d’attente de la Pentecôte. Ils ont demandé l’Esprit Saint. Ils ont été exaucés. Le résultat merveilleux de cette première neuvaine de jours est à l’origine de la pratique des neuvaines dans l’Eglise.
Marie participait à cette prière, elle qui avait fait l’expérience de toutes les mamans qui attendent pendant une neuvaine de mois, la naissance de l’enfant qu’elles portent.
Prions avec confiance la Vierge des Pauvres: demandons-lui de nous aider à prier et à nous laisser guider par l’Esprit dans la prière et dans notre vie.
Invocations

VIERGE DES PAUVRES conduis-nous à Jésus, Source de la grâce.
VIERGE DES PAUVRES sauve les Nations.
VIERGE DES PAUVRES soulage les malades.
VIERGE DES PAUVRES soulage la souffrance.
VIERGE DES PAUVRES prie pour chacun de nous.
VIERGE DES PAUVRES nous croyons en Toi.
VIERGE DES PAUVRES crois en nous.
VIERGE DES PAUVRES nous prierons beaucoup.
VIERGE DES PAUVRES bénis-nous.
VIERGE DES PAUVRES Mère du Sauveur Mère de Dieu, merci!
N.B. : Il est recommandé de réciter ces invocations chaque jour après la prière indiquée ci-dessous. On peut y ajouter une dizaine du chapelet, ou si possible, un chapelet entier.


 « Une page se tourne avec l’évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Rey : celle de 2021. Une autre, toute blanche encore, va se noircir de quelques lettres, de quelques mots, de quelques phrases : celle de 2022. Celui qui fêtait ses 20 années à la tête du diocèse, l’année dernière, fêtera, en 2022, ses 70 ans de pèlerinage terrestre, ou plutôt de navigation maritime. Car, face aux avis de tempête, sur cette mer agitée, il est entre deux eaux, comme l’Eglise de France. Dort-il comme le Christ au fond de sa barque ? Navigation en eaux troubles, avec cet évêque-skipper au long cours.
« Une page se tourne avec l’évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Rey : celle de 2021. Une autre, toute blanche encore, va se noircir de quelques lettres, de quelques mots, de quelques phrases : celle de 2022. Celui qui fêtait ses 20 années à la tête du diocèse, l’année dernière, fêtera, en 2022, ses 70 ans de pèlerinage terrestre, ou plutôt de navigation maritime. Car, face aux avis de tempête, sur cette mer agitée, il est entre deux eaux, comme l’Eglise de France. Dort-il comme le Christ au fond de sa barque ? Navigation en eaux troubles, avec cet évêque-skipper au long cours.