Du site "Marie de Nazareth" :
NEUVAINE À ND DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2020
Participez à une belle neuvaine à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, du 18 au 26 novembre 2020, veille de la fête de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse !
Chaque matin de cette neuvaine à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, vous recevrez par email le contenu du jour de la neuvaine comprenant des méditations sur la Vierge Marie, des enseignements et des prières.
Cette neuvaine à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse a été préparée par le Père Jean-Yves Jaffré, prêtre missionnaire lazariste, ancien prêtre de la Chapelle de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris.
Pourquoi faire une neuvaine à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse ?
Parce que le 18 juillet 1830, la Vierge Marie apparaît à Soeur Catherine Labouré et offre un lieu de grâces très spécial, en permanence ouvert aux croyants ! Dans la chapelle de la rue du Bac, elle s’exprime en ces mots : « Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. » Que peut-on espérer de plus ?
Les apparitions culminent le 27 novembre 1830 (jour de la mort de Clovis en 511) avec, pour la première fois, l’apparition de la Médaille miraculeuse sur laquelle on lit l’inscription : « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La Médaille miraculeuse montre l’image des deux Cœurs unis de Jésus et de Marie !
Mais, pour Catherine Labouré, le moment le plus impressionnant est la vision de la prière d’intercession de la « Vierge puissante » auprès de Dieu. « Quand elle priait, sa figure était si belle, si belle, qu’on ne pourrait la dépeindre. » Cette vision de Marie implorant la Miséricorde divine – la « Vierge au globe », cette fameuse « Vierge puissante » – a ravi l’âme de sainte Catherine.
Avec cette neuvaine, ayons nous aussi le courage de nous laisser ravir par la Vierge ! Adressons-nous à elle en TOUTE confiance et demandons les grâces que nous pensons nécessaires pour suivre Jésus.
Prière à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Ô Vierge Immaculée,
Mère de Dieu et notre Mère
avec la plus vive confiance
dans votre puissante intercession
tant de fois manifestée au moyen de votre Médaille,
nous vous supplions humblement
de bien vouloir nous obtenir les grâces
(demander une grâce personnelle)
Ô Vierge de la Médaille Miraculeuse
qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré
dans l’attitude de médiatrice du monde entier
et de chaque âme en particulier,
nous remettons entre vos mains
et nous confions à votre Cœur nos supplications.
Daignez les présenter à votre Divin Fils
et les exaucer si elles sont conformes
à la Volonté Divine et utiles à nos âmes.
Et, après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous
des rayons de vos grâces, en éclairant nos esprits,
en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite,
nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité.
Amen.
Merci de partager cette neuvaine à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse largement autour de vous pour que nous soyons des dizaines de milliers à le prier ensemble ce grand saint aimé de TOUS !
Cette neuvaine à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse vous sera envoyée gracieusement par email du 18 au 26 novembre 2020 par l’Association Marie de Nazareth, 226 rue Lecourbe - 75015 Paris - contactmariedenazarethcom.
Pour être sûr de recevoir les emails de la neuvaine, merci d'ajouter lettremariedenazarethorg à vos contacts.
 Dans un style simple et direct, des spécialistes, universitaires ou prêtres, dialoguent avec Régis Burnet, bibliste, en apportant des réponses aux questions que nous pouvons nous poser sur la foi, la liturgie, de grandes figures chrétiennes (ci-contre à gauche, le compositeur Arvo Pärt chez le pape émérite Benoît XVI):
Dans un style simple et direct, des spécialistes, universitaires ou prêtres, dialoguent avec Régis Burnet, bibliste, en apportant des réponses aux questions que nous pouvons nous poser sur la foi, la liturgie, de grandes figures chrétiennes (ci-contre à gauche, le compositeur Arvo Pärt chez le pape émérite Benoît XVI):
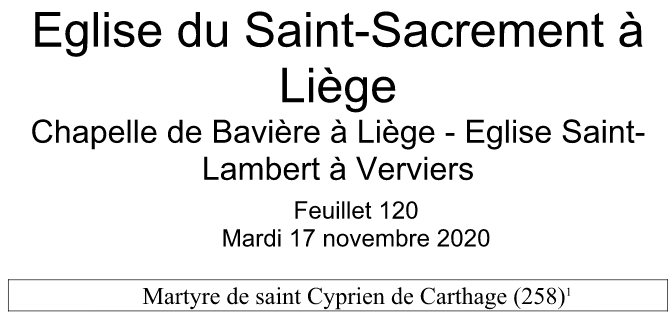
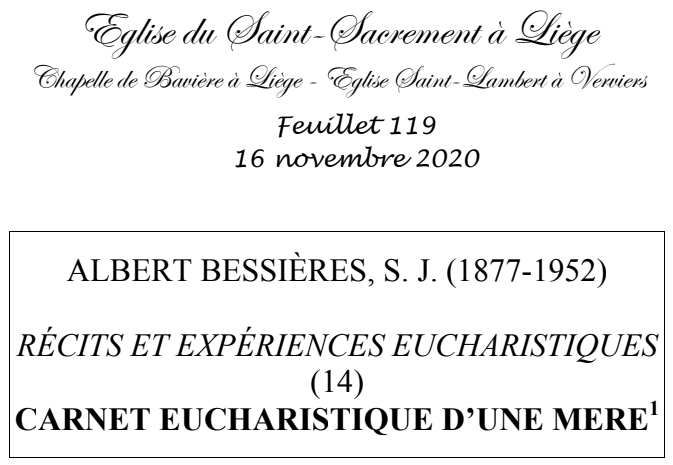

 Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.
Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.
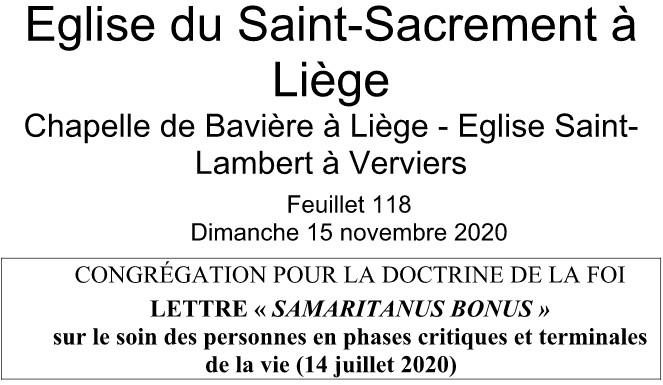
 Emission du 14 novembre sur RCF à propos des manifestations demandant la restauration de la liberté de culte et du maintien de l’instruction religieuse pendant le confinement :
Emission du 14 novembre sur RCF à propos des manifestations demandant la restauration de la liberté de culte et du maintien de l’instruction religieuse pendant le confinement : 