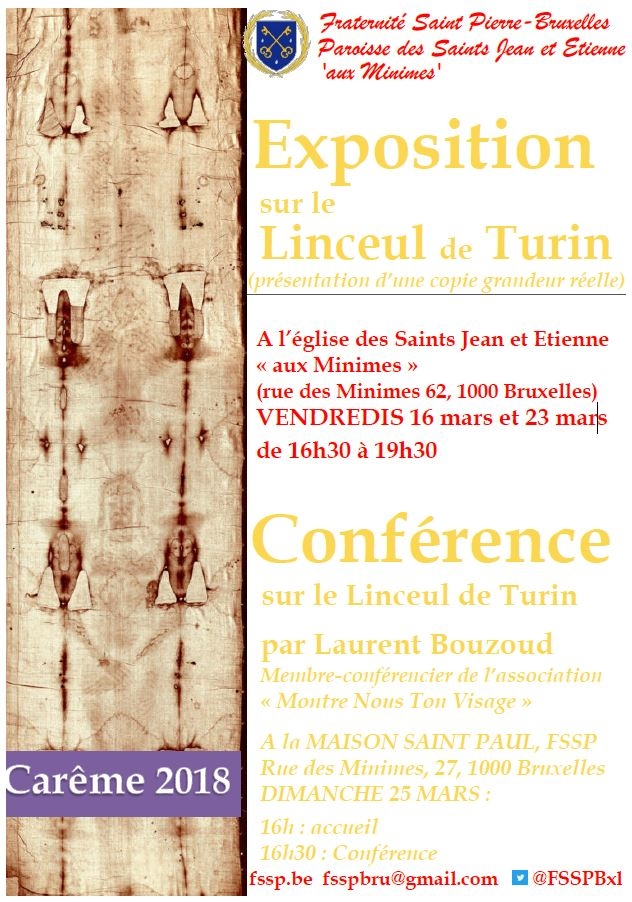De Samuel Pruvot sur le site de l'hebdomadaire "Famille Chrétienne" :
Mgr Philippe Barbarin : « Il faut accompagner les néophytes issus de l’islam »
Le cardinal Barbarin est intervenu le 17 mars à Lyon lors du forum « Jésus le Messie ». Devant diverses associations œuvrant à l’accueil et l’évangélisation des musulmans en France, il a insisté sur la nécessité d’une pastorale spécifique à leur égard.
Est-il nécessaire d’inventer quelque chose de spécifique pour les chrétiens qui viennent de l’islam ?
Après le catéchuménat et l’immense joie du baptême, on imagine que ces nouveaux chrétiens trouvent sans difficulté leur place dans l’Eglise. C’est assez naïf. L’expérience prouve qu’il faut leur porter une attention particulière. Ils sont les premiers à exprimer leur reconnaissance, parce qu’on s’est bien occupé d’eux pendant les deux années de préparation. « Mais maintenant, disent-ils, nous nous sentons abandonnés au milieu du troupeau ! » Ils ont reçu une présentation solide de la Bible une bonne explication du Credo et des quatre piliers de la foi, mais il y a encore beaucoup à faire pour accompagner leurs premiers pas dans l’Eglise. Bien des diocèses en ressentent la nécessité.
Evangéliser les musulmans qui sont en France, cela n’est-il pas contraire au dialogue ?
Evangéliser, c’est l’ultime consigne que Jésus nous laisse : « Allez, de toutes les nations faites des disciples. » Il me paraît évident que nous devons lui obéir, dans l’amour, l’écoute et le respect de l’autre. On se souvient du magnifique cri de saint Paul : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! » Par ailleurs, les musulmans comprennent très bien notre souci d’accompagner avec attention les néophytes originaires de l’islam. Un jour, je visitais une mosquée avec Azzedine Gaci (NDLR : ancien président du conseil régional du culte musulman) et il m’a confié que dans la plupart des mosquées, on mettait en place des groupes d’accompagnement pour les musulmans nouvellement arrivés du christianisme. Au fond, c’est le même souci : est-ce que les nouveaux venus sont bien accueillis, accompagnés ? Il faut du temps à un musulman devenu chrétien pour comprendre ce que veut dire « Parole de Dieu ». Nous ne sommes pas une « religion du Livre », mais du « Verbe fait chair ». Il y a un continuel va et vient entre le corps de Jésus, l’Eucharistie et la Parole de Dieu. On doit aussi éclairer la notion de prophète, expliquer l’anthropologie chrétienne (corps, âme et esprit). Saint Paul dit que nos corps sont des « temples de l’Esprit Saint » et il ajoute : « Rendez gloire à Dieu dans votre corps ». Cela peut nous amener à proposer un éclairage sur la sexualité, le sport ou la danse…. Le chrétien venu de l’Islam a aussi besoin d’explications pour comprendre notre engagement dans la vie sociale et politique. L’essentiel, bien sûr, c’est d’abord le Mystère de Dieu, sa paternité, la Trinité… un approfondissement qui va l’aider à changer en profondeur sa manière de prier.
Qu’est-ce que ces chrétiens issus de l’islam peuvent apporter à l’Eglise ?
Les musulmans venus au christianisme vont nous apporter des cadeaux inattendus. Il faudra du temps pour voir émerger cette nouvelle manière de vivre la foi chrétienne. Ils vont offrir bien des points de renouveau culturel et spirituel à la grande famille de l’Eglise. Quand j’étais à Madagascar, j’ai reçu des séminaristes que j’avais mission de former sur des paroles vraiment nouvelles sur le Christ. Elles venaient du fond de leur culture, évangélisée depuis à peine plus d’un siècle. C’est la fécondité, le travail intérieur de la Parole de Dieu, toujours vivante, tranchante, comme dit l’épitre aux Hébreux ! Aujourd’hui, beaucoup de maghrébins, de kabyles ou d’iraniens sont devenus chrétiens en France, et ils nous apportent des regards inattendus sur Jésus et sur la Révélation chrétienne. C’est ainsi que l’Evangile est et sera toujours en train de renouveler l’Eglise.
 Plusieurs livres récents évoquent l’engagement des chrétiens dans la cité avec pour toile de fond un monde occidental qui n’est plus chrétien, preuve qu’il s’agit là d’une question majeure. Petit tour d’horizon de ces différents ouvrages par Christophe Geffroy, dans le mensuel « La Nef », mars 2018 :
Plusieurs livres récents évoquent l’engagement des chrétiens dans la cité avec pour toile de fond un monde occidental qui n’est plus chrétien, preuve qu’il s’agit là d’une question majeure. Petit tour d’horizon de ces différents ouvrages par Christophe Geffroy, dans le mensuel « La Nef », mars 2018 :