De Catholic News Agency (Katie Yoder, Christine Rousselle, Shannon Mullen) :
Marche pour la Vie 2022 : "Un grand témoignage du caractère sacré de la vie humaine"

Participants à la Marche pour la vie à Washington, D.C., le 21 janvier 2022. | CNA
Washington D.C., 21 janv. 2022
Les participants sont revenus en grand nombre à la marche annuelle pour la vie vendredi, bravant le temps glacial un an après l'arrêt virtuel de l'événement en raison de la pandémie, afin de manifester leur solidarité pour les enfants à naître au début de ce qui pourrait être une année décisive pour le mouvement pro-vie.
Annoncé comme la "plus grande manifestation des droits de l'homme au monde", le rassemblement d'une journée a commencé timidement avec des grappes éparses de participants emmitouflés qui se sont dirigés vers le National Mall par une matinée claire mais fraîche. Les chaussettes de laine que les frères franciscains portaient sous leurs sandales témoignaient du froid intense.
La crise actuelle du coronavirus, associée au renforcement des restrictions relatives au COVID-19 dans le district de Columbia, a retenu certains habitués chez eux. Mais dès le début du rassemblement de la mi-journée, précédant la marche et marqué par un discours passionné du père Mike Schmitz, star du podcast "Bible in a Year", la foule a atteint des dizaines de milliers de personnes, ressemblant à une année normale.
Mais la marche de cette année était tout sauf typique. La possibilité que la plus haute juridiction du pays annule, dans le courant de l'année, la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays - et qui a donné naissance à la première Marche pour la vie il y a 49 ans - a donné un air de fête et d'anticipation aux rituels de la journée, qui a culminé par une marche sur Constitution Avenue jusqu'aux marches de la Cour suprême.
"Nous espérons et prions pour que cette année, 2022, apporte un changement historique pour la vie", a déclaré lors du rassemblement Jeanne Mancini, présidente de March for Life, organisatrice de l'événement.
"Roe", a-t-elle ajouté, "n'est pas une loi établie".
Pas de temps pour la complaisance
De telles déclarations ont un poids supplémentaire cette année en raison de l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, un cas crucial d'avortement au Mississippi que de nombreux membres du mouvement pro-vie considèrent comme la meilleure - et peut-être la dernière - occasion de défaire le cadre juridique étroitement tissé qui a produit quelque 62 millions d'avortements aux États-Unis, un bilan stupéfiant que l'Église catholique considère comme une tragédie humaine épique. Une décision dans cette affaire n'est pas attendue avant la fin du mandat de la Cour en juin.
"La Cour suprême, si Dieu le veut, (est) prête à confirmer l'affaire Dobbs, à empêcher les avortements après 15 semaines, mais aussi à commencer, et nous l'espérons, le démantèlement de Roe v. Wade", a déclaré le représentant Chris Smith (R-N.J.), qui a pris la parole lors du rassemblement.
La polarisation intense qui entoure l'affaire a été rendue manifeste par un coup de publicité effronté d'un groupe d'activistes appelé Catholics for Choice, qui a diffusé jeudi soir des messages pro-choix soigneusement calibrés sur la façade de la basilique du sanctuaire national de l'Immaculée Conception, tandis qu'une veillée de prière pour mettre fin à l'avortement se déroulait à l'intérieur. Le cardinal Wilton Gregory, archevêque de Washington, a critiqué les actions du groupe, qu'un autre prélat, l'archevêque Salvatore J. Cordileone, a qualifié de "diabolique".
L'archevêque William E. Lori de Baltimore, président du Comité des activités pro-vie de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a déclaré que le mouvement pro-vie ne peut se permettre de devenir "complaisant", quelle que soit l'issue de l'affaire Dobbs.
"L'opposition de l'Église catholique à l'avortement est une réponse d'amour pour les mères et leurs enfants dans le ventre de leur mère. L'enseignement de l'Église proclame un message de vie, nous rappelant que toute vie est un don sacré de Dieu depuis le moment de la conception jusqu'à la mort naturelle", a déclaré Mme Lori dans un communiqué.
"Nous ne pouvons pas construire une société vraiment juste et rester complaisants face à l'impact massif de Roe v. Wade, qui a pris plus de 60 millions de vies depuis 1973. Puissions-nous prier, jeûner et travailler pour le jour où le don de chaque vie humaine sera protégé par la loi et accueilli dans l'amour", a-t-il ajouté.
Une large présence catholique
Le drame de jeudi soir a fait place à une démonstration de solidarité optimiste lors de la marche de vendredi. Selon une pratique de longue date, ni les organisateurs ni la police n'ont fourni d'estimation du nombre de marcheurs.
Plus de 200 étudiants de l'université franciscaine de Steubenville, dans l'Ohio, sont arrivés en bus pour la marche avant 5 heures du matin vendredi, ont indiqué deux étudiants à CNA. Le trajet en bus a duré plus de cinq heures.

Participants à la Marche pour la vie à Washington, D.C., le 21 janvier 2022. CNA
C'était la première Marche pour la Vie pour Lucia Hunt, 18 ans, de Dallas, Texas, et Niklas Koehler, 21 ans, d'Ashburn, Virginie. Ils ont déclaré que la marche avait répondu à leurs attentes.
"J'avais vraiment hâte de voir tout un tas de gens qui défendent la vie et il y a cette énorme foule, alors je suis vraiment content du mouvement pro-vie", a déclaré Koehler.
"Je m'attendais à une forte présence catholique et je l'ai vue jusqu'à présent, ce qui me réjouit", a déclaré Lucia Hunt. Elle a expliqué qu'elle est pro-vie "parce que je crois en la vérité, et la vérité est qu'un enfant est un être humain du moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle".
Elle a ajouté : "Non seulement un enfant est un être humain, mais un être humain est aussi un enfant de Dieu, et je crois en la protection de cette vie."
Beaucoup de marcheurs étaient là pour la première fois, notamment un groupe de jeunes femmes de Charlotte, en Caroline du Nord.
"Je pense simplement que nous pouvons avoir plus d'options pour les gens plutôt que de simplement mettre fin à des vies", a déclaré à CNA Millie Bryan, une jeune fille de 17 ans de Charlotte. Millie Bryan participait à sa toute première Marche pour la Vie et portait une pancarte sur laquelle on pouvait lire "Arrêtez de dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas terminer leurs études, avoir une carrière, réussir sans avortement".
Elle a ajouté qu'elle avait surtout hâte de "voir les gens se rassembler pour se battre pour quelque chose de vraiment important, pour se battre pour la vie".
Des cornemuseurs et des joueurs de tambour de l'American Society for the Defense of Tradition, Family and Property ont conclu la marche. Les membres du groupe ont brandi des drapeaux rouges et porté avec révérence une plate-forme surmontée d'une statue de Notre-Dame de Fatima.
"Il y a encore beaucoup de gens ici. C'est formidable que les gens aient encore fait le sacrifice de venir", a déclaré le père David Yallaly, qui a participé à la marche avec le groupe Crusaders for Life, basé à Chicago. "C'est un grand témoignage du message du caractère sacré de la vie humaine".
(Katie Yoder est correspondante au bureau de l'ANC à Washington, D.C.. Elle couvre les questions pro-vie, les évêques catholiques des États-Unis, les politiques publiques et le Congrès. Elle a travaillé auparavant pour Townhall.com, National Review et le Media Research Center.
Christine Rousselle est correspondante à Washington pour la Catholic News Agency. Avant de travailler pour la CNA, elle était rédactrice en chef du site Townhall.com. Elle est titulaire d'une licence en sciences politiques du Providence College.
Shannon Mullen est le rédacteur en chef de l'AIIC. Auparavant, il a travaillé comme rédacteur en chef, journaliste d'investigation et éditeur pour le Asbury Park (N.J.) Press.)


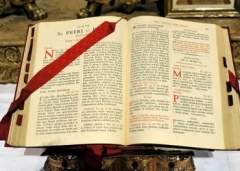 A propos d’un motu proprio qui ne passe décidément pas la rampe : tribune du journaliste et écrivain Laurent Dandrieu dans le journal « La Croix » du 25 janvier 2021 :
A propos d’un motu proprio qui ne passe décidément pas la rampe : tribune du journaliste et écrivain Laurent Dandrieu dans le journal « La Croix » du 25 janvier 2021 :
