L’entretien du pape François avec les évêques polonais , le 27 juillet 2016 à Cracovie, s’est déroulé à huis-clos.Cet échange a néanmoins été publié ensuite par la Salle de presse du Saint-Siège. Les questions ont porté sur la sécularisation du monde moderne, la miséricorde, l’annonce de l’Évangile dans un monde en mutation et l’accueil des réfugiés. Mais rien n’a filtré concernant l’exhortation apostolique « Amoris laetitia ». Un « verbatim » des réponses, faites dans le style prolixe et diffus qui caractérise l’auteur, a été reproduit par « La Croix », sous forme de longs extraits sélectionnés par les soins du journal :
Pape François
Avant de commencer le dialogue, avec les questions que vous avez préparées, je voudrais accomplir une œuvre de miséricorde envers vous tous et en suggérer une autre. Je sais qu’en ces jours, avec les Journées de la Jeunesse, beaucoup d’entre vous ont été très pris et qu’ils n’ont pas pu aller aux obsèques du bien-aimé Mgr Zimowski. Enterrer les morts est une œuvre de charité, et je voudrais que tous ensemble, maintenant, nous fassions une prière pour Mgr Zygmund Zimowski et que cette prière soit une vraie manifestation de charité fraternelle, enterrer un frère qui est mort. Pater noster… Ave Maria… Gloria Patri… Requiem aeternam…
Et puis, l’autre œuvre de miséricorde que je voudrais suggérer. Je sais que vous en êtes préoccupés : notre cher cardinal Macharski qui est très malade… Au moins s’approcher, parce que je crois qu’on ne pourra pas entrer là où il se trouve, dans le coma, mais au moins s’approcher de la clinique, de l’hôpital, et toucher le mur comme pour dire : “Frère, je te suis proche”. Visiter les malades est une autre œuvre de miséricorde. Moi aussi, j’irai. Merci !
À présent, l’un d’entre vous a préparé les questions, au moins il les fait parvenir. Je suis à [votre] disposition.
[…]
1. Sécularisation du monde moderne : déchristianisation, gnosticisme
S.E. Mgr. Marek Jędraszewski
Saint-Père, il semble que les fidèles de l’Église catholique, et en général tous les chrétiens en Europe occidentale, en viennent à se trouver toujours davantage en minorité dans le domaine d’une culture contemporaine athée-libérale. En Pologne, nous assistons à une confrontation profonde, à une lutte impressionnante entre la foi en Dieu d’une part, et d’autre part une pensée et des styles de vie tendant à faire croire que Dieu n’existait pas. À votre avis, Saint-Père, quel genre d’actions pastorales l’Église catholique devrait entreprendre dans notre pays, afin que le peuple polonais demeure fidèle à sa tradition chrétienne désormais plus que millénaire ? Merci !
Pape François
Excellence, vous êtes l’évêque de… ?
S.E. Mons. Marek Jędraszewski
De Łodź, où le cheminement de sainte Faustine a commencé ; parce qu’elle a entendu, là-même, l’appel du Christ à aller à Varsovie et à devenir moniale, à Łodź même. L’histoire de sa vie a commencé dans ma ville.
Pape François
Vous êtes un privilégié ! C’est vrai, la déchristianisation, la sécularisation du monde moderne est forte. Elle est très forte. Mais certains disent : Oui, elle est forte, néanmoins on voit des phénomènes de religiosité, comme si le sens religieux se réveillait. Et cela peut être aussi un danger. Je crois que, dans ce monde si sécularisé, il y a aussi l’autre danger, [celui] de la spiritualisation gnostique : cette sécularisation nous donne la possibilité de faire croître une vie spirituelle un peu gnostique. Souvenons-nous que ce fut la première hérésie de l’Église : l’apôtre Jean fustige les gnostiques – et avec quelle force ! –, qui ont une spiritualité subjective, sans le Christ. Le plus grave problème, selon moi, de cette sécularisation est la déchristianisation : enlever le Christ, enlever le Fils. Je prie, je sens… et rien de plus. C’est le gnosticisme. Il y a une autre hérésie également à la mode, en ce moment, mais je la laisse de côté parce que votre question, Excellence, va dans cette direction. Il y a aussi un pélagianisme, mais laissons cela de côté, pour en parler à un autre moment. Trouver Dieu sans le Christ : un Dieu sans le Christ, un peuple sans Église. Pourquoi ? Parce que l’Église est la Mère, celle qui te donne la vie, et le Christ est le Frère aîné, le Fils du Père, qui renvoie au Père, qui est celui qui te révèle le nom du Père. Une Église orpheline : le gnosticisme d’aujourd’hui, puisqu’il est précisément une déchristianisation, sans le Christ, nous porte à une Église, mieux, disons, à des chrétiens, à un peuple orphelin. Et nous avons besoin de faire sentir cela à notre peuple.
Qu’est-ce que je conseillerais ? Me vient à l’esprit – mais je crois que c’est la pratique de l’Évangile, où il y a l’enseignement même du Seigneur – la proximité. Aujourd’hui, nous, les serviteurs du Seigneur – évêques, prêtres, consacrés, laïcs convaincus –, nous devons être proches du peuple de Dieu. Sans proximité, il n’y a que parole sans chair. Pensons – j’aime penser à cela – aux deux piliers de l’Évangile. Quels sont les deux piliers de l’Évangile ? Les béatitudes, et puis Matthieu 25, le “protocole” selon lequel nous serons jugés. Être concret. Proximité. Toucher. Les œuvres de miséricorde, soit corporelles, soit spirituelles. “Mais vous dites ces choses parce que c’est à la mode de parler de la miséricorde cette année…”. Non, c’est l’Évangile ! L’Évangile, œuvres de miséricorde. Il y a cet hérétique ou mécréant samaritain qui s’émeut et qui fait ce qu’il doit faire, et il y investit même de l’argent ! Toucher. Il y a Jésus qui était toujours parmi les gens ou avec le Père. Ou en prière, seul à seul avec le Père, ou parmi les gens, là, avec les disciples. Proximité. Toucher. C’est la vie de Jésus… Quand il s’est ému, aux portes de la ville de Naïm (cf. Lc 7, 11-17), il s’est ému, il est allé et a touché le cercueil, en disant : “Ne pleure pas…”. Proximité. Et la proximité, c’est de toucher la chair souffrante du Christ. Et l’Église, la gloire de l’Église, ce sont les martyrs, certainement, mais ce sont aussi tant d’hommes et de femmes qui ont tout abandonné et qui ont passé leur vie dans les hôpitaux, dans les écoles, avec les enfants, avec les malades… Je me rappelle, en Centrafrique (1), une religieuse modeste, elle avait entre 83 et 84 ans, frêle, vaillante, avec une petite fille… Elle est venue me saluer : “Je ne suis pas d’ici, je suis de l’autre côté du fleuve, du Congo, mais chaque fois, une fois par semaine, je viens ici faire les emplettes parce que c’est plus avantageux”. Elle m’a dit son âge : entre 83 et 84 ans. “Depuis 23 ans, je suis ici : je suis infirmière obstétricienne, j’ai fait naître entre deux et trois mille enfants…”. – “Ah… et vous venez seule ?” – “Oui, oui, nous prenons un canoë…”. À 83 ans ! Elle faisait une heure de canoë et arrivait. Cette femme – tant d’autres comme elle ont abandonné leur pays – elle est italienne, de Brescia – elles ont laissé leur pays pour toucher la chair du Christ. Si nous allons dans ces pays de mission, dans l’Amazonie, en Amérique Latine, nous trouvons dans les cimetières les tombes de nombreux hommes et femmes religieux morts jeunes de maladies de ce pays, dont ils n’avaient pas les anticorps, et ils mouraient jeunes. Les œuvres de miséricorde : toucher, enseigner, consoler, “perdre du temps”. Perdre du temps. J’aime bien ceci : une fois, un homme est allé se confesser et il était dans une situation telle qu’il ne pouvait pas recevoir l’absolution. Il y est allé un peu craintif, parce qu’il avait parfois été renvoyé : “Non, non… va-t’en”. Le prêtre l’a écouté, lui a expliqué la situation, lui a dit : “Mais toi, tu pries. Dieu t’aime. Je te donnerai la bénédiction, mais reviens, me le promets-tu ?”. Et ce prêtre “perdait du temps” pour attirer cet homme vers les sacrements. Cela s’appelle proximité. Et en parlant de proximité aux évêques, je crois que je dois parler de la proximité la plus importante : celle avec les prêtres. L’évêque doit être disponible pour ses prêtres. Quand j’étais en Argentine, j’ai entendu de la part de prêtres… – tant, tant de fois, quand j’allais prêcher les Exercices spirituels, j’aimais prêcher les Exercices – je disais : “Parle de cela avec ton évêque…” – “Mais non, je l’ai appelé, la secrétaire me dit : Non, il est très, très pris, mais il te recevra dans trois mois”. Mais ce prêtre se sent orphelin, sans père, sans la proximité, et il commence à perdre courage. Un évêque qui voit sur la liste des appels, le soir, à son retour, l’appel d’un prêtre, il doit le rappeler immédiatement, soit ce soir-là même soit le lendemain. ‘‘Oui, je suis pris, mais est-ce urgent ?’’ – ‘‘Non, non, mais mettons-nous d’accord…’’. Que le prêtre sente qu’il a un père. Si nous privons les prêtres de paternité, nous ne pouvons pas leur demander d’être des pères. Et ainsi, le sens de la paternité de Dieu s’éloigne. L’œuvre du Fils, c’est de toucher les misères humaines : spirituelles et corporelles. La proximité. L’œuvre du Père : être père, évêque-père.
Puis, les jeunes – parce qu’on doit parler des jeunes ces jours-ci. Les jeunes sont “ennuyeux” ! Parce qu’ils viennent toujours dire les mêmes choses, ou bien “je suis de tel avis” ou bien “l’Église devrait…”, et il faut de la patience avec les jeunes. Quand j’étais enfant, j’ai connu certains prêtres : c’est le temps où le confessionnal était plus fréquenté que maintenant, ils passaient des heures à écouter, ou bien ils recevaient dans le bureau de la paroisse, écoutant les mêmes choses… mais avec patience. Et puis, accompagner les jeunes en campagne, en montagne… Mais pensez à saint Jean-Paul II, que faisait-il avec les universitaires ? Oui, il enseignait, mais ensuite il allait avec eux en montagne ! Proximité. Il les écoutait. Il était avec les jeunes…
Lire la suite
 Le 28 février 2014 était promulguée la loi « modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue de l'étendre aux mineurs». La Belgique devenait ainsi le premier et seul pays au monde à autoriser l’euthanasie de mineurs sans qu’aucune condition relative à l’âge de ceux-ci ne doive être rencontrée.
Le 28 février 2014 était promulguée la loi « modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue de l'étendre aux mineurs». La Belgique devenait ainsi le premier et seul pays au monde à autoriser l’euthanasie de mineurs sans qu’aucune condition relative à l’âge de ceux-ci ne doive être rencontrée.




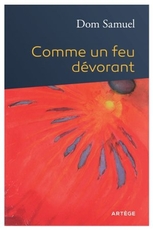 EXCLUSIF MAG - Dom Samuel, entré au monastère de Sept-Fons en 1983, a été l’un des fondateurs de l’abbaye de Novy Dvur, en République tchèque. Il vient de publier
EXCLUSIF MAG - Dom Samuel, entré au monastère de Sept-Fons en 1983, a été l’un des fondateurs de l’abbaye de Novy Dvur, en République tchèque. Il vient de publier