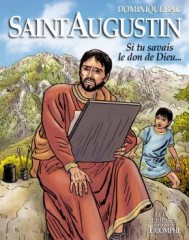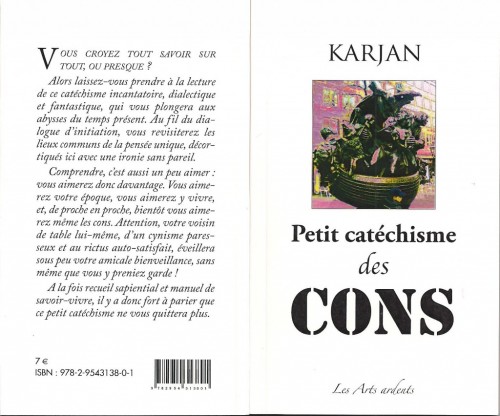|
« Nous sommes un corps mobile de prêtres et de diacres qui vivent en communauté et qui se mettent au service des évêques », explique l'abbé Paul Préaux, le supérieur, qui porte le titre de modérateur général de la Communauté Saint-Martin. Forte aujourd'hui de 80 prêtres, celle-ci compte plus de 60 séminaristes, ce qui place sa maison de formation au troisième rang, dans l'Eglise de France, après les séminaires de Paris et de Toulon.
Ces dernières années, le nombre de jeunes qui se sont sentis appelés à la prêtrise et qui ont frappé à la porte de la Communauté Saint-Martin est allé croissant. « La moitié d'entre eux ne se seraient pas engagés si nous n'existions pas », précise le responsable de la formation, l'abbé Louis-Hervé Guiny, qui ajoute : « Nous ne faisons donc concurrence à personne. »
La communauté doit ses principes à son fondateur, l'abbé Jean-François Guérin, qui la dirigea presque jusqu'à sa mort, survenue en 2005. En 1976, à un moment où beaucoup conjuguaient Marx et l'Evangile, ce prêtre a voulu créer un séminaire pour les candidats au sacerdoce qui, déroutés par la crise de l'Eglise, entendaient rester fidèles au pape, tout en s'inscrivant dans l'enseignement de Vatican II.(…) Soutenu par le cardinal Siri, archevêque de Gênes, l'abbé Guérin a donc établi sa maison de formation en Italie, à l'usage de quelques jeunes Français. En 1993, avec l'accord de l'évêque de Blois, qui avait confié des paroisses à des prêtres sortis de son séminaire, la Communauté Saint-Martin s'est installée à Candé-sur-Beuvron, sur les bords de la Loire.
C'est là, dans une grosse maison offerte à l'Eglise après la guerre, que se trouve aujourd'hui son séminaire. Les lieux n'ont pas été conçus pour héberger une collectivité, si bien que le moindre recoin de l'édifice est occupé. Au fil de la croissance de la communauté, il a fallu transformer le grand salon en chapelle, investir les dépendances et même loger des séminaristes dans le village. Aussi le déménagement à Notre-Dame d'Evron est-il attendu avec impatience, même si le budget de l'opération, qui est un défi et un pari sur l'avenir, reste à boucler. « Nous faisons appel à la générosité des fidèles », souligne le modérateur, l'abbé Préaux. (...)
Quatre axes de formation sont privilégiés ici :
Formation spirituelle, par la prière. Formation intellectuelle, en six années d'études : métaphysique, anthropologie, exégèse, langues anciennes, théologie fondamentale, théologie morale, Histoire sainte, histoire de l'Eglise. L'enseignement est dispensé par des prêtres de la communauté, dont l'Ecole supérieure de théologie, affiliée à l'Université pontificale du Latran, délivre un diplôme qui a des équivalences dans les grandes universités européennes. Conformément aux directives de Vatican II, la formation philosophique et théologique des futurs prêtres de la Communauté Saint-Martin s'effectue à la lumière de saint Thomas d'Aquin. Si certains séminaristes possèdent un bon niveau d'études en arrivant (avec des cursus allant de la philo à l'Essec en passant par la fac dentaire), d'autres n'ont pas le bac. L'entraide prévaut : lors des heures de travail en commun, les plus expérimentés assistent les autres.
Troisième axe pour les séminaristes, la formation pastorale. A travers un stage d'un an en paroisse ou l'encadrement de camps de jeunes pendant l'été, c'est le choc du concret. Bertrand, 27 ans, en quatrième année à Candé, raconte : « Je suis entré ici avec une image un peu idéaliste sur «le prêtre, homme du sacré». Pendant mon année de stage, j'ai cependant pu mesurer combien notre société est déchristianisée. Benoît XVI compare avec raison notre époque aux premiers temps de l'Eglise. Le prêtre doit donc commencer par le commencement : apporter le Christ aux hommes qui l'ignorent. »
Quand ils seront prêtres, ils vivront en communauté
Quatrième axe, au séminaire, la formation humaine. « Avant de faire des prêtres, il faut faire des hommes », répètent les supérieurs de la communauté. Selon eux, un bon prêtre, c'est quelqu'un qui, s'il n'était pas célibataire, serait d'abord un bon mari et un bon père. La vie en collectivité, avec ses contraintes (de la vaisselle à la lessive et du ménage au jardinage, ce sont les séminaristes qui font tourner la maison), prépare les candidats au sacerdoce à l'esprit de service, au don de soi.
Humilité, discipline, obéissance, partage, écoute, peu ou pas de téléphone ou d'internet. Ces renoncements sont acceptés, car ils font partie du contrat, d'autant plus qu'ils ouvrent l'esprit à l'essentiel. « Je souhaite, explique l'abbé Préaux, que cette maison soit un lieu où l'on fasse l'apprentissage de la liberté intérieure. »
Trois années de premier cycle, dit de philosophie ; une année de stage ; trois années de second cycle. A l'issue de ces sept années, le séminariste reçoit l'ordination diaconale. Au bout d'un an encore, le diacre accède normalement à l'ordination presbytérale. Huit années en tout sont donc nécessaires, à la Communauté Saint-Martin, pour faire un prêtre. Des prêtres qui, là où ils sont nommés, vivent en communauté, au moins par trois, célèbrent la messe de Vatican II dans sa forme romaine, où le latin a sa large place, et portent la soutane, afin de témoigner de leur état. Actuellement, la communauté est présente dans 12 diocèses. L'abbé Thomas Diradourian, professeur de liturgie à Candé, est vicaire à Saint-Raphaël, dans le Var. « Chez nous, remarque-t-il, le prêtre reste un personnage familier. Notre mission est reconnue, et l'évêque comme la municipalité nous soutiennent. »
Le modérateur a en attente 25 demandes de prêtres émanant de diocèses français ou étrangers. Pour les satisfaire toutes, il lui faudrait 450 séminaristes... Ceux qui étudient ici, comme dans les autres séminaires français, sont prévenus : une tâche immense les attend. Le long temps de formation qui leur est imposé n'a pour but que de leur donner la force nécessaire à cette mission.
Qu'est-ce qu'un prêtre, selon eux ? « Quelqu'un qui porte la parole de Dieu, mais qui ne sera écouté que s'il aime les gens », affirme Christophe, 6e année. « Un homme de prière, ce qui n'est pas séparable du service des pauvres et des malades », renchérit Pierre-Marie, 5e année. « Un serviteur de la miséricorde de Dieu », conclut Paul, 3e année. Si on les interroge sur leurs modèles, ils citent saint Pierre, saint Paul, saint Vincent de Paul, le curé d'Ars, le Padre Pio ou Jean-Paul II. Impressionnants garçons, qui ont librement choisi une vie radicalement différente des jeunes de leur âge. Ils ne sont nullement à plaindre : ils respirent la foi, la paix et la joie. En souriant, ils répètent une devise de l'abbé Guérin, leur fondateur : « Prendre Dieu au sérieux, sans se prendre au sérieux. »
|