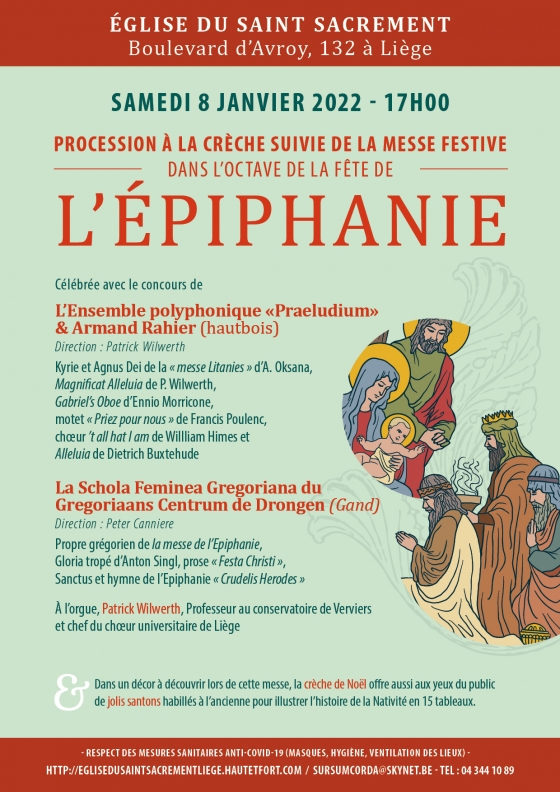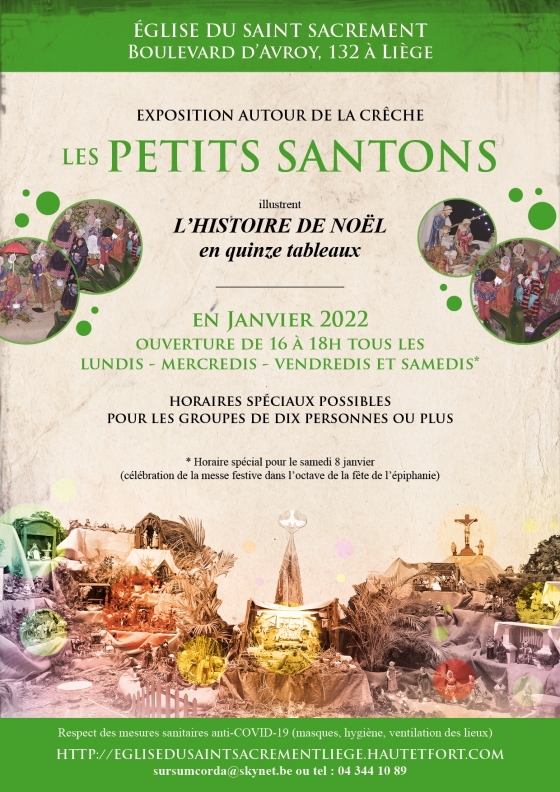Une tribune publiée sur le site du journal La Croix, signée par Dom Jean Pateau Abbé de Notre Dame de Fontgombault, l'Abbé Pierre Amar Prêtre diocésain, Christophe Geffroy Directeur de La Nef, Gérard Leclerc écrivain :
Guerre liturgique : « Plutôt que de s’accuser mutuellement de présupposés idéologiques, si nous nous écoutions ? »
TRIBUNE. À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, quatre personnalités catholiques appellent à « l’estime mutuelle » entre les catholiques attachés à la forme ancienne de la liturgie et les autres. Ils invitent à « prendre en main » la fraternité à laquelle les chrétiens sont appelés.
19/01/2022
« Promouvoir la restauration de l’unité entre tous les chrétiens est l’un des buts principaux du Concile » (1). Tels étaient les premiers mots du décret sur l’œcuménisme de Vatican II. Depuis, on a appris la méthode : dialoguer, s’écouter, s’estimer mutuellement. Accepter parfois ses différences, ne pas les nier. Prier ensemble souvent. Nous avons appris que l’œcuménisme est affectif avant que d’être dogmatique ou juridique. Nous avons aussi compris que l’unité des chrétiens est vitale pour la crédibilité même de l’Évangile. « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 35).
Peut-être Benoît XVI l’avait-il en tête quand il voulut mettre fin à la division interne des catholiques autour de la liturgie née du Concile. Plutôt que des arguments juridiques ou dogmatiques, il proposa un dialogue. On devait « s’enrichir mutuellement ». Cela supposait de mettre fin à la guerre liturgique fratricide qui avait tant divisé les communautés chrétiennes. Désormais, il nous demandait de nous écouter mutuellement, de dialoguer. L’avons-nous fait ? Pas assez certainement. Nous avons parfois vécu côte à côte comme des étrangers, remplaçant l’enrichissement fraternel par l’ignorance mutuelle. Nous en payons aujourd’hui le prix.
Une forme de guerre intérieure
Est-il pour autant nécessaire de renoncer à cette recherche de la paix liturgique ? Sommes-nous réduits à l’uniformisme liturgique comme seul moyen d’unité ? La question est plus grave qu’il n’y paraît. Car elle ouvre aussi une forme de guerre intérieure. Il est indispensable d’être en paix avec son passé pour avancer. Si nous ne sommes pas capables de vivre en paix avec la forme antérieure de la liturgie, alors nous installons la guerre au cœur de ce qui devrait être le sacrement de l’unité des hommes avec Dieu et entre eux.
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens pose donc d’abord une question interne à l’Église catholique. Le processus synodal qui s’ouvre nous invite à dépasser la verticalité, l’autoritarisme sévère et le juridisme tatillon qui ne font que créer des situations insupportables et des ressentiments durables.
Des présupposés idéologiques
Si nous dialoguions ? Plutôt que de s’accuser mutuellement de présupposés idéologiques, plutôt que prêter à l’autre des intentions inavouées ou de l’enfermer dans son histoire, si nous nous écoutions ? Nous découvririons des affectivités blessées, des cœurs humiliés de part et d’autre. Oui, les décennies 1960 et 1970 ont parfois été traversées par une politisation et une radicalisation des positions ecclésiales (notamment liturgiques) qui ont créé des crispations. Oui, les uns comme les autres nous recevons en héritage des attitudes culturelles et sociologiques qui demandent à être purifiées à la lumière de l’Évangile. Mais comment faire ? En se lançant mutuellement des anathèmes : Modernistes ! Intégristes ! Maurrassiens ! Progressistes ! La vérité en sortira-t-elle grandie ? En interdisant par voie réglementaire la publication des horaires de messes ? A-t-on jamais vu qu’une telle méthode contribue à la charité et à l’unité ?
La multiplication des interdits crée au contraire la fascination et le désir de transgression chez les jeunes générations de clercs comme de laïcs. On devrait se souvenir que les condamnations romaines de Lubac et de Congar ont contribué à les faire lire dans les séminaires mais n’ont pas affermi la confiance envers l’autorité romaine. Bien plus, en multipliant les mesures vexatoires de détails contre l’ancienne liturgie, on court le risque de passer à côté de l’essentiel de la réforme liturgique voulue par le Concile en l’enfermant dans un nouveau rubricisme juridique et autoritaire plutôt qu’en l’ouvrant à la participation du peuple de Dieu.
Prions les uns pour les autres
Alors, si nous osions prier les uns avec les autres ? Certes, chacun devrait faire des pas. Mais ils seraient alors accomplis par amour et non par contrainte. L’œcuménisme n’est pas œuvre de diplomatie et d’habilité. Il est d’abord une attitude spirituelle. Alors ouvrons les portes. Aux tenants de la liturgie ancienne, quand ils le pourront par amour et non par obligation juridique, d’oser faire l’expérience de la concélébration, de la belle richesse biblique des lectionnaires du Novus ordo.
Aux praticiens de la liturgie rénovée suite au Concile de se laisser déranger avec joie par ces communautés qui célèbrent le Vetus ordo et qui portent de beaux fruits de mission. Sommes-nous contraints à nous faire concurrence ? La fraternité serait-elle impossible ? Qui sait même si nos paroisses ne gagneraient pas à célébrer de temps à autre vers l’Orient ou à utiliser l’antique texte de l’offertoire ?
Un cœur bienveillant
Allons nous visiter mutuellement ! Allons avec bienveillance passer un dimanche chez celui qui célèbre le même Seigneur avec d’autres rites que les nôtres. Peut-être serons-nous heurtés par telle ou telle manière de faire. Mais si notre cœur est bienveillant, nous y découvrirons des semences de Verbe que nous avons nous-même oubliées.
La paix liturgique dans l’Église ne pourra pas s’obtenir tant qu’un bord continuera de jeter la suspicion sur la messe de l’autre bord.
Puisque le pape nous le demande, il revient à tous, évêques, prêtres et laïcs de prendre en main cette fraternité par la base plutôt que d’attendre que des décrets viennent la réglementer. Le risque de l’unité nous est confié par le pape. Et si nous osions le prendre en main ? Si nous osions tendre la main ?
-------------------
[1] Vatican II, décret Unitatis redintegratio, 1.
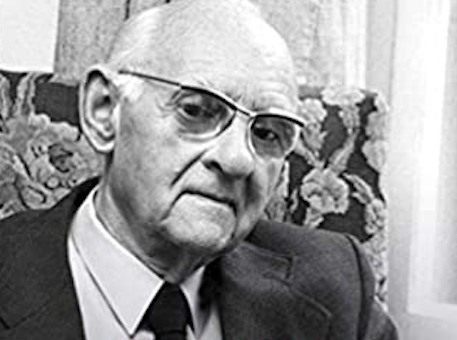

 L'archevêque de Chicago a sévèrement restreint les options pour célébrer la « vieille » messe. Maintenant, la résistance s'agite dans l'archidiocèse. Lu sur le site web Kath net :
L'archevêque de Chicago a sévèrement restreint les options pour célébrer la « vieille » messe. Maintenant, la résistance s'agite dans l'archidiocèse. Lu sur le site web Kath net :