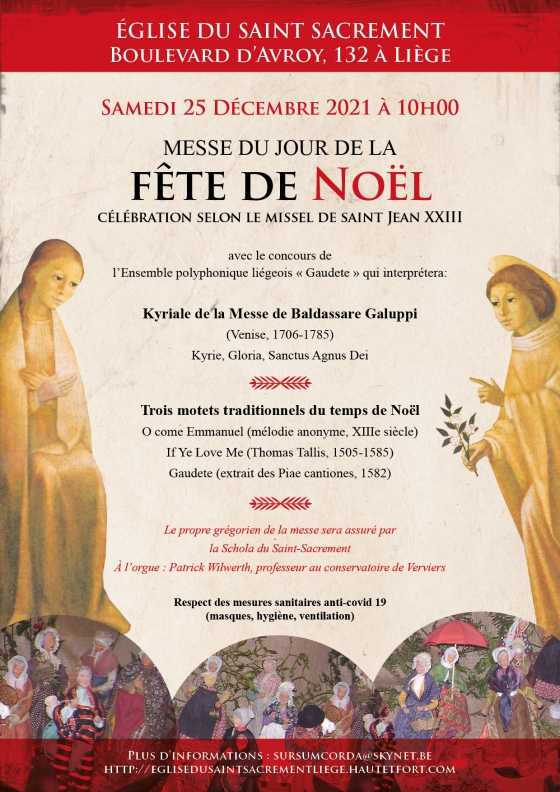De Pro Liturgia :
Adresse au pape François :
Saint Père,
Par votre Motu proprio « Traditionis custodes », vous avez souhaité limiter l’usage de la célébration de la liturgie romaine dans la forme qu’elle avait avant le concile Vatican II. Nul ne saurait vous reprocher cette initiative ; nul ne saurait vous reprocher de veiller à ce que l’unité de l’Église latine puisse se réaliser et s’exprimer à travers l’unité de la liturgie romaine.
Cependant, on comprend mal - très mal, même - que votre attention se focalise presqu’exclusivement sur la forme dite « extraordinaire » de la liturgie et que vous ne disiez rien au sujet des très nombreux prêtres, évêques en tête, qui depuis maintenant plus de cinquante ans s’emploient en toute liberté à distordre et à dénaturer le rite romain tel qu’il a été ordonnancé à la suite de Vatican II. Votre silence sur cette réalité vécue - pour ne pas dire « institutionnalisée - dans une majorité de paroisses fait que vous privez de nombreux fidèles d’une authentique célébration de la foi catholique ; que vous faites obstacle à la transmission de ce qu’exprime notre liturgie par une harmonieuse continuité de ses rites ; que, finalement, sans le vouloir expressément, vous encouragez ces mêmes fidèles à ne plus fréquenter les églises, à ne plus pratiquer.
Saint Père, nous ne mettons en cause ni votre autorité ni votre gouvernance pastorale ; ce qui nous pose un réel problème, c’est l’angle sous lequel vous abordez la question liturgique : fermeté à l’encontre de ceux qui s’en tiennent à la forme de la liturgie en usage avant Vatican II et magnanimité à l’égard de ceux qui, messe après messe, outrepassent les enseignements conciliaires et enfreignent, au nom d’une « pastorale » dont on n’a jamais vu les fruits, les principes liturgiques précisés dans le Missel romain que vous considérez à juste titre comme normatif.
Saint Père, dans la lettre explicative qui accompagne et explicite votre Motu proprio, vous reprenez à votre compte les mots de votre prédécesseur Benoît XVI : « Dans de nombreux endroits on ne célèbre pas de façon fidèle aux prescriptions du nouveau Missel [lequel est] même compris comme une autorisation ou jusqu’à une obligation à la créativité, qui conduit souvent à des déformations à la limite de ce qui est supportable. » Or voilà plus de cinquante ans que les fidèles qui ont compris et accepté Vatican II sont obligés de se conformer à contrecœur à des célébrations qui sont à la limite du supportable ou même carrément insupportables. N’est-il pas temps d’entendre ces fidèles ? N’est-il pas temps de rendre à ces fidèles la liturgie que l’Église entend leur donner aujourd’hui ?
Saint Père, avec « Traditionis custodes », nous avons pu avoir l’impression, à tort ou à raison, que vous cherchiez à contourner le vrai problème auquel l’Église doit faire face, à savoir la désagrégation de la liturgie avec, pour corollaire, l’affaiblissement de la foi et de la morale ainsi que la chute des vocations et de la pratique dominicale. Nous attendons donc de vous une nouvelle exhortation, un nouveau Motu proprio qui, cette fois, mettrait l’accent sur la nécessité de connaître et de faire connaître, de respecter et de faire respecter la liturgie. Et de rappeler fermement le rôle primordial joué par nos évêques dans cette entreprise décisive pour l’avenir de notre Eglise : c’est leur crédibilité autant que notre fidélité à l’Église qui est désormais en jeu.
Avec notre filial respect.
 Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire":
Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire": 
 « La publication samedi 18 décembre par le Vatican d’un document répondant à des questions sur le motu proprio Traditionis custodes restreignant la messe tridentine a suscité une vive incompréhension de la part des milieux traditionalistes mais aussi chez de nombreux fidèles.
« La publication samedi 18 décembre par le Vatican d’un document répondant à des questions sur le motu proprio Traditionis custodes restreignant la messe tridentine a suscité une vive incompréhension de la part des milieux traditionalistes mais aussi chez de nombreux fidèles.