 Le 28 novembre 2021, les fidèles du « novus ordo missae » (1970) ont pu enfin redécouvrir l’une des plus essentielles formules théologiques définies par l’Église au IVe siècle : la consubstantialité, mettant fin à la traduction erronée « de même nature que le Père ». Une réflexion d’Annie Laurent lue sur le site web de la revue « France Catholique » :
Le 28 novembre 2021, les fidèles du « novus ordo missae » (1970) ont pu enfin redécouvrir l’une des plus essentielles formules théologiques définies par l’Église au IVe siècle : la consubstantialité, mettant fin à la traduction erronée « de même nature que le Père ». Une réflexion d’Annie Laurent lue sur le site web de la revue « France Catholique » :
« Parmi les changements apportés à la nouvelle traduction du Missel romain, qui entre en vigueur le premier dimanche de l’Avent, il en est un qui revêt une signification d’une grande importance puisqu’il s’applique explicitement à l’expression de la foi catholique. C’est, en effet, rien de moins que la profession de foi en la divinité du Christ dont il s’agit. La formule « de même nature que le Père », contenue dans le Credo de la messe – forme ordinaire –, est remplacée par « consubstantiel au Père », qui est la traduction exacte en français du latin consubstantialem Patri.
L’usage du français à la messe est un fruit de Vatican II. Dans sa Constitution Sacrosanctum concilium (1963), le concile préconisait l’emploi des langues locales (§ 36) afin de favoriser « la participation pleine, consciente et active à la liturgie » (§ 14, 21). Le latin perdait alors son exclusivité dans le rite romain.
Traduction gallicane
Mais, anticipant la promulgation du nouveau Missel par saint Paul VI (1969), une traduction « gallicane », mise à l’essai dans les paroisses, connut un trop rapide succès, ce qui entraîna de vives réactions d’intellectuels catholiques, justement à propos du Credo. Ainsi de « Suis-je schismatique ? » : cette tribune publiée sous ce titre par le philosophe Étienne Gilson dans La France Catholique du 2 juillet 1965 est particulièrement explicite. L’auteur se dit gêné par ce « de même nature que le Père ». Comment la consubstantialité pouvait-elle être changée en une simple connaturalité, se demandait-il : « Deux êtres de même nature ne sont pas nécessairement de même substance. Deux hommes sont de même nature, mais chacun d’eux est une substance distincte, et c’est même pourquoi ils sont deux. »
Admettant que l’Église agissait ainsi « pour faciliter aux fidèles l’accès des textes liturgiques », il commentait : « On le veut si ardemment qu’on va jusqu’à éliminer du français certains mots théologiquement précis, pour leur en substituer d’autres qui le sont moins, mais dont on pense, à tort ou à raison, qu’ils “diront quelque chose” aux simples fidèles. De même nature semble plus facile à comprendre que de même substance. » Voulant à tout prix éviter de soupçonner l’Église d’intention hérétique, Gilson voyait néanmoins dans la nouvelle formule « une sorte d’avachissement de la pensée théologique ».
Ref. Consubstantiel : la fin d’une formule ambiguë
Restauration ? oui et non puisque le choix est donné entre le credo de Nicée-Constantinople et celui, plus elliptique, du symbole des apôtres et sous réserve de savoir par ailleurs si le choix réservé entre ces deux versions sera lui-même respecté dans le contexte de la permissivité liturgique en usage de fait au sein du nouvel ordo missae…



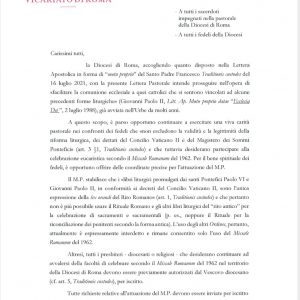
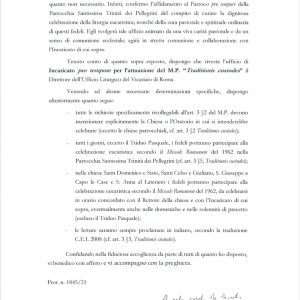

:format(jpg)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/ipmgroup/PDXBZHFIX5GHTPSVHUUKBF2ZDI.jpg)